Yaa Gyasi – No home (2016, Homegoing) – Calmann-Lévy, 2017 pour la traduction française, traduit de l’anglais ((Etats-unis), par Anne Damour

Dans notre monde de blogueurs, la lecture et l’écriture sont intimement mêlées, elles s’épousent l’une l’autre, et se tissent d’échos, dont la source est notre monde intérieur et la façon dont la lecture des autres, la rencontre des livres, donnent jaillissement à notre propre fond.
C’est ce que nous donnons à lire parfois.
Le roman de Yaa Gyasi est de ceux qui a suscité chez moi une grande émotion, et de grands bouleversements intérieurs qui tiennent essentiellement à la façon dont je suis en ce monde, reliée aux autres et surtout à ma fille, immense amour.
C’est ainsi qu’elle se dessine :

Elle dessine aussi souvent dans ce blog.
La lecture du roman de Yaa Giasi a été souvent douloureuse et magnifique. J’aurais pu serrer les poings, de rage, et d’impuissance, face à ce qui a été, qui ne peut être changé et qui nous constitue ma fille et moi à travers le mélange des peaux, des gênes, des histoires vécues avant nous. Notre mémoire porte la trace de ces déracinements, de ces arrachements. Et moi, blanche, mon âme s’est noircie irrémédiablement. Avec bonheur, et parfois aussi autre chose.
Car c’est l’histoire de deux femmes, de deux destins, qui les conduira de l’Afrique aux Amériques, en ce XVIIIe siècle qui n’est pas seulement celui des Lumières.
En effet, au XVIIIe siècle, sur la Côte-de-l’Or, au plus fort de la traite des esclaves, deux femmes Effia Otcher et Esi Asare, nées de la même mère, voient leurs destins se nouer dans le même lieu (même si elles ne se rencontreront jamais), à Cape Coast, dans le fort souterrain, où s’entassent les corps des esclaves, par centaines, dans des conditions inhumaines, et au-dessus, dans la lumière, face à la mer, dans les appartements, et puis plus tard dans une petite maison, où le mariage du capitaine du fort, Jame Collins, et de Effia otcher donne naissance à Quey Collins écartelé par ce métissage et par la violence de la traite.
Le métissage en ces temps, n’avait rien de la rencontre heureuse et souhaitée, elle portait la marque de la brisure. On ne mesure pas le poids, dans l’inconscient collectif, de cette histoire du métissage. Et chez nous, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, en portent encore les stigmates.
Ces destins broyés de génération en génération, dont les séquelles se font encore sentir dans la société américaine, témoignent de la barbarie, de la folie au cœur des hommes.
Yaa Giasi n’élude pas la responsabilité des africains, dont les guerres tribales incessantes, attisées par les anglais, ont fourni des esclaves au système de la traite. Et je crois que c’était la première fois que je lisais, dans un roman, l’évocation de ce système.
Une autre blogueuse, Carole dit bien la respiration de cette lecture, de ce souffle que l’on retient, de cette temporalité incertaine.

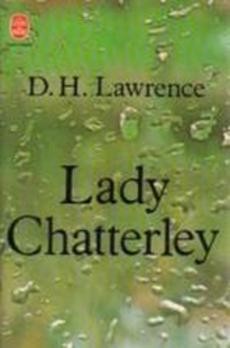
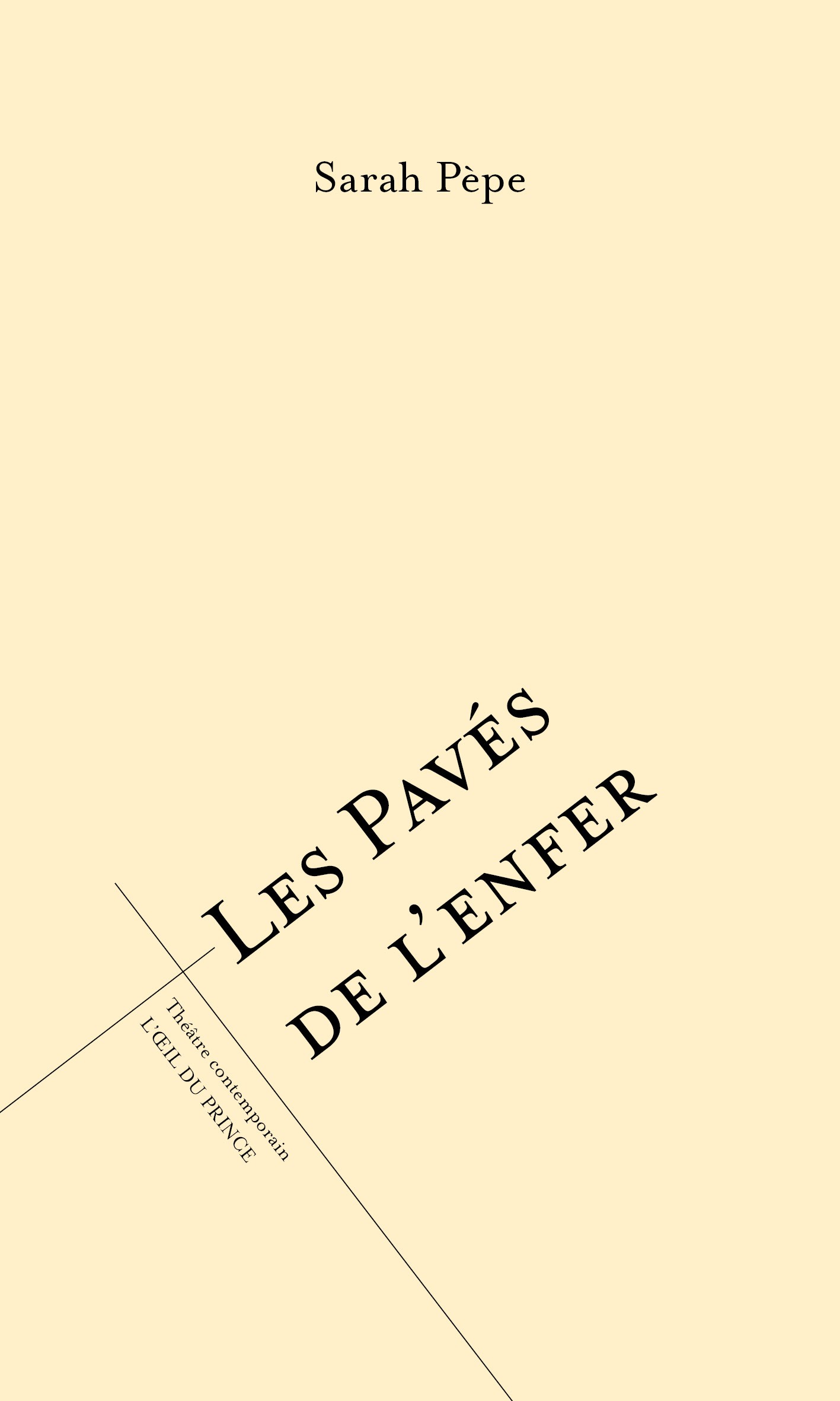






 Le mot texte vient du latin textus, de texere, tisser. Celui qui conte, qui raconte est celui qui tisse, qui met ensemble, et fait naître l’histoire et le sens. Celui qui a une histoire, naît et meurt, a donc un début et une fin, un sens, une direction. Frasquita, l’héroïne de cette histoire, hérite de sa mère une boîte que se transmettent de mère en fille, les femmes de la famille, depuis plusieurs générations. Cette boîte est rempli de fils et d’aiguilles. Frasquita n’est pas celle qui raconte, celle qui tisse, car c’est Soledad, sa fille, qui aura pour rôle de transmettre l’histoire familiale, celle qu’on lui a racontée et qui s’est déroulée dans sa plus grande partie avant sa naissance.
Le mot texte vient du latin textus, de texere, tisser. Celui qui conte, qui raconte est celui qui tisse, qui met ensemble, et fait naître l’histoire et le sens. Celui qui a une histoire, naît et meurt, a donc un début et une fin, un sens, une direction. Frasquita, l’héroïne de cette histoire, hérite de sa mère une boîte que se transmettent de mère en fille, les femmes de la famille, depuis plusieurs générations. Cette boîte est rempli de fils et d’aiguilles. Frasquita n’est pas celle qui raconte, celle qui tisse, car c’est Soledad, sa fille, qui aura pour rôle de transmettre l’histoire familiale, celle qu’on lui a racontée et qui s’est déroulée dans sa plus grande partie avant sa naissance. On ne peut que se réjouir de l’intérêt de la critique et d’une certaine partie des lecteurs pour l’histoire de l’écriture des auteures. Cela pourrait bien être la revanche post-mortem de ces femmes dont Rousseau disait dans une lettre écrite à d’Alembert en 1758 : « Les femmes, en général, n’aiment aucun art, ne se connaissent à aucun, et n’ont aucun génie. Elles peuvent réussir aux petits ouvrages qui ne demandent que de la légèreté d’esprit, du goût, de la grâce, quelquefois même de la philosophie et du raisonnement. Elles peuvent acquérir de la science, de l’érudition, des talents et tout ce qui s’acquiert à force de travail. Mais ce feu céleste qui échauffe et embrase l’âme, ce génie qui consume et dévore, cette brûlante éloquence, ces transports sublimes qui portent le ravissement jusqu’au fond des cœurs, manqueront toujours aux écrits des femmes : ils sont tous froids et jolis comme elles. »
On ne peut que se réjouir de l’intérêt de la critique et d’une certaine partie des lecteurs pour l’histoire de l’écriture des auteures. Cela pourrait bien être la revanche post-mortem de ces femmes dont Rousseau disait dans une lettre écrite à d’Alembert en 1758 : « Les femmes, en général, n’aiment aucun art, ne se connaissent à aucun, et n’ont aucun génie. Elles peuvent réussir aux petits ouvrages qui ne demandent que de la légèreté d’esprit, du goût, de la grâce, quelquefois même de la philosophie et du raisonnement. Elles peuvent acquérir de la science, de l’érudition, des talents et tout ce qui s’acquiert à force de travail. Mais ce feu céleste qui échauffe et embrase l’âme, ce génie qui consume et dévore, cette brûlante éloquence, ces transports sublimes qui portent le ravissement jusqu’au fond des cœurs, manqueront toujours aux écrits des femmes : ils sont tous froids et jolis comme elles. »
 Il est particulièrement intéressant de lire ou de relire aujourd’hui « La servante écarlate » de Margaret Atwood, à la lumière de l’histoire récente des Etats-Unis, et des manifestations qui ont eu lieu pour protester contre les restrictions au droit à l’avortement, suivant la politique menée par Donald Trump, dans certains Etats américains (
Il est particulièrement intéressant de lire ou de relire aujourd’hui « La servante écarlate » de Margaret Atwood, à la lumière de l’histoire récente des Etats-Unis, et des manifestations qui ont eu lieu pour protester contre les restrictions au droit à l’avortement, suivant la politique menée par Donald Trump, dans certains Etats américains ( 
 Dans le roman de Dulce Maria Cardoso, un jeune adolescent raconte la fuite précipitée de sa famille en 1975, hors d’Angola, vers la métropole portugaise, l’accueil dans un hôtel à Lisbonne, et la reconstruction après le traumatisme de l’exil et de la dépossession. L’approche formelle est vraiment intéressante : l’écriture est proche du langage parlé, les dialogues s’insèrent dans la voix du jeune garçon (d’un discours rapporté à un discours direct) qui porte ainsi de multiples voix comme autant de perspectives sur ce qui est vécu. Ce que disent les autres est toujours filtré par le prisme de sa subjectivité propre. La narration à la première personne permet de comprendre les sentiments du jeune homme, les émotions qui le bouleversent, sa découverte de l’amour et de la sexualité, sa honte et l’ostracisme dont lui et les siens sont victimes.
Dans le roman de Dulce Maria Cardoso, un jeune adolescent raconte la fuite précipitée de sa famille en 1975, hors d’Angola, vers la métropole portugaise, l’accueil dans un hôtel à Lisbonne, et la reconstruction après le traumatisme de l’exil et de la dépossession. L’approche formelle est vraiment intéressante : l’écriture est proche du langage parlé, les dialogues s’insèrent dans la voix du jeune garçon (d’un discours rapporté à un discours direct) qui porte ainsi de multiples voix comme autant de perspectives sur ce qui est vécu. Ce que disent les autres est toujours filtré par le prisme de sa subjectivité propre. La narration à la première personne permet de comprendre les sentiments du jeune homme, les émotions qui le bouleversent, sa découverte de l’amour et de la sexualité, sa honte et l’ostracisme dont lui et les siens sont victimes.