
Il aurait été dommage de ne pas vous parler de Cristina Di Belgiojoso (1808-1871), cette brune à la beauté particulière que vous pouvez contempler sur ce portrait, dont les activités littéraires sont très dépendantes de son activité politique et militante dans l’Italie du XIXe siècle. Ecrire permet de penser et de réformer.
J’ai dû croiser un grand nombre d’informations dont certaines divergeaient légèrement.
Elle a été la première femme à diriger un journal, « la Gazzetta italiana » en 1842. Elle écrira 4 volumes « L’essai sur la formation du dogme catholique » qui prône un catholicisme libéral, écrira dans la Revue des Deux Mondes (1848) à propos des événements auxquels prend part.
Elle publie dans le premier numéro de la revue Nuova Antologia de 1866 son étude Della presente condizione delle donne e del loro avvenire (« des conditions actuelles des femmes et de leur avenir »)[1].
Mais qui est-elle ?
Elle fait partie de la noblesse, née marquise Trivulzio, et épouse en 1824 le prince Emilio de Belgiojoso qui, mari infidèle, lui transmit la syphilis [2]. Il était à la tête d’une société secrète « la Federazione », ennemi irréductible de l’Autriche[3]et fervent patriote. Elle devient une activiste en faveur de l’unité italienne et tente de soulever l’opinion en faveur de la libération de l’Italie grâce à son journal.
En 1831, pour fuir la répression, elle s’exile à Paris, tient un salon où elle fréquente Balzac, Musset, Heine, Liszt ou l’historien François-Auguste Mignet.
Sa personnalité originale et exaltée en fera l’icône du romantisme mais aussi de l’indépendance de la femme.
En 1848, elle participe à l’insurrection milanaise qui sera un échec, fait lever à ses frais une troupe de volontaires, portant un immense drapeau déployé aux couleurs italiennes.[4]
Elle s’exile et entreprend un voyage avec sa fille et quelques autres exilés en Grèce et Asie mineure, et écrira des mémoires d’exil.
A partir de 1856, elle se fixe à Locato près de Milan et entreprend des réformes sociales en faveur des paysans. La proclamation du royaume d’Italie se réalise le 17 mars 1861 et un an avant sa mort, en 1871, elle assiste à la dernière phase de l’unification de son pays avec l’annexion de Rome.
[1] Ginevra CONTI ODORISIO in Dictionnaire des créatrices.
[2] idem
[3] Dictionnaire des femmes célèbres, Laffont
[4] idem





 Elle fut la première à pratiquer le vers libre en France dans les années 1881-1882, précédant le combat décadent de Gustave Kahn.
Elle fut la première à pratiquer le vers libre en France dans les années 1881-1882, précédant le combat décadent de Gustave Kahn.
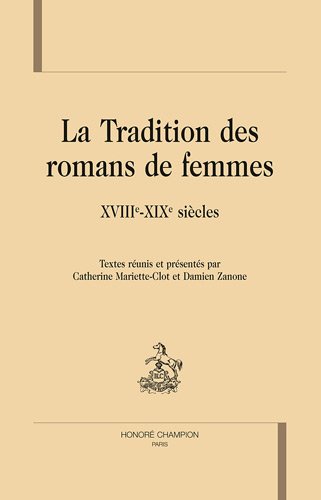
 Les noms de Mmes de Charrière, Cottin, de Duras, Gay, de Genlis, de Graffigny, Guizot, de Krüdener, de Montolieu, Riccoboni, de Souza, de Tencin (donnés ici dans l’ordre impersonnel de l’alphabet), romancières réputées en leur temps, ont difficilement passé les années : dès le milieu du XIXe siècle, ils n’ont plus été retenus que des érudits qu’intéressaient l’histoire de la littérature ou l’histoire du roman, l’histoire des femmes aussi. Quant à la notoriété qui a toujours entouré les noms de Mme de Staël et de George Sand, elle s’est souvent plus occupée d’aspects de leur biographie, construits et chéris comme des stéréotypes, que de leur oeuvre de romancières.
Les noms de Mmes de Charrière, Cottin, de Duras, Gay, de Genlis, de Graffigny, Guizot, de Krüdener, de Montolieu, Riccoboni, de Souza, de Tencin (donnés ici dans l’ordre impersonnel de l’alphabet), romancières réputées en leur temps, ont difficilement passé les années : dès le milieu du XIXe siècle, ils n’ont plus été retenus que des érudits qu’intéressaient l’histoire de la littérature ou l’histoire du roman, l’histoire des femmes aussi. Quant à la notoriété qui a toujours entouré les noms de Mme de Staël et de George Sand, elle s’est souvent plus occupée d’aspects de leur biographie, construits et chéris comme des stéréotypes, que de leur oeuvre de romancières.















