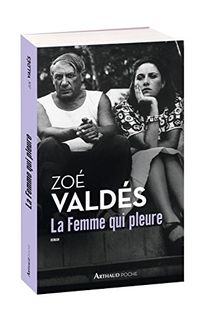Annie Besant (1847-1933)
Quelle curieuse personnalité et quel tempérament que ceux d’Annie Besant, née Wood !
Orpheline de père, elle fut élevée dans un milieu très mystique, dans lequel se mêlaient de manière très originale, les récits religieux irlandais et les histoires merveilleuses des contes de fée. Cette manière non conventionnelle de pratiquer la spiritualité explique certainement pour une part sa façon très personnelle de concevoir la vie religieuse et aussi les luttes qu’elle engagea plus tard.
En 1855, sa mère, alors sans ressources à la mort de son mari, l’envoya dans le Devon, « chez Ellen Marryat, sœur de l’officier de marine et romancier Frederick Marryat (1792–1848). Cette dernière, riche et célibatiaire[1], offrit à Annie l’éducation classique d’une jeune lady, mais aussi le goût de l’étude. »
Elle eut la chance de recevoir une solide éducation, et fut une des premières femmes admises à la prestigieuse à la prestigieuse University College de Londres.
Mais tout d’abord, comme beaucoup de femmes à l’époque, elle fut mariée contre son gré à un pasteur anglican, qu’elle quitta au bout de six ans pour s’installer à Londres avec sa fille. Mère de deux enfants, un garçon et une fille, elle obtint une séparation légale et la garde de sa fille dans un premier temps.
Mais victime des lois injustes qui briment les épouses, elle perdra la garde en 1878. Les deux enfants retrouvèrent leur mère à leur majorité.
Mais, au fond, pourquoi ? Car si son père gagna son procès , Mabel Besant-Scott le vit à peine les dix années suivantes puisqu’il l’avait placée en pension et elle ne revit pas sa mère que bien plus tard.
Annie Besant devint athée militante, se lia à Charles Voysey et aux libre-penseurs et eut une vie assez agitée au cours de laquelle elle fut couturière, garde-malade et journaliste. Sur le plan intellectuel , elle n’eut peur des contradictions, et ses engagements ne cessèrent de susciter la polémique , voire l’hostilité.
(sécularisme,monisme, positivisme, maçonnerie entre autres !)
C’est à université de Londres qu’elle rencontra des intellectuels philantropes socialisants de la Fabian Society (Why I am a Socialist, 1886).
Elle rencontra Charles Bradlough, libre penseur et journaliste anglais avec lequel elle provoqua le scandale en raison de la campagne qu’ils menèrent pour la limitation des naissances. Ils publièrent en 1877 The fruits of Philosophy de l’américain Charles Knowlton qui contenaient des illustrations d’organes génitaux ! Il n’en fallait pas plus pour la société pudibonde de l’époque, ils furent condamnés pour obscénité !
Cela l’amena à fonder une ligue néo-malthusienne (1887) (Law of Population : Its Consequences, and its Bearing upon Huan Conduct and Morals, 1877).
Mais son engagement le plus marquant fut peut-être la thésophie, qui réconcilia en elle certainement des aspirations qui pouvaient apparaître opposées, et notamment son goût pour les interrogations métaphysiques et ses opinions républicaines. En 1889, elle se convertit à la doctrine d’Helena Blavatstky après la lecture de « La doctrine secrète ». En 1907, elle lui succèdera à la tête de la Société de théosophie.
Elle fut une grande oratrice populaire et assista aux manifestations du « Bloody Sunday » du 13 novembre 1887.
Activiste infatigable, elle effectua de très nombreux voyages en Inde, et créa, à Madras, en 1914 le journal New India, pour réveiller les consciences, participa à la fondation de L’Indian Home Rule League, et présida à l’Indian National Congress.
Elle milita aux côtés de Ghandi, fut internée trois mois par les anglais en 1917. Elle tenta de créer un mouvement plus modéré sans succès.
Au final, elle participa à la vie intellectuelle de son temps, fut l’amie de Henry Hindman, William Morris, George Bernard Shaw.
Références : A.H Nethercot, The First Five Lives of Annie Besant, Londres 1961, et The Last Four Lives of Annie Besant,Dictionnaire des Femmes Célèbres , Lucienne Mazenod, Ghislaine Schoeller, Bouquins Robert Laffont , Londres 1963, Martine Monacelli, Dictionnaire Universel des Créatrices,Des femmes Antoinette Fouque S.R. Balshi, Home Rule Movement, New Delhi, 1984, Notice Anne Besant, Le Maitron
Quelques oeuvres : On the Nature and Existence of God, 1875
Law of Population : Its Consequences, and Its Bearing upon Human Conduct and Morals, 1877
Why I Am a Socialist, 1886
Consultez l’excellente biographie du Maitron , ici
https://maitron.fr/spip.php?article75315, notice BESANT Annie [née WOOD Annie] par Muriel Pécastaing-Boissière (nouvelle version, janvier 2011), version mise en ligne le 12 décembre 2009, dernière modification le 5 août 2016..
[1] https://maitron.fr/spip.php?article75315