
Jean-Michel Guenassia – Le Club des Incorrigibles Optimistes Le livre de poche – Editions Albin Michel 2009
Jean-Michel Guenassia est né en 1950. Après avoir été avocat puis scénariste et auteur dramatique, il se consacre en 2002 à l’écriture du Club des Incorrigibles Optimistes qui lui demandera six ans de travail.
Cet article a été écrit lors de mon année en tant que jury sur Terrafemina.com. Ayant changé de blog, j’ai souhaité le conserver et le publier à nouveau. Récemment, Jean-Michel Guénassia a ajouté quelques précisions en commentaire que je souhaite intégrer à cet article.
Tout d’abord, l’auteur avertit : « Le Club n’est pas du tout une autofiction ou un roman autobiographique. C’est Michel Marini qui s’exprime en permanence, même si je partage avec lui son amour d’Henry James et quelques autres idées, (mais je suis le seul à les connaître). Ce sont ses idées, ses aphorismes. Et qu’il faut prendre en les rapportant à son âge et à l’époque. »
Je ne ferai pas de critique sur ce blog de ce livre que j’ai adoré mais sur Terrafemina.com puisque j’ai le grand plaisir d’être jurée cette année. Je me suis donc amusée à regarder de plus près les personnages féminins du livre car Jean-Michel Guenassia fait de fréquents clins d’œil à l’image que les femmes ont dans les romans. Les personnages féminins sont des personnages secondaires : ce roman est un roman d’hommes et raconte avant tout le passage de l’enfance à l’adolescence du narrateur qui a 12 ans au début de l’histoire et 17 à la fin. Les figures masculines que sont essentiellement son père et ses amis exilés vont lui permettre de se forger une identité et de grandir. Les figures féminines servent de contrepoint ou de négatif comme le personnage de la mère avec lequel s’opère la rupture.
Cet éloignement, nécessaire pour le jeune homme, lui permet d’investir d’autres figures d’attachement : son amie Cécile et plus tard Camille.
Quant aux hommes exilés qui ont quitté leur famille, il s’avère difficile pour eux de vivre à nouveau des relations amoureuses. L’image de la femme est dans ce contexte politique de l’URSS très liée au sacrifice et aux enfants. Elles seront abandonnées ou trahies. A charge pour elle de se débrouiller et de survivre si par chance, elles ne sont pas arrêtées.
Attention, ce qui suit n’est pas une critique du livre.
Sur fond de rock’n’roll et de guerre d’Algérie, photographe amateur, joueur passionné de baby foot puis d’échecs mais par-dessus épris de littérature, Michel, jeune adolescent lit tout le temps, en marchant, en cours, dans les toilettes, enfin partout. Il raconte son adolescence, ses premières amours et aussi la rencontre qui le marquera à tout jamais, d’exilés qui ont fui les pays communistes : Igor, Léonid, Sacha, Imré et les autres.
JM G : « L’époque est caractérisée par une misogynie et un machisme écrasants (aucune femme dans le gouvernement de De Gaulle en 1958, ni dans les gouvernements suivants de Michel Debré quand CDG sera président ). »
Cet univers uniquement masculin (aucune femme n’est acceptée au club de joueurs d’échecs appelé club des Incorriginbles Optimistes) est éclairé en contrepoint par ces femmes dont l’exclusion révèle bien le sort qui leur est réservé et dans la narration et dans l’Histoire. D’ailleurs si aucune femme n’est acceptée dans ce club de joueurs d’échec qu’est le club des Incorrigibles Optimistes c’est qu’elles représentent une menace de désordre : désordre amoureux, et rivalité qu’engendre le désir de conquête.
Ce monde finissant, préfigure le nouveau monde qui naîtra après 68 dans la littérature :
« Peut-être que la nouveauté du roman moderne, miroir de son époque, est d’avoir permis aux femmes de se renier elles aussi, de trahir comme les hommes et de devenir solitaires ».
Qui sont-elles ces filles et ces femmes ?
1ère pensée profonde
« Les grands écrivains ont remarqué la supériorité des femmes sur les hommes et leur ont donné une maîtrise psychologique instinctive. »
La première d’entre elles, Juliette, est une incorrigible bavarde, constamment habitée par « le flot ininterrompu de mots qui sortait de sa bouche sans qu’on puisse l’interrompre. »
Son frère a du mal à la supporter. Elle est futile, frivole, ne rêve que de toilettes et de colifichets. D’ailleurs le narrateur l’évite souvent et la rembarre encore plus souvent.
La mère de Michel : femme de caractère, autoritaire, froide, un peu hautaine, issue de la moyenne bourgeoisie. Elle est distante avec ses enfants avec lesquels elle n’a pas de véritable relation. Elle tranche , décide mais écoute peu. Elle représente la femme d’entreprise moderne, qui prend son destin en main et qui doit se faire sa place. Mais elle apparaît assez antipathique tout au long du livre
Martha, la mère de Tibor : hongroise, elle cultive le raffinement sous toutes ses formes, son ambition est de vivre, parler, marcher, manger, s’habiller comme une parisienne. Elle est très proche de son fils qui est homosexuel. (Il y a un raccourci de cette femme à son fils qui est un peu ambigu).
Marie Besnard, criminelle, monstrueuse.
2eme pensée profonde
« Les grands romanciers ont constaté que, si les femmes obtiennent des hommes des serments absolus, la plupart du temps, les hommes sont parjures. »
La mystérieuse Cécile prépare un doctorat sur Aragon, lit des tas de livres, est capable de travailler des après-midis entiers. Elle est maigre, mange peu, se nourrit de café au lait. Elle est l’amoureuse du roman, amoureuse entière et tourmentée, sur le fil du rasoir.
JMG : « On sent poindre ce qui deviendra le féminisme de la fin des années 60 et surtout des années 70, et dans le roman, c’est Cécile qui porte ces idées. «
Les femmes des exilés :elles sont restées au pays, ont entièrement les enfants à leur charge, doivent divorcer pour ne pas être trop inquiétées par le Parti. Elles n’ont pas droit à la liberté et encore moins à la rédemption.
Florilèges d’autres pensées profondes de l’époque
La misogynie ambiante n’est pas un vain mot : les femmes sont de vraies girouettes, elles changent d’avis constamment et sont versatiles. Elles n’ont pas de cervelle donc ne sont pas intelligentes.
« Elles disent blanc le matin, le soir c’est gris et le lendemain, elles ont changé d’avis. »
Remarque qui légitime tous les abus et qui est dans la mentalité de l’époque :
« Tu ne connais rien aux femmes. C’est quand elles disent non qu’elles pensent oui ».
Si une femme refuse, en fait elle accepte. Il faut toujours interpréter. Ceci légitime la plus parfaite goujaterie, l’insistance déplacée, le harcèlement.
En résumé : Dans ce roman qui traduit bien l’atmosphère et les préjugés de l’époque, les femmes sont méprisées, abandonnées, trahies (pas par l’auteur bien sûr). Elles sont victimes de la misogynie fortement ancrée dans les mentalités. Et l’auteur en rend parfaitement compte dans ce roman. Mais les années 70 et le féminisme sont annoncés par deux personnages de femme : la femme qui entreprend, la mère, et Cécile, intelligente, et passionnée.
Avec beaucoup de subtilité, Jean-Michel Guenassia dépeint les derniers soubresauts d’un monde moribond, sur le plan politique et social et l’avènement d’un autre dont on ne sait pas encore grand-chose…
J’aimerais le citer en conclusion :
« J’ai voulu écrire un livre sur la trahison, thème qui sous-tend le récit. Et que les seuls personnages qui ne trahissent rien ni personne sont les trois femmes de ce roman : Hélène, Cécile et Camille. »
Mais sur ce thème-là, il y aurait encore beaucoup à dire…
Je remercie l’auteur en tout cas d’avoir apporté ces précisions. Il faudrait le compléter car je n’ai pas parlé de Camille.











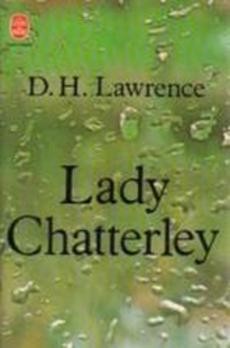


 Qu’est-ce qu’être un homme, ou une femme ? Pourquoi en certains êtres le sexe psychique ne correspond-il pas au sexe biologique ? Et pourquoi est-il si difficile parfois de respecter les limites étroites assignées à chaque sexe ? Cette assignation d’une identité sexuelle a des conséquences que personne n’ignore : des statuts et des rôles bien différents sont attribués à chaque sexe auxquels il doit se conformer sous peine d’être exclu du groupe social.
Qu’est-ce qu’être un homme, ou une femme ? Pourquoi en certains êtres le sexe psychique ne correspond-il pas au sexe biologique ? Et pourquoi est-il si difficile parfois de respecter les limites étroites assignées à chaque sexe ? Cette assignation d’une identité sexuelle a des conséquences que personne n’ignore : des statuts et des rôles bien différents sont attribués à chaque sexe auxquels il doit se conformer sous peine d’être exclu du groupe social.














