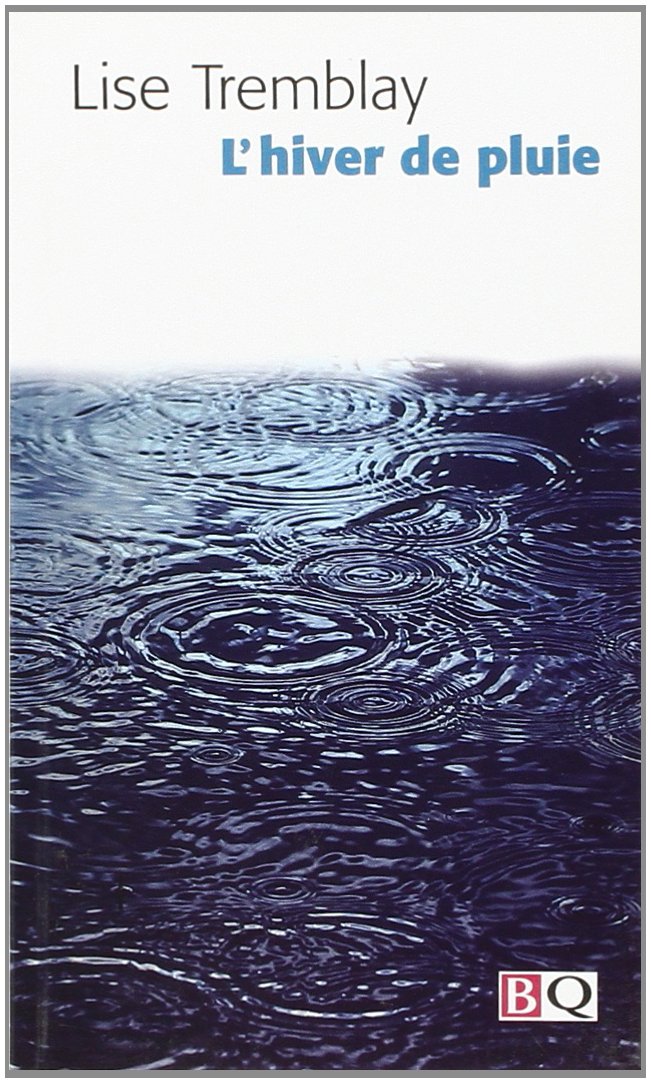Lucie Lachapelle – Histoires nordiques (2013)– Bibliothèque québécoise , 2018
Histoires nordiques est un recueil de nouvelles composé de façon assez originale, puisque un même personnage évolue dans ces récits, formant la trame de cette rencontre avec le Nord du Québec.
Lucie Lachapelle connaît cette région pour y avoir séjourné plusieurs fois, et y a même enseigné en 1975. Son récit est donc bien documenté. Toutefois, avertit-elle, «Les personnages pourraient être réels, mais ils sont magnifiés ou enlaidis par la littérature. Ça passe par mes émotions, ma sensibilité.»
Louise découvre le Nord à l’âge de quinze ans, plus exactement le Nunavik et en tombe amoureuse. Elle se promet de terminer ses études et d’y revenir.

Quelques années plus tard, enseignante, elle fait ses premières armes dans cet environnement assez difficile, il faut bien l’avouer. Certains sont morts en voulant franchir les quelques mètres qui séparent deux maisons, en pleine tempête. Le froid y est parfois si mordant, qu’il n’est pas rare d’avoir des membres gelés. Enfin, ce sont surtout les risques qu’encourent les étrangers, parfois très mal préparés à la vie dans le Nord. Les inuits, eux, ont adapté leur vie à leur environnement. Toutefois, le réchauffement climatique et la fonte des glaces, déjà dans les années 70, introduisent des ruptures auxquels ils ne sont pas préparés.
Louise est profondément émerveillée par les beautés du Nord, la nature à perte de vue, la lumière à nulle autre pareille, et la qualité du silence. Le Nord la révèle à elle-même, la renvoie à sa solitude, mais lui fait découvrir aussi sa force intérieure.
« L’esprit ouvert, le cœur éponge, la sensibilité à fleur de peau ; fière, droite, humble. Elle a su traverser les tempêtes, respirer le vent, absorber la lumière, le froid, le silence.»
Ce récit évoque les difficultés de Louise à s’intégrer, à avoir une vie amoureuse, et un avenir dans cette région où elle reste l’étrangère. Son mode de vie ne l’a pas préparé à la dure condition des femmes innues. Et sa relation avec la nature reste extérieure, celle-ci n’est pas peuplée d’esprits, à la manière innue qui entretient des relations extrêmement vivantes et étroites avec les lieux – la rivière est vivante, elle attend ses morts, elle s’endort ou se réveille.
« Louise fait bien attention de ne pas dévisager les gens qu’elle croise. Elle ne veut pas qu’ils se sentent regardés comme des objets, des sujets d’étude. À vrai dire, c’est plutôt elle qui se sent observée. Les gens interrompent leurs occupations, lèvent les yeux, se retournent sur son passage.»
Ouverte d’esprit, elle tente d’apprendre la langue autochtone, l’inuktitut, et fait de son mieux pour comprendre les coutumes locales.
Mais la démesure du nord vous ravit, dans les deux sens du mots, elle vout émerveille, et vous engloutit.
Ces chroniques du Nord sont passionnantes, je les ai lues de bout en bout, absorbée par elles. Lucie Lachapelle y est respectueuse de l’altérité, et tente de raconter un itinéraire singulier, une rencontre.
Grâce à mes « amies » québécoises, je ressens mieux ce que veut dire d’appartenir à une communauté francophone.
Et puis c’était un Québec en novembre… avec avec Karine et Yueyin. Elles me pardonneront si je suis complètement à contretemps car c’est aujourd’hui le jour d’
Anais Barbeau Lavalette que j’ai déjà chroniquée avec « La femme qui fuit »