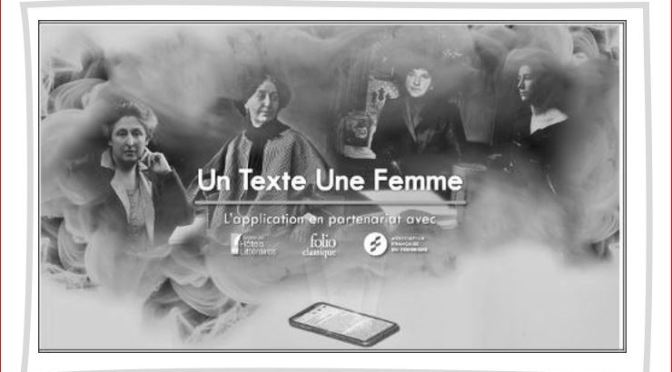Les éditions Talents Hauts mettent en avant le matrimoine littéraire à travers une collection « Les Plumées ». Plumées dans tous les sens du terme, elles l’ont été. D’une part, parce qu’elles ont un incontestable talent et une vraie « plume » et d’autre part, parce qu’elles ont été spoliées de leur postérité ou de leur notoriété et rendues invisibles. Comment juger de la valeur d’une œuvre dans l’Histoire littéraire ? Quels sont les critères qui la rendent digne d’y figurer ? Les œuvres ou les formes qu’elles empruntent ont-elles marqué leur siècle ? De toute évidence, les thématiques, les grands sujets quel que soit le domaine de l’art sont interdits aux femmes jusqu’au XXe siècle, la guerre, la politique, tous les domaines proches du pouvoir. Les femmes ne sont pas vraiment sur les champs de bataille, dans leur majorité, elles sont interdites dans la plupart des métiers, à part ceux où elles sont subalternes, et ne peuvent pas faire d’études supérieures. Julie Victoire Daubié sera la première à obtenir le baccalauréat le 17 août 1861.
Les femmes vont donc employer la stratégie du contournement et s’employer à combattre les difficultés qu’elles rencontrent. Elles vont écrire et, pour certaines, payer très cher, intimement et socialement, cet engagement.
L’éditrice rappelle les différents processus d’invisibilisation auxquels vont avoir à faire les femmes :
- L’effacement : elles sont salonnières, soutiennent et diffusent les idées mais s’effacent derrière leurs protégés.
- L’appropriation : elles participent à l’élaboration d’une œuvre mais n’en retirent aucune reconnaissance.
- Le plagiat : des écrivains célèbres ont copié l’œuvre de leurs contemporaines. Ainsi Voltaire publie-t-il une pièce « Brutus » qui ressemble étrangement à celle de l’autrice Catherine Bernard décédée quelques années plus tôt (autrice reconnue puisqu’elle touchait une pension de Louis XIV). Voir Titiou Lecoq, Les grandes oubliées ou pourquoi l’Histoire a effacé les femmes.
- La stigmatisation :des propos mysogines tournent en dérision les œuvres des femmes en présupposant une sorte de débilité congénitale du sexe féminin. Baudelaire reconnaît le talent de Marcelline Desbordes-Vallemore, pour ensuite le dévaloriser en le cantonnant dans la sphère du féminin.
- La décrédibilisation :les précieuses ridicules, les « bas-bleus » sont autant d’appellations visant à se moquer des femmes qui écrivent. De nombreux dessins satiriques accompagnent ce travail de sape.
- L’intériorisation des interdits et l’autocensure : la place mineure laissée aux femmes est intériorisée par les femmes elles-mêmes. L’anonymat des œuvres , le fait de prendre un pseudonyme masculin manifestent cet auto-censure. Une femme « publique » est l’égale d’une prostituée, elle doit rester dévouée à son mari et ses enfants.
- J’ai commencé à lire dans cette collection et vous en parlerai plus tard.
Voici les œuvres phares dont certaines sont déjà chroniquées ici :
Marguerite Audoux – Marie-Claire
Fanny Raoul – Opinion d’une femme sur les femmes
Félicité de Genlis – La femme auteur


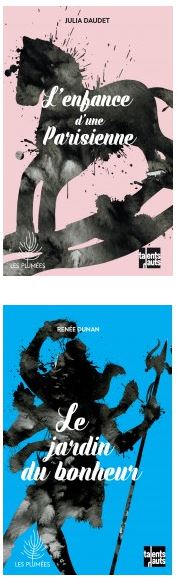


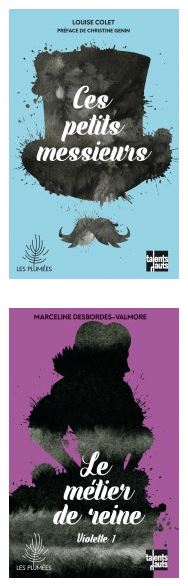


Marie-Louise Gagneur – Trois sœurs rivales
Marguerite Audoux – Marie-claire
Renée Dunan – Le jardin du bonheur
Georges de Peyrebrune – Victoire la Rouge
Félicité de Genlis – La femme auteur
Louise Colet – Ces petits messieurs
Gabrielle-Suzanne de Villeneuve La Belle et la Bête
Camille Bodin – Le monstre
Marceline Desbordes-Valmore La grâce de l’exil
Le métier de reine Violette 1
Charlotte-Adélaïde Dard – Les naufragés de la Méduse
Judith Gauthier – Isoline
Françoise Pascal – Le vieillard amoureux
Julia Daudet – L’enfance d’une parisienne
Fanny Raoul – Opinion d’une femme sur les femmes