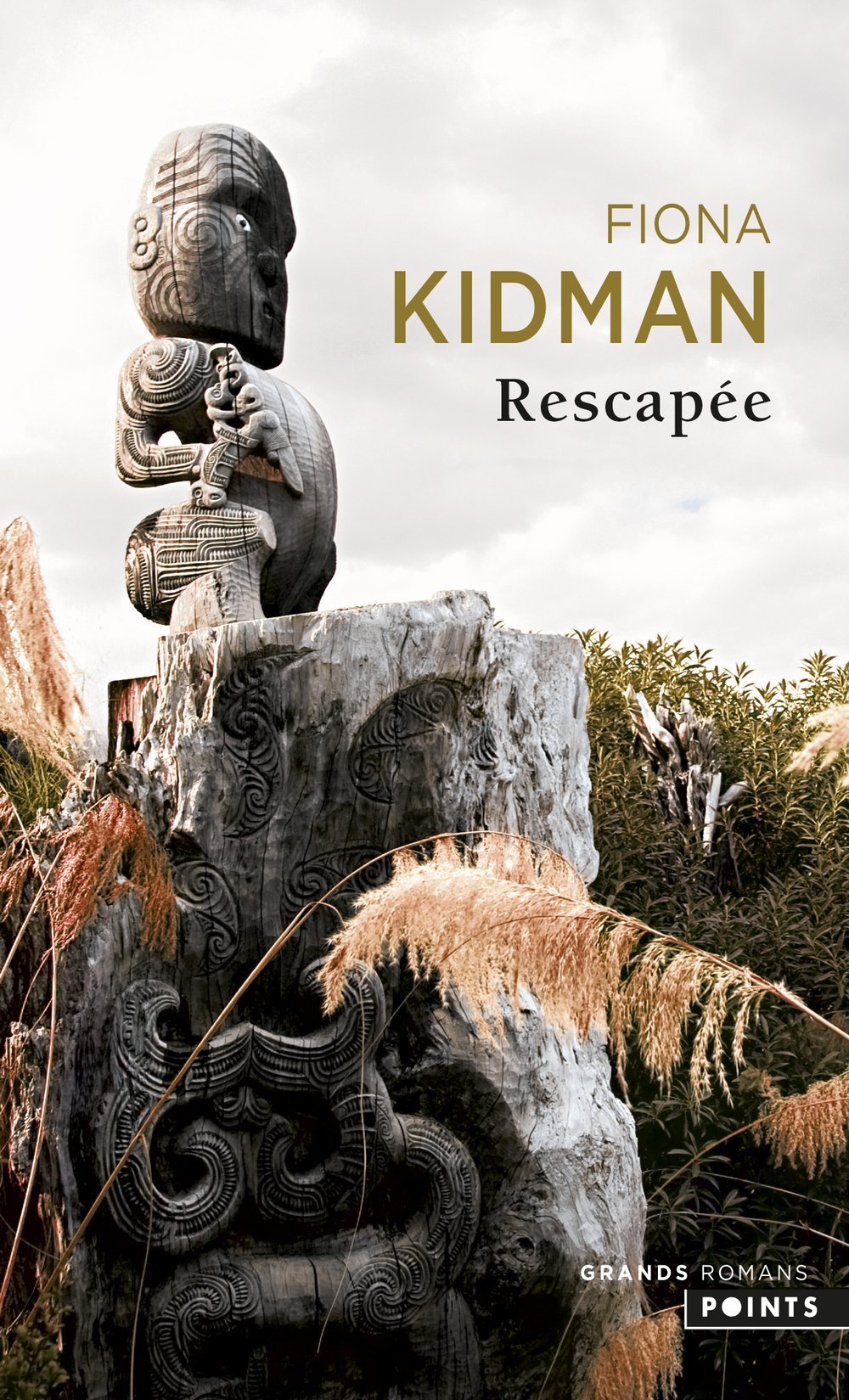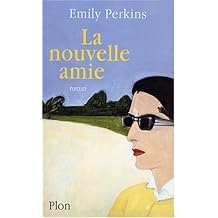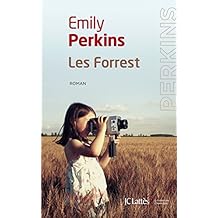On ne peut évoquer une des œuvres de l’auteure Janet Frame (1924-2004) sans rappeler le contexte dans lequel elle a été produite. Diagnostiquée schizophrénique, suite à une tentative de suicide et un diagnostic hâtif, elle a subi quelque deux cents électrochocs, pendant les huit années où elle fut internée en hôpital psychiatrique. Elle a échappé à la lobotomie de justesse grâce à un psychiatre plus avisé que les autres, qui avait su déceler la marque de son génie après la publication en 1951 de son recueil de nouvelles, The Lagoon (1951) qui lui valut de recevoir le Hubert Church Memorial Award.
La littérature fut sa porte de sortie et un havre où elle se sentit toujours en sécurité. Sans creuser davantage sa biographie ici, on peut dire que Janet Frame a dû sa vie à la littérature et qu’une grande partie de son œuvre est autobiographique.
Dans « Vers l’autre été », publié après sa mort, elle prend les traits de Grace Cleave, écrivain néo-zélandaise expatriée en Angleterre. Elle quitte Londres, où elle vit, pour un week-end dans le nord de l’Angleterre chez Philip et Anne Thirkettle et leurs deux enfants.
Elle se rêve brillante causeuse, spirituelle et intelligente. Ils rougiraient de plaisir « devant la beauté de ses phrases ». Mais c’est tout le contraire qui se produit, Grace est mal à l’aise et parle peu. elle ne trouve jamais les mots qu’il faut, hésite, ne finit pas ses phrases, aligne des banalités, accumule les maladresses et mesure toute l’étendue de son inadaptation sociale. « N’étant pas un être humain, Grace avait l’habitude de vivre des moments de terreur quand son esprit questionnait ou réorganisait le rituel établi. »
Elle évite ses hôtes autant qu’elle peut et se laisse aller à ses souvenirs.
Elle a conscience de sa différence et de sa difficulté à communiquer.
« Qu’y avait-il dans son apparence et son comportement qui poussait les gens à tout lui expliquer, à lui parler comme si elle ne comprenait pas ? »
Et comment leur dire qu’elle est un oiseau migrateur ? Ils ne comprendraient pas. Elle glisse de la réalité au rêve avec une facilité ignorée de la plupart des autres humains dont l’imagination est « cantonnée dans une petite pièce sombre sans fenêtre ». La frontière est mince pour celle qui devient au gré de sa fantaisie ou d’une nécessité intérieure fauvette ou bergeronnette, coucou ou pie-grièche…
Comment faire accéder ces Autres à son monde intérieur ? « J’ai prié Oh que le monde se laisse suffisamment émerveiller pour que la vie des poètes lui importe et que leur mort l’attriste. »
De sa nature ailée, elle remonte le flot des souvenirs, de l’enfance où elle était un choucas noir au bec jaune…Puis quand elle fut devenue « bête » solitaire dans l’enclos, séparée du reste des humains. Pourtant les mots étaient là, « empreints de mystère, pleins de plaisir et de peur. ». Elle raconte son enfance, les déménagements successifs, le travail de son père comme conducteur de locomotive, sa mère Lottie et son talent de raconteuse d’histoires, son plaisir à inventer des chansons.
Elle grandit et fait l’expérience du courage qu’il faut « pour affronter l’espace intérieur ou extérieur, pour marcher dressé, pour se déplacer sans soutien, en proie au temps qu’il fait et à son compagnon le temps qui passe .. ».
Comment ne pas être bouleversé par les mots de Janet Frame qui dit notre impuissance et notre pouvoir, notre solitude d’humain toujours en quête de « connexion avec le monde ».
Et peut-être ,comme elle, a-t-on parfois le sentiment qu’on nous a volé quelque chose ou que quelque chose nous a été refusé :
« Que m’a-t-on affreusement volé […]pour que disparaisse de ma vie la capacité d’établir des frontières, de distinguer une personne d’une autre. »
Le texte est parfois ponctué de ces cris qu’il faut réussir à entendre, un cri de femme , de poète alors qu’on la voudrait poétesse (n’est-elle pas qu’une femme), « un mot qu’on pulvérise comme du désherbant sur la personne et le travail d’une femme qui écrit de la poésie – beaucoup ont été ainsi « endormies » ; c’est sans douleur, nous assure-t-on, [..]. »
En filigrane se dessinent les interrogations qui la hantent à ce moment-là de sa vie, en 1963, comment revenir en Nouvelle-Zélande alors qu’on l’ a déclaré folle et internée pour ensuite lui conseiller de « vendre des chapeaux », comment revivre l’autre été, celui qu’elle a vécu sur l’île qui l’a vue naître, et comment vivre en Angleterre, ce pays sombre, triste et froid. Il lui est autant impossible de vivre ailleurs que de retourner chez elle tant qu’elle n’est pas, peut-être un écrivain reconnu.
Il faut lire Janet Frame, un des plus grands écrivains néo-zélandais, proposée deux fois pour le Nobel qui certainement aurait pu s’enorgueillir de l’avoir en son sein.