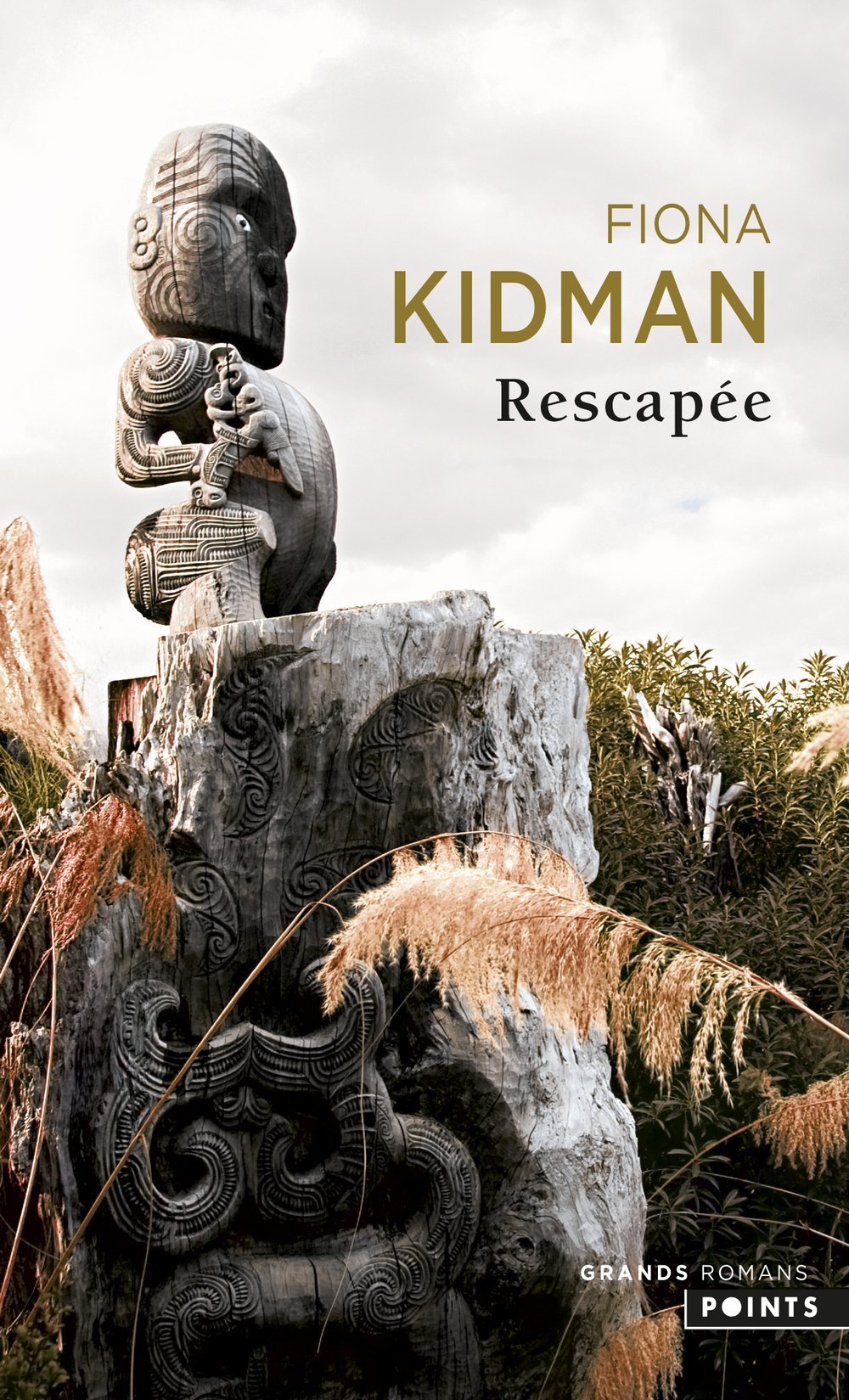Erin Hortle – L’Octopus et moi (2020), Editions Dalva, 2021, pour l’édition française.
Avec ce premier roman, les éditions Dalva pour l’édition française et Erin Hortle, l’autrice, opèrent un véritable coup de maître.
Qu’est-ce que le féminin ? Posséder des seins, et un appareil génital qui vous permet d’enfanter ? Où le désir se niche-t-il ? La souffrance et la mort nous relient à notre profonde animalité, à ce lieu en nous, où n’existe aucun mot, mais où la pensée est mouvement, s’opérant par de doux balancements, de joyeux bondissements, ou de terribles rugissements lorsque la douleur ou la mort éprouvent notre instinct de vie et de conservation.
« Je laisse mon corps flotter d’avant en arrière et d’arrière en avant et d’arrière en arrière dans les courants les vagues qui bouillonnent tourbillonnent tout autour de moi. »
Dans le monde animal , les pieuvres femelles défendent leurs œufs jusqu’à la mort. Elles les couvent parfois pendant de longues années et meurent ensuite, exténuées, à leur éclosion.
Ce roman est l’histoire d’une rencontre, entre une pieuvre qui cherche à rejoindre l’Océan Pacifique pour y pondre ses œufs et une femme, meurtrie dans son corps et son esprit par de terribles épreuves. Une rencontre aux portes de la mort.
Le style est puissant et réussit à traduire une approche profondément sensuelle, le lecteur ou la lectrice vois-goûte-touche de concert avec la pieuvre et se laisse porter par les mouvements des flots.
Nous ne sommes pas séparé.e.s du monde animal, il fait écho en nous au plus primitif, au plus primordial, dans le bouillonnement de notre sang et les flux du monde qui nous traversent et avec lesquels nous nous entretissons.
Ce roman est profondément original, il fait commencement. Tricoter des seins pour se réparer n’est pas la moindre des surprises que vous y trouverez. Vous ferez connaissance aussi avec les tribulations d’un jeune phoque.
Autour de vous, la Tasmanie, et l’Océan, profondément sauvage, dont le cœur battra avec le vôtre. Un étonnant voyage…
C’est l’observation d’un étrange phénomène de migration des pieuvres qui a servi de point de départ à ce roman, « prétexte à une réflexion sur la manière dont s’enchevêtrent parfois les vies des hommes et celles des animaux. »