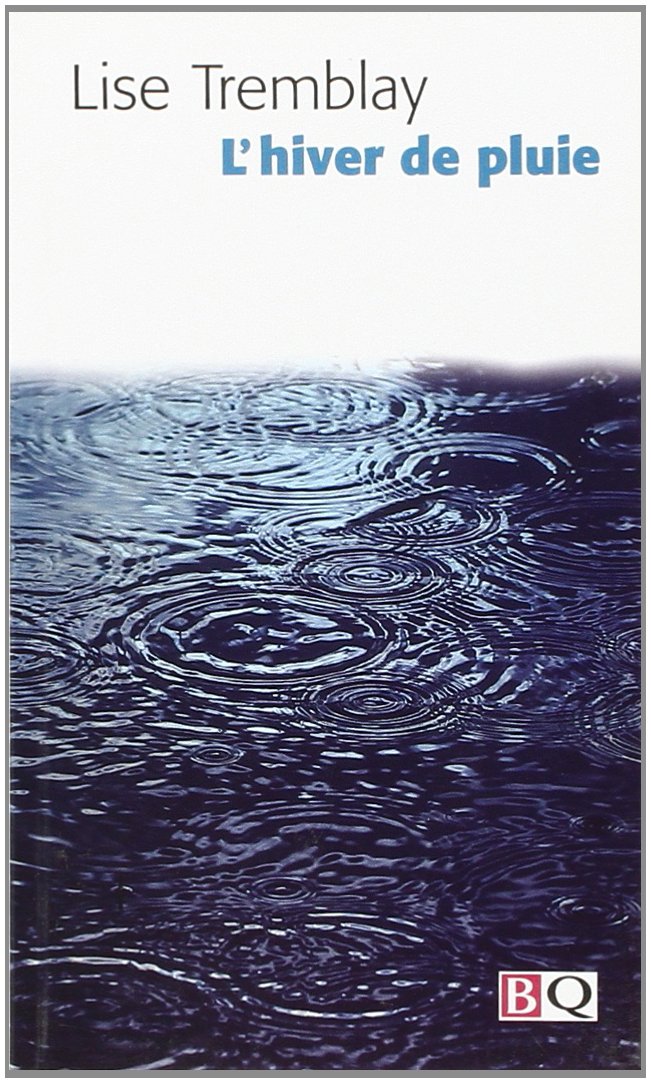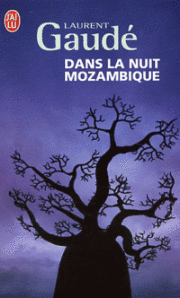Printemps , 1914
Née en 1882, Sigrid Undset s’est consacrée très tôt à la littérature. Parallèlement à son travail de secrétaire, elle écrit. Auteure entre autres de Maternités, Jenny (qui fera scandale), de Vigdis la Farouche et de Kristin Lavransdatter, elle a reçu le prix Nobel de littérature en 1928. Elle est morte à Lillehammer en 1949.
Rose Wegner, l’héroïne de ce roman, attend l’amour pour être révélée à elle-même, un amour qui serait la fusion de deux êtres autant que deux destins et qui ferait d’elle la possession, la chose, de l’homme qu’elle aimerait. Que faire alors si cet amour ne vient pas ? Se résigner, et rester seule, sans famille et sans soutien dans l’existence ? Ou se contenter d’une amitié amoureuse et de la construction d’un foyer ?
Dans ce roman, Sigrid Undset plante le cadre d’une modernité héritée de la révolution des transports et plus largement de la révolution industrielle-dans de grandes villes mornes et tristes- et d’une certaine révolution des mœurs, car le divorce est autorisé en Norvège, pays protestant. Une nouvelle figure féminine émerge, qui travaille pour assurer sa subsistance et celle de sa famille même si, une fois mariée, elle réintègre le plus souvent le foyer.
Printemps est un roman ou curieusement la narration est plutôt du côté masculin même si le narrateur est extérieur à l’histoire et qu’il pénètre de manière égale les pensées des personnages. Les pensées et les actions de Rose ne prennent du relief qu’en fonction des pensées de Torkild, personnage masculin. Car ici , la femme ne prend toute sa mesure que dans son rapport au foyer et à la maternité. Elle n’existe pas réellement en dehors de sa « vocation naturelle » qui est d’enfanter et d’assurer la stabilité du foyer. Toute femme qui s’écarte de ce chemin sombre dans la déchéance (le personnage de la mère et de la sœur), tout comme celle qui n’obéit pas à ses devoirs d’épouse et de mère même si l’homme, infidèle, abandonne lui, le foyer (le père de Torkild).
J’ai apprécié ce roman bien construit, où les sujets de réflexion ne manquent pas, car Sigrid Undset, catholique et conservatrice, est aussi une fine analyste des sentiments humains. On y apprend aussi comment hommes et femmes vivaient à l’époque. J’ai trouvé en outre un écho au mouvement naturaliste en littérature, l’hérédité y est évoquée, les tares familiales ainsi que la vigueur, la santé du corps qui s’étiole dans ces emplois de bureau, loin de la vie au grand air.
Sigrid Undset, on l’a bien compris, n’est pas féministe, elle pense que la femme ne s’épanouit pleinement que dans la maternité et elle ne fut pas très appréciée des féministes de son temps qui prônaient l’affranchissement de la tutelle de l’homme et du foyer, entraves à l’épanouissement de la femme en tant qu’individu. Sur le tard cependant, elle reconnut les bénéfices de ces mouvements sur la condition des femmes.
Il faut savoir qu’en 1840, les femmes célibataires sont mineures toute leur vie et peuvent si elles le souhaitent se placer sous l’autorité d’un tuteur ; les femmes mariées quant à elles passent de l’autorité de leur père à celle de leur mari. Puis, plus tard, la majorité sera abaissée à la vingt-cinquième année. Les femmes peuvent cependant travailler dans certains secteurs.
Au fil des ans, de nouvelles lois favorables aux femmes feront leur apparition. Les femmes divorcées ou veuves seront majeures sans condition d’âge. Les conditions socio-économiques du pays joueront fortement sur les problématiques féminines : l’exil, la pauvreté du pays, la baisse de la natalité.
Dans le roman , l’héroïne est secrétaire, une autre est journaliste. La littérature féminine avant Sigrid Undset, reflète les préoccupations et les valeurs de l’époque, comme ce fut le cas pendant l’époque victorienne en Angleterre, les intrigues se nouent essentiellement autour de la chasse au mari. (Les femmes écrivains de l’époque sont :Hanna Winsnes, Marie Wexelsen, et Anne Magdalene Thoresen).
Avec le mouvement féministe, de nouvelles préoccupations se font jour dans des romans et sous la plume d’auteures qui contestent la norme : Camilla Collet dont le roman « Les filles du Préfet » (1854) fera l’effet d’un coup de tonnerre. Il raconte l’initiation sentimentale de deux jeunes gens, ce qui a l’époque est regardé alors comme une faiblesse uniquement féminine.
D’autres écrivains suivront, emportées par la seconde vague du féminisme, Eldrid Lunden, Liv Køltzow, Cecilie Løveid et Tove Nielsen . Mais je n’ai trouvé aucun renseignement sur ces femmes sur internet et aucun de leurs ouvrages traduits en français. C’est bien dommage..
Article passionnant sur l’histoire des femmes de lettres norvégiennes