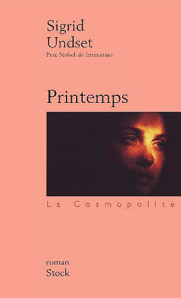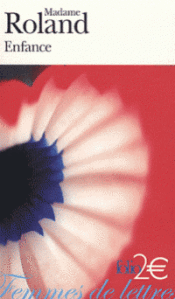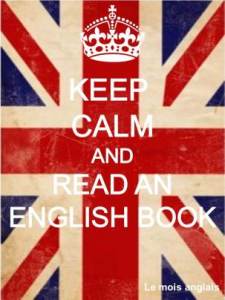Charlotte Perkins Gilman – La séquestrée (Titre original : The yellow wallpaper)
 Texte fondateur, livre-culte de la littérature écrite par les femmes, « La séquestrée » a la force d’un manifeste, devenu un classique des lettres américaines. Écrit en 1870, il dénonce l’asservissement des femmes à un modèle patriarcal qui les enferme dans leur fonction naturelle de reproduction, la maternité, et leur interdit toute vie de l’esprit.
Texte fondateur, livre-culte de la littérature écrite par les femmes, « La séquestrée » a la force d’un manifeste, devenu un classique des lettres américaines. Écrit en 1870, il dénonce l’asservissement des femmes à un modèle patriarcal qui les enferme dans leur fonction naturelle de reproduction, la maternité, et leur interdit toute vie de l’esprit.
La neurasthénie dont souffraient nombre de femmes au XIXe siècle et les dépressions les plus graves étaient souvent dues à un sentiment d’enfermement et d’étouffement lié aux rôles sociaux étroits dans lesquels elles étaient maintenues. Les femmes mouraient d’ennui et de mélancolie parce qu’elles ne pouvaient pas exprimer leur énergie créatrice ou la vie de leur esprit. Les méthodes souvent barbares par lesquelles on tentait de guérir leur dépression aggravaient encore la maladie puisqu’on condamnait les femmes à l’inaction, au « repos », à la solitude et à l’enfermement. Les dérivatifs qui leur auraient permis de se changer les idées leur étaient interdits. Cette thérapie est celle du Dr Mitchell : « Il fallait confiner ses patients, les mettre au lit, les isoler loin de leur famille, loin aussi de leurs lieux familiers, les gaver de nourriture, notamment de crème fraîche, car l’énergie dépend d’un corps bien nourri, enfin les soigner par des massages et des traitements électriques destinés à compenser la passivité nécessaire à cette cure de repos. »
Il faut avouer que cette cure n’était pas seulement réservé aux femmes, puisque Henry James la subit lui-même en 1910, et faillit se jeter par la fenêtre.
Revendiquer des droits égaux, vouloir faire une carrière d’écrivain ou d’intellectuelle pouvait se payer très cher, puisque les femmes risquaient être mises au ban de la société et devaient, en outre, renoncer pour la plupart à une vie affective. Le choix était plutôt cornélien, car dans un cas comme dans l’autre, les femmes souffraient et devaient sacrifier une partie de leur être.
« La séquestrée » est le cri silencieux d’une femme, son basculement dans la folie. Souffrant d’une dépression post-partum , elle doit se reposer. Enfermée dans sa chambre, condamnée à l’inactivité, elle regarde jour après jour le papier peint qui peu à peu, « vision d’horreur » s’anime d’une vie propre jusqu’à figurer une femme rampant derrière le motif et tentant de s’échapper. La souffrance psychique est intense, et parfaitement décrite: « Il vous gifle, vous assomme, vous écrase. » écrit-elle parlant du papier peint. Elle devient également paranoïaque et sent une invisible conspiration autour d’elle. Cette femme n’est qu’un double d’elle-même qui tente de fuir ce terriblement enfermement jusqu’au dénouement final.
Il faut souligner la force littéraire de cette longue nouvelle, son intensité dramatique, la maîtrise parfaite de l’écriture : un souffle, un cri. Un chef-d’œuvre…