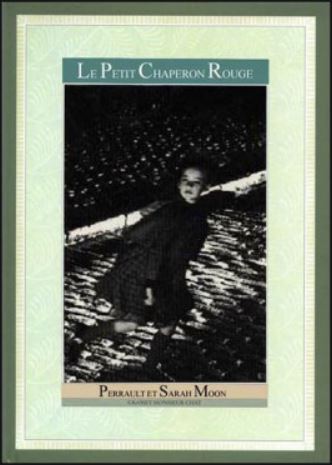D’où est partie l’écriture de ce texte ?
J’ai commencé des recherches sur la guerre d’Algérie par la lecture de lettres de soldats écrites à leur marraine de guerre.
Et puisque le théâtre interroge la forme, je me suis posée la question de savoir comment me servir de ces kilomètres de lettres lues pendant des mois.
L’histoire apparaît comme un territoire où se définit la vie et la mort : tout d’abord, on ne sait pas où l’on est – un peu comme si les personnages nous plongeaient dans un lieu unique -, et par leur chuchotement, leurs témoignages, la révélation de leur histoire, ils nous font entrer dans leur univers.
Plus l’écriture avançait plus le besoin de jouer entre l’avant de la scène et l’arrière de la scène se sont imposées dans mon imaginaire, et idée de proche-lointain m’a permis de raconter l’histoire avec différents niveaux de langages, passant du « je » au « nous.
Les personnages qui apparaissent au fil du texte sont tous solidaires les uns des autres. Aucun n’est un électron libre. Ils participent tous de la réalité de l’autre.
Et au fil du temps, les questions de la place de « l’intime» et du «communautaire », se sont agencées jusqu’à ce que l’histoire des deux amoureux se définisse.
Les intentions d’écriture
Le corps est morcelé au rythme de l’écoulement de longs mois de cette guerre. Il est abasourdi, au ras du sol. Il ne marche pas, il rampe. L’identité a besoin de se raccrocher à du solide, de se demander plus que jamais :
« Qui suis-je ? »
La question a été de concilier, au travers des lettres réinventées, les moments de guerre.
Par petits bouts, le corps se définit mais jamais entièrement. Le soldat est pris au dépourvu. Quand il fuit, ce sont ses jambes et ses pieds, les plus importants, et puis vient son ventre quand il crie, quand il souffre, sa tête aussi quand il cherche ou traque son ennemi ou est traqué lui-même.
Pour le soldat, la première chose qui lui vient à l’esprit, c’est laisser parler son corps qui souffre, qui a chaud, qui respire mal, qui a froid, qui ne comprend pas…
La clarté du désert jusqu’à l’aveuglement du soldat. : Le moment où il paraît en pleine lumière, c’est le moment où il est aveuglé par sa propre démesure. Et cette question lui revient en plein visage :
« Que sommes-nous venus chercher ici, à part notre propre errance ? »
Dans la mort, on s’en va par morceaux, les organes s’affaiblissent jusqu’à devenir silencieux, le cœur ne bat plus, les poumons ne respirent plus… La mère du garçon qui a grandi aussi aura à mener ce combat-là.
Dans ce texte le temps est étiré. Des personnages oscillent entre vie et mort :
La marraine de guerre s’efface pour laisser la place à la femme du soldat ; la femme devient la mère du garçon qui a grandi, puis meurt ; les soldats, pour certains, flirtent avec la mort avant de devenir des hommes. Certains la côtoient, d’autres s’éteignent.
Tous, sauf le garçon qui a grandi, se sont effacés peu à peu.
Les lettres ont le pouvoir de faire revivre un temps les êtres qui ont disparu. J’ai donc recomposé des lettres à partir de bouts de vies. La forme épistolaire employée comme forme dramaturgique. A travers cette forme-là, j’ai pu donner la parole aux morts et aux vivants, le temps de l’écriture de cette pièce.