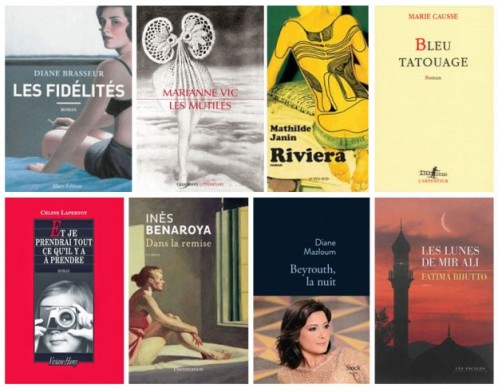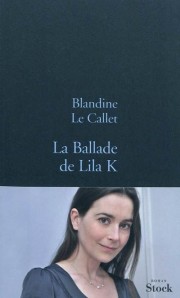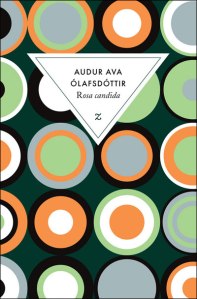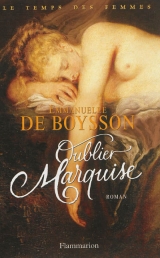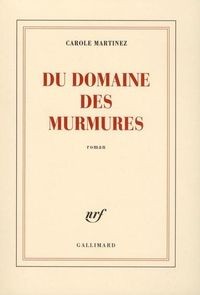Il faudrait pouvoir écouter ce roman comme une musique, entendre les voix qui le traversent comme autant de chants qui montent des profondeurs de l’être, voix d’hommes et de femmes qui se marient dans cet oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach.
Göran Tunström disparu le 05 février 2 000 à l’âge de 62 ans mérite de figurer parmi les Immortels.
Solveig, soprano qui doit chanter dans l’Oratorio de Noël à Sunne, n’arrivera jamais à destination. Les destins de son mari Aron, de son fils Sidner, puis de son petit-fils Victor vont se déployer, s’orchestrer à la manière d’un Oratorio dans un récit ample et polyphonique. Selon l’encyclopédie La rousse, « Les traits dominants des oratorios allemands restent […]la prééminence du commentaire sur l’action, l’intériorisation du drame vécu par la conscience du chrétien. »
A l’origine du drame est ce chant qui n’aura pas lieu, cette femme qui ne parviendra pas a délivrer son chant, et dont la voix féminine sera sans cesse reprise dans un motif subissant à chaque fois d’importantes variations : Fanny que ses rêves tiennent loin de la vie et de l’amour, Tessa qui « a lu trop de livres » que des espoirs démesurés conduiront à la folie.
Les hommes dans ce livre sont tout attente, car « Pour Aron tout avait été fermé avant qu’il la rencontre, le monde n’avait pas voulu de lui. […] Il l’avait vue forcer les choses une par une, les rendre riches, étincelantes de significations. Il s’était installé dans le monde des mots. »
Les femmes sont des initiatrices qui donnent leurs rêves aux hommes : « Pour le rêve de Fanny il était devenu père. Pour le rêve de Tessa, il avait appris l’anglais et atterri à l’autre bout de la terre ». Les femmes sont celles dont les mots font advenir des mondes.
Sidner au désespoir confie à son journal : « Parmi toutes les voix qui parlent en moi, je reconnais parfois la mienne. Elle est néanmoins encore si faible et fatiguée d’essayer de se faire entendre au milieu du vacarme que soulèvent les autres. Je me suis vendu au sommeil et au silence. »
Qu’est-ce que l’amour, sinon « une conversation possible »? Tessa qui rêve d’entamer cette conversation pour la première fois avec un homme, sent que « Les mots gonflent, enflent dans ma bouche »
Et Selma Lagerlöf figure tutélaire de son livre, vieille déjà, confie :
«Tu voulais savoir comment c’est d’écrire un livre. C’est fatiguant! C’est comme s’obliger à traverser un désert: de longues étapes sans une seule goutte d’eau, sans un arbre sous lequel se reposer. Puis tu arrives dans une oasis : le langage coule à flots, chaque feuille s’ouvre, tout veut devenir poésie. Écoute-les, elles chantent maintenant! Et le stylo vole sur le papier, tu te retrouves dans une sorte de tropiques des sentiments. Et pense à tout ce qu’un seul être saisit avec ses yeux, à combien chacun de ses gestes est chargé de passé, d’un avenir inconnu, et à cette fragilité douloureuse que peut être celle du présent: comme une fragile touffe de linnée boréale coincée entre deux rochers en mouvement.»
J ne sais si quelqu’un lira cet article jusqu’au bout mais il me semble utile de répéter que la langue de Göran Tunström traduite par Marc de Gouvenain et Lena Grumbach est une musique, la plus belle qui soit…
J’avais dédié cet article en son temps de publication à Anne du blog « Des mots et des notes » pour son challenge « Voisins/voisines ».