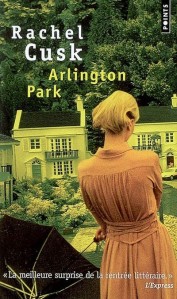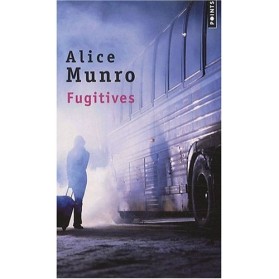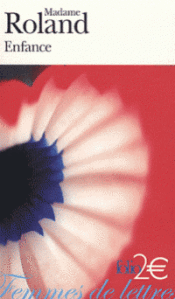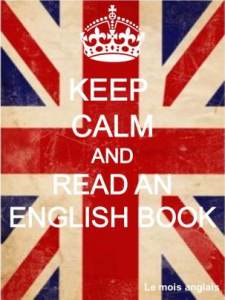Diane brasseur – Les fidélités – Allary Editions 2014
A Marseille où il vit une partie du temps avec sa femme et sa fille, un homme s’enferme dans son bureau pour réfléchir. Sa vie a pris des directions inattendues et menace de lui échapper tout à fait. Il a cinquante-quatre ans et il doit partir à New York fêter Noël en famille. Il est face à un dilemme qu’il doit absolument résoudre avant qu’un drame ne se produise.
Il laisse Alix à Paris. Il la connaît depuis un an et passe la semaine avec elle. Il l’aime. Le week-end, il rentre à Marseille retrouver la femme qu’il aime et qu’il a épousée.
Diane Brasseur exploite un thème mille fois rebattu sous un angle assez neuf et parvient à éviter les clichés du triangle amoureux. Cet homme n’est pas malheureux mais il aime simplement deux femmes sur un tempo tout à fait différent. L’amour passion alterne avec l’amour tendresse .
La vie contemporaine lui laisse des espaces qui n’existaient pas autrefois : mobilité professionnelle, et portable. Dans la sphère privée qui était auparavant plus transparente, les nouveaux moyens de communication ont créé des sortes de bulles où l’individu peut aménager à loisir d’autres espaces beaucoup plus opaques. Une nouvelle passion permet de rompre la routine et l’ennui de la vie conjugale. Mais elle demande aussi de devenir maître dans l’art du mensonge.
Diane Brasseur met l’accent sur l’aspect schizophrénique qu’induit la double vie, car le narrateur ne trompe personne, il est fidèle à chacune des femmes qu’il aime. Elles ne sont qu’un simple écho à une dualité intérieure. Elles ne sont pas rivales mais se complètent en quelque sorte. Elle sait introduire une tenson dramatique et du suspense dans son récit en lui donnant une dimension de thriller psychologique. Jusqu’au bout on se demande ce qu’il va faire.
L’originalité de ce récit consiste à se mettre dans la tête d’un homme amoureux et de tenir jusqu’au bout un monologue intérieur qui soit crédible.
Lorsqu’il imagine rompre avec Alix, il fait la liste de tout ce qu’il ne fera plus avec elle « Ne plus la voir et ne plus la toucher, ne plus la faire rire, ne plus me dire : « Il faudra que je lui raconte » ou « Cela lui plaira », ne plus regarder mon téléphone pour voir si elle a essayé de me joindre…. »
En quelques phrases, avec une étonnante simplicité, l’auteure livre la quintessence du sentiment amoureux . Face à la perte, peut-être hommes et femmes sommes-nous semblables.
Elle dit l’effroyable douleur d’une rupture, d’autant plus effroyable qu’elle est banale, tellement banale aujourd’hui.
Ce qui fait de ce narrateur un homme est peut-être la référence constante au désir, au corps et à la proximité physique. On ne voit pas vraiment ce qui le lie vraiment à aucune de ces femmes sur le plan des valeurs, ou d’une entente qui serait basée davantage sur une intimité philosophique et spirituelle. En tout cas, je ne l’ai pas ressenti. Et ce qui est assez drôle et rusé de la part de la romancière est qu’elle imagine un homme qui imagine ce que peut penser une femme, ce que veut une femme qui est Alix. Construire, des enfants…
J’ai dévoré ce livre, et je l’avoue, cet homme m’a passablement tapé sur les nerfs, non à cause de ses infidélités, mais à cause de la manière dont il pense que sa maîtresse pense à sa femme par exemple. A cause aussi d’une certaine insensibilité, on pourrait penser qu’une vitre épaisse le sépare de la réalité. Et aussi cette fausse empathie…
Un bon roman qui méritait bien d’être dans la sélection 2014, qui a eu un beau succès critique. Une romancière est née, incontestablement…
Diane Brasseur est franco-suisse. Née en 1980, elle a grandi à Strasbourg et fait une partie de sa scolarité en Angleterre. Après des études de cinéma à Paris, elle devient scripte et tourne, entre autres, avec Albert Dupontel, Olivier Marchal et Abd Al Malik. Elle habite à Paris.