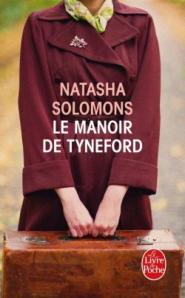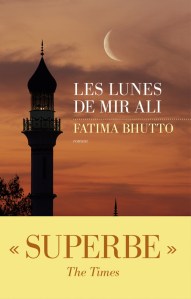Yannis Ritsos est né en Grèce, le 1er mai 1909, dans une famille de propriétaires terriens. Sa jeunesse est marquée par la ruine économique, des drames familiaux et de longs séjours en sanatorium. Proche du parti communiste grec, il associe la poésie à l’engagement politique et lie l’héritage du surréalisme aux forces vives de la culture populaire. Ses combats contre la droite fasciste, la prison, l’exil ne l’empêchent pas de mener à bien une oeuvre de premier ordre. il s’éteint en 1990. Ce recueil est le troisième publié par les éditions Bruno Doucey.
Biographie plus complète
Le chant de ma sœur édition bilingue Collection « En résistance » traduit du grec par Anne Personnaz, préface de Bruno Doucey, en librairie à partir du 02 mai.
Dans une belle préface, Bruno Doucey présente ce recueil d’un poète engagé qui à l’heure où sa sœur malade est internée à l’asile psychiatrique de Daphni, écrit ce long poème afin de conjurer la maladie, détourner le mauvais sort et infléchir le destin par la seule force de la poésie et de l’amour.
« Ceux qui aiment l’œuvre de Yannis Ritsos savent que la poésie, comme l’amour, possède une formidable capacité d’intervention dans la réalité. Loula sortira guérie de l’asile psychiatrique. »
Si l’on en juge par la beauté et la force des images, que le français ne semble pas altérer, alors l’écriture de Yannis Ritsos peut sans nul doute accomplir de tels prodiges. La lecture opère le même miracle, en nous, lecteurs, de nous faire ressentir la puissance de ce rayonnement.
Devant cette sœur tant aimée, qui fut son seul secours, à la mort de sa mère et après l’internement de son père dans un « asile » psychiatrique « tandis que les nuits bleues s’immobilisent recueillies en pleurant des étoiles », le poète s’agenouille : il n’est plus qu’« une fourmi meurtrie qui a perdu son chemin dans la nuit infinie ». Car elle est sainte, « ombre de la sainte vierge »,et possède d’ailleurs cette « aura de sainte » et un cœur capable de l’abnégation la plus totale.
« Tu ne savais qu’offrir,
Tous tes cadeaux
Tu les partageais
Et tes paumes
Son demeurées vides »
Elle est sa mémoire, le seul témoin fiable de son existence et la main sûre qui le guide, lui insufflant la force et le réconfort au milieu des combats :
« Quand je rentrais fléchi
par mes errances nocturnes
et par la morgue amère de l’isolement,
je trouvais le souper de l’amour
fumant sur la table
et la mémoire de l’enfance
-frêle papillon,
folâtrait autour de ta lampe.
Tu veillais
Attendant mon retour.
Et quand moi,
L’amant de l’Infini,
Je m’enfonçais dans les ombres
Et dans les doutes de l’éther,
Toi
D’un doigt chaleureux
A nouveau tu me montrais les traces sur le chemin
Je n’étais plus que cendre
Et tu recréais une forme humaine. »
Cette sœur dont l’amour le conduit à « entendre le pouls de l’humanité » en elle, lui apprend à aimer les Hommes, ses frères. En son cœur singulier, il apprend l’universel dans une fusion du sentiment et de l’éthique.
La figure du Christ apparaît, messianique : « de mes larmes, je lave vos pieds meurtris »
« Semblable au Christ sans paroles
j’entendais la trompette des cieux »
Avec ses seuls armes, lle poète devient « un simple grillon/qui pour toi chantera/les nuits de printemps. » Il accepte de descendre au royaume des morts (image d’Eurydice), accueille en lui la détresse et la souffrance de celle qui reste « les mains liées dans le dos » pour remonter vers la lumière.
Le poète de promettre alors :
« Et moi qui n’eus pas la force
de te sauver de la vie,
je te sauverai de la mort. »
J’ai comme émergé moi aussi de cette lecture, émue jusqu’au plus profond de mon être. Chacun aura sa lecture mais nul doute que l’émotion sera au rendez-vous. Et autre chose aussi de plus têtu et de plus tenace.
Laissons entendre toutefois celle de Bruno Doucey :
«[…] le poète compose ce texte empreint d’humanité et de tendresse au moment où sa sœur Loula traverse les heures les plus sombres de sa vie. Il y évoque la folie qui ravage cette petite compagne de l’enfance, se souvient de l’âge édénique où elle le réconfortait, écrit pour conjurer la peur et exorciser le mal. Par ce texte, né en pleine dictature, Yannis Ritsos se montre également solidaire de « tous les hommes affligés qui passent en silence ». Il sait que personne ne répond aux suppliques des peuples défaits , mais il chante. Et ce chant ouvre la nuit aux lueurs de la fraternité. »
Je remercie les éditions Bruno Doucey pour cette petite merveille.Yannis Ritsos est né en Grèce, le 1er mai 1909, dans une famille de propriétaires terriens. Sa jeunesse est marquée par la ruine économique, des drames familiaux et de longs séjours en sanatorium. Proche du parti communiste grec, il associe la poésie à l’engagement politique et lie l’héritage du surréalisme aux forces vives de la culture populaire. Ses combats contre la droite fasciste, la prison, l’exil ne l’empêchent pas de mener à bien une oeuvre de premier ordre. il s’éteint en 1990. Ce recueil est le troisième publié par les éditions Bruno Doucey.
Biographie plus complète
Le chant de ma soeur édition bilingue Collection « En résistance » traduit du grec par Anne Personnaz, préface de Bruno Doucey, en librairie à partir du 02 mai.
Dans une belle préface, Bruno Doucey présente ce recueil d’un poète engagé qui à l’heure où sa sœur malade est internée à l’asile psychiatrique de Daphni, écrit ce long poème afin de conjurer la maladie, de détourner le mauvais sort et d’infléchir le destin par la seule force de la poésie et de l’amour.
« Ceux qui aiment l’œuvre de Yannis Ritsos savent que la poésie, comme l’amour, possède une formidable capacité d’intervention dans la réalité. Loula sortira guérie de l’asile psychiatrique. »
Si l’on en juge par la beauté et la force des images, que le français ne semble pas altérer, alors l’écriture de Yannis Ritsos peut sans nul doute accomplir de tels prodiges. La lecture opère le même miracle, en nous, lecteurs, de nous faire ressentir la puissance de ce rayonnement.
Devant cette sœur tant aimée, qui fut son seul secours, à la mort de sa mère et après l’internement de son père dans un « asile » psychiatrique « tandis que les nuits bleues s’immobilisent recueillies en pleurant des étoiles », le poète s’agenouille : il n’est plus qu’« une fourmi meurtrie qui a perdu son chemin dans la nuit infinie ». Car elle est sainte, « ombre de la sainte vierge »,et possède d’ailleurs cette « aura de sainte » et un cœur capable de l’abnégation la plus totale.
« Tu ne savais qu’offrir,
Tous tes cadeaux
Tu les partageais
Et tes paumes
Son demeurées vides »
Elle est sa mémoire, le seul témoin fiable de son existence et la main sûre qui le guide, lui insufflant la force et le réconfort au milieu des combats :
« Quand je rentrais fléchi
par mes errances nocturnes
et par la morgue amère de l’isolement,
je trouvais le souper de l’amour
fumant sur la table
et la mémoire de l’enfance
-frêle papillon,
folâtrait autour de ta lampe.
Tu veillais
Attendant mon retour.
Et quand moi,
L’amant de l’Infini,
Je m’enfonçais dans les ombres
Et dans les doutes de l’éther,
Toi
D’un doigt chaleureux
A nouveau tu me montrais les traces sur le chemin
Je n’étais plus que cendre
Et tu recréais une forme humaine. »
Cette sœur dont l’amour le conduit à « entendre le pouls de l’humanité » en elle, lui apprend à aimer les Hommes, ses frères. En son cœur singulier, il apprend l’universel dans une fusion du sentiment et de l’éthique.
La figure du Christ apparaît, messianique : « de mes larmes, je lave vos pieds meurtris »
« Semblable au Christ sans paroles
j’entendais la trompette des cieux »
Avec ses seuls armes, lle poète devient « un simple grillon/qui pour toi chantera/les nuits de printemps. » Il accepte de descendre au royaume des morts (image d’Eurydice), accueille en lui la détresse et la souffrance de celle qui reste « les mains liées dans le dos » pour remonter vers la lumière.
Le poète de promettre alors :
« Et moi qui n’eus pas la force
de te sauver de la vie,
je te sauverai de la mort. »
J’ai comme émergé moi aussi de cette lecture, émue jusqu’au plus profond de mon être. Chacun aura sa lecture mais nul doute que l’émotion sera au rendez-vous. Et autre chose aussi de plus têtu et de plus tenace.
Laissons entendre toutefois celle de Bruno Doucey :
«[…] le poète compose ce texte empreint d’humanité et de tendresse au moment où sa sœur Loula traverse les heures les plus sombres de sa vie. Il y évoque la folie qui ravage cette petite compagne de l’enfance, se souvient de l’âge édénique où elle le réconfortait, écrit pour conjurer la peur et exorciser le mal. Par ce texte, né en pleine dictature, Yannis Ritsos se montre également solidaire de « tous les hommes affligés qui passent en silence ». Il sait que personne ne répond aux suppliques des peuples défaits , mais il chante. Et ce chant ouvre la nuit aux lueurs de la fraternité. »
Je remercie les éditions Bruno Doucey pour cette petite merveille.
 Natasha Solomons puise encore une fois dans l’histoire familiale pour raconter cette histoire. Le motif est le même que celui de « Jack Rosemblum rêve en anglais ». Le nazisme se répand dans l’Europe des années 30, et la persécution des juifs a commencé. 1938. L’Anschluss. Hitler annexe l’Autriche et ceux qui le peuvent fuient à l’étranger, la guerre n’est pas encore déclarée en 1938 malgré les provocations d’Hitler. Mais pour les candidats, c’est un véritable parcours du combattant, pots de vin, attente interminable, vexations de toutes sortes sont le lot de ceux qui sont à la merci de ce pouvoir corrompu qui ne dit pas encore tout à fait son nom.
Natasha Solomons puise encore une fois dans l’histoire familiale pour raconter cette histoire. Le motif est le même que celui de « Jack Rosemblum rêve en anglais ». Le nazisme se répand dans l’Europe des années 30, et la persécution des juifs a commencé. 1938. L’Anschluss. Hitler annexe l’Autriche et ceux qui le peuvent fuient à l’étranger, la guerre n’est pas encore déclarée en 1938 malgré les provocations d’Hitler. Mais pour les candidats, c’est un véritable parcours du combattant, pots de vin, attente interminable, vexations de toutes sortes sont le lot de ceux qui sont à la merci de ce pouvoir corrompu qui ne dit pas encore tout à fait son nom.