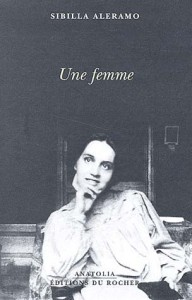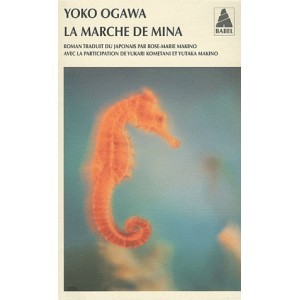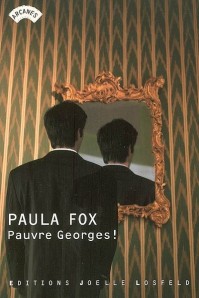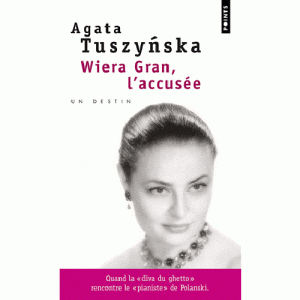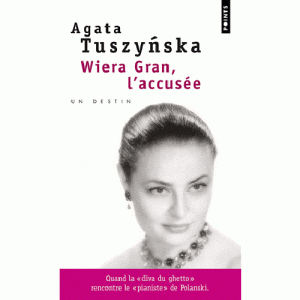
Agata Tuszyńska – Wiera Gran, l’accusée, 2010, 2011, Editions Grasset & Fasquelle pour la traduction française. Traduit du polonais par Isabelle Jannès-Kalinowski
Romancière, poète, biographe, universitaire, journaliste et femme de théâtre, Agata Tuszyńska est l’une des personnalités les plus en vue de la jeune littérature polonaise. Après ses études à l’Ecole supérieure d’art dramatique de Varsovie, sa ville natale, elle se lance dans le journalisme. En digne héritière de la littérature documentaire, elle s’inscrit dans la lignée de Ryszard Kapuscinski. Ses reportages lui ont valu de nombreuses récompenses.
Curieux livre que celui-là, entre documentaire et fiction, qui a fait beaucoup parler de lui en Pologne et a eu un certain succès (20 000 exemplaires vendus).
L’auteure tente de comprendre qui était Wiera Gran, juive rescapée du ghetto de Varsovie, accusée d’avoir collaboré avec les allemands pour assurer sa survie dans le ghetto. Mais coupable surtout peut-être d’avoir continué à chanter, d’avoir survécu grâce à cela, d’avoir chanté quand tant de gens mouraient. La question que pose très intelligemment l’auteure tout au long de son récit est la question de la responsabilité et de la culpabilité des rescapés du ghetto. La question aussi de la collaboration avec les allemands. Comment peut-on juger des actes qui ne visaient qu’à assurer la survie quand vivre un jour de plus dans le ghetto en proie à la faim ou à la maladie relevait simplement du miracle ? Quand tant d’hommes, de femmes et d’enfants mouraient dans la rue ? A partir de quel moment collabore-t-on avec l’ennemi quand il a droit de vie et de mort sur vous ?
« Nous sommes tous des collaborateurs. A une plus ou moins grande échelle, sur une journée ou sur toute une vie. Tout ce qui nous différencie c’est l’expérience et les circonstances, qui permettent d’apprécier jusqu’où vont les limites de nos compromis. L’histoire nous inscrit souvent dans un contexte de choix tragiques. Nous collaborons avec le destin, nous nous arrangeons avec lui. Nous sommes capables de justifier presque chacune de nos faiblesses. »
Wiera Gran fut une chanteuse à succès dans la Pologne d’avant-guerre.
« Dans la Varsovie d’avant-guerre, raconte-t-elle, une Juive ne pouvait pas être une vedette, je ne me faisais pas d’illusions. Mais les bandes nationalistes laissaient tranquilles les vitrines avec mes affiches, il y en avait même qui venaient m’applaudir. »
Elle se produisait parfois accompagnée par le pianiste Wladislaw Szpilman, le « pianiste » de Polanski, qui la fit disparaître de ses Mémoires publiées en 1946 et eut avec elle une attitude tout à fait ambiguë. Il semblerait qu’il ait eu une mémoire plus que sélective. Le livre fit scandale car il rapporte les propos de Wiera Gran qui accuse le pianiste d’avoir fait partie de la police juive du ghetto de Varsovie et d’avoir participé aux rafles. Or le pianiste est une icône dans le pays et ces accusations post-mortem (il est mort et elle aussi) ont suscité pas mal de remous et la fureur des héritiers du pianiste. (source, les journaux à la parution, dont Le Monde)
Lors d’un procès du tribunal populaire du Comité central des juifs de Pologne, devant lequel elle fut traduite après guerre qui devait établir ou non sa culpabilité, Wiera Gran fut disculpée par manque de preuves, mais le doute subsista et fit de sa vie un enfer. Elle fut prise à partie et insultée lorsqu’elle alla chanter en Israël. Toutefois ses accusateurs ne purent jamais produire la moindre preuve. Ils rapportaient le plus souvent des propos qu’ils avaient entendus ou qu’on leur avait rapportés.
Agata Tuszyńska s’interroge :
« J’utilise les mots sortis d’un lexique d’un monde sans guerre. Je les adapte à une réalité dans laquelle ils avaient souvent perdu leur usage. L’époque de l’holocauste a fait voler en éclats les anciens modèles de comportements, a relâché les normes morales de rigueur. Face à la menace permanete, on a repoussé les frontières de l’éthique. Ce n’est pas à nous d’en juger. […] Qu’aurais-tu fait pour sauver ta peau ? Et pour sauver ta mère ? Auquel de ces condamnés aurais-tu ouvert la porte de chez toi, sachant quelle menace t’attendait ? »
L’auteure la décrit à la fin de sa vie, en proie au délire de persécution, voyant partout des ennemis potentiels, et vivant dans une perpétuelle pénombre, les volets clos.
Elle tente de comprendre qui était Wiera Gran, et retrace son ascension, contrariée par la guerre et sa déchéance au soir de sa vie. Elle a connu la chanteuse jusqu’à la fin de sa vie, éprouve de l’empathie pour son personnage, mais avoue être troublée souvent, incapable de déterminer la vérité ou le mensonge. Un reportage qui a réussi à me passionner.
« Qu’est-ce qui sauve un condamné dans une situation impossible ? Quel est ce gène mystérieux de la survie qui a aidé dans ces circonstances de guerre à ne pas disparaître ? Comment se libère l’instinct de survie ? »
La question du ghetto hante une bonne partie de la littérature polonaise, et de la vie des héros qu’elle retrace. Elle fait partie d’un travail plus ample sur la mémoire nationale, sa part de mensonges et d’ombres. L’auteure est présente au Salon du Livre de Paris.