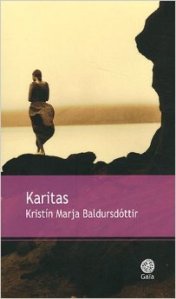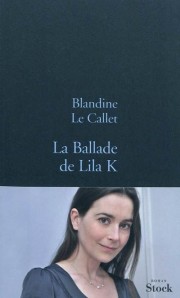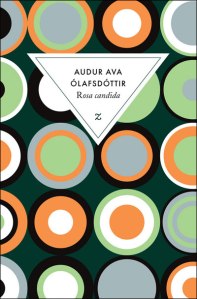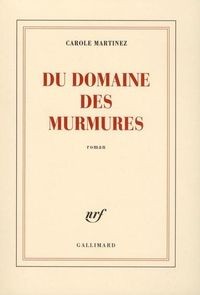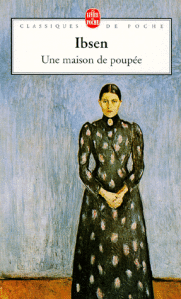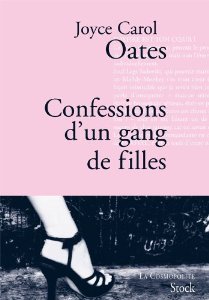Jean Anouilh – Médée – La petite vermillon – Editions la Table Ronde – 1947,1997
 « Quelque chose bouge dans moi comme autrefois et c’est quelque chose qui dit non à eux là-bas, c’est quelque chose qui dit non au bonheur. » (cf p16)
« Quelque chose bouge dans moi comme autrefois et c’est quelque chose qui dit non à eux là-bas, c’est quelque chose qui dit non au bonheur. » (cf p16)
Cette réécriture de Médée a lieu en 1947, la guerre est finie mais a laissé de profondes blessures, et l’Europe se relève à peine de ses décombres.
La version d’Anouilh s’inscrit dans une réflexion sur la résistance. C’est une écriture très belle et très épurée, ma version préférée, à ce jour, de Médée.
Dans la lignée d’Antigone, Médée se pose comme héroïne du refus, libre de dire non, dont la seule liberté consiste à dire non. Héroïne résistante, seule, quand le monde autour d’elle sombre dans la compromission.
La parole de Médée s’élève dans une solitude radicale. Alors que les gens du commun cherchent le plaisir de chaque jour, dans ces petits riens dont la reproduction et la répétition sont essentiels à la satisfaction et au bien-être. Quitte à ce que d’autres meurent pour eux. (cf la Nourrice et le garde pages 90 et 91)
« C’est alors que c’est bon, si on a pu grappiner quelques sous, la petite goutte chaude au creux du ventre. »
Médée vit dans le présent de la scène où elle advient à elle-même, en même temps que naît sa haine pour Jason et sa folie meurtrière. Ce moment où elle devient Médée, personnage tragique, dans la splendeur et le vertige de sa propre démesure.
Ce personnage naît dans le creuset d’un amour fou, terriblement charnel, indomptable et indompté, et de la douleur de l’abandon.
Médée n’est pas de ce monde, sa roulotte trace un espace à la lisière de l’espace social, commun et partagé (Ne pas oublier également que de nombreux roms furent déportés). Elle est en transit, n’appartient à aucun lieu, sinon celui de la tragédie, dans sa lumière solaire et implacable. Sa liberté est le destin auquel elle ne pourra pas échapper.
La scène est le lieu de l’exil, lieu qui condamne le personnage à aller jusqu’au bout de son texte, dans une série limitée d’actions et de paroles qui toutes auront une fin.
Lieu fermé et ouvert puisque Médée sans cesse rejouée et dé-jouée existe à nouveau dans chaque représentation, laissant ouvert le jeu des significations.
La fin tragique n’est pas une fin en soi mais un temps de transition qui ouvre sur de multiples interprétations.
Jason, lui, s’inscrit dans une généalogie, un temps linéaire et orienté : « Faire sans illusions peut-être comme ceux que nous méprisons ; ce qu’ont fait mon père et le père de mon père et tous ceux qui ont accepté avant eux. » (d’avoir les mains sales ?). Il croit échapper au temps de la tragédie dans une illusion qui semble sincère. Il fait le choix de l’avenir. Il accepte ce monde comme il est et souhaite y imprimer sa marque. Ce temps est aussi celui de la génération (sa jeune épouse veut des enfants ; on parle des futurs frères des fils de Jason et Médée.)
Alors que Médée renonce à l’amour et à la procréation symboles de sa soumission.
« Je l’attendais tout le jour, les jambes ouvertes, amputée . » p 21
« Il fallait bien que je lui obéisse, et que je lui sourie et que je me pare pour lui plaire puisqu’il me quittait chaque matin m’emportant, trop heureux qu’il revienne le soir et me rende à moi-même. »
Dans la passion amoureuse, le sujet s’aliène mais la femme plus encore. L’histoire, la psychanalyse, la littérature, la religion, la morale bourgeoise et puritaine l’ont réduite a être une absence de pénis, « amputée », une « chienne » vautrée dans son animalité, une « chair faite d’un peu de boue et d’une côte d’homme. », un « morceau d’homme », et une « putain ».
La femme est-elle seulement l’esclave de sa chair et du désir de l’autre ?
« Mais c’est fini ce soir, nourrice, je suis redevenue Médée. »
Le temps tragique permet à l’héroïne de reprendre possession d’elle-même dans une circularité bienfaisante. Elle revient à elle-même, à sa propre origine comme sujet autonome (capable de se donner sa propre loi.).
Trois longs dialogues d’une grande beauté (Médée et la nourrice, Médée et Créon, Médée et Jason) articulent l’œuvre et lui donne sa respiration dans un lyrisme qui engendre l’émotion (on atteint souvent au sublime, et ici je pense à la pièce de Corneille).
Le rythme est heurté, haletant parfois, contracté dans la douleur, il est celui de la passion (de la pulsion).
Les dialogues sont souvent asymétriques (Jason répond à Médée par des phrases très courtes puis le dialogue enfle jusqu’à donner cette magnifique réplique (p 62 à 68) où Jason raconte son amour de Médée.)
L’amour-passion fait de chacun un monde pour l’autre. Et c’est pourquoi il est tragique et circulaire.
Médée : « Sans moi. Tu as donc pu imaginer un monde sans moi, toi ? »
« Le monde est Médée pour toi, à jamais. »
Jason : « Le monde a-t-il donc toujours été Jason pour toi ?
Médée : Oui ! » (p 53)
La passion réduit le monde à n’être qu’un seul au détriment de tous les mondes possibles, au détriment aussi du monde réel.
La passion fait d’elle un « vautour », une « louve » ainsi que la nomme sa nourrice. Elle redevient Médée dans la solitude du héros tragique.
Jason dit qu’il veut accepter enfin, sortir des griffes de cette passion exclusive et violente. Je ne sais pas si on peu l’entendre dans le sens d’une collaboration. Mais être heureux dans le contexte d’un monde en guerre semble tout bonnement impossible. Comme il me semble également impossible de vivre un amour passionnel et exclusif où un seul prend la place de tous les autres. Les voies de Jason et de Médée sont toutes deux des impasses. C’est pourquoi chacun des deux se retrouvera finalement dans une solitude tragique.
Médée meurt, simple mortelle, dépouillée de son char et de ses dragons.
Jason : « Oui, je t’oublierai. Oui, je vivrai et malgré la trace sanglante de ton passage à côté de moi, je referai demain avec patience mon pauvre échafaudage d’homme sous l’œil indifférent des dieux. »