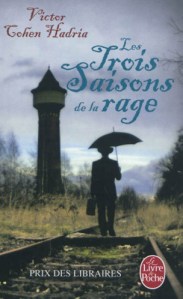Jens Christian Grøndahl Quatre jours en mars – La voix d’Ingrid Dreyer / traduit du danois par Alain Gnaedig, Gallimard 2011 pour la traduction française, collection folio n° 5494
L’auteur est né à Copenhague en 1959. Il a publié une dizaine de romans et est unanimement considéré comme l’un des meilleurs écrivains de sa génération. Piazza Bucarest a été récompensé par le prix Jean Monnet de Littérature européenne 2007.
Ingrid ne sait plus très bien où elle en est. A l’approche de la cinquantaine, une série d’événements la font douter des choix qu’elle a faits dans sa vie de femme. Elle se retrouve face à elle-même : son divorce, sa tentative d’échapper aux modèles passés, de réaliser une carrière tout en ayant un enfant. Mais voilà que tout lui coule entre les doigts, et la belle cohérence qu’elle pensait avoir donné à son existence semble à présent un écheveau désordonné où tous les fils s’emmêlent…
Pendant quatre jours, Ingrid laisse remonter les souvenirs. L’échec de son mariage, la difficulté de ses relations avec sa mère, journaliste interviewant des personnalités célèbres, fille mal aimée de sa mère Ada, ses propres difficultés avec son fils.,. Elle se trouve aux prises avec ses choix existentiels. Elle vit dans une époque individualiste, lieu de conflit entre la liberté et le devoir et éprouve un fort sentiment de culpabilité. Elle a dû trouver sa propre identité, la choisir et donc renoncer à tous les autres possibles.
Ingrid, sa mère Berthe et sa grand-mère Ada sont trois générations de femmes confrontées au dilemme de la maternité et du devoir et de la réalisation de soi. Toutes trois ont fait passer leur vie sentimentale et leur vie professionnelle avant leur rôle de mère et ont bénéficié de la révolution des mœurs permise par le féminisme. Mais qu’ont-elles réellement gagné et à quel prix ? Leurs relations mère/fille sont difficiles car elles ont chacune à leur manière vécu la blessure de l’abandon et l’éloignement de la mère, leur vie affective n’est pas des plus heureuses et la solitude les guette, quant à leur carrière, elle semble avoir été un miroir aux alouettes. Elles lui ont chacune beaucoup sacrifié mais pour quel bénéfice ? En ont-elles été plus heureuses ? N’ont-elles pas négligé l’essentiel ?
Jens Christian Grøndahl écharpe au passage le modèle éducatif danois relativement permissif où les enfants font la loi et devant lesquels les adultes cèdent trop souvent par peur de les « traumatiser ».
Dans une interview à l’Express, l ‘auteur explique que« ses romans montrent « le drame de la vie intérieure, la lutte de quelqu’un à travers des bribes de mémoire », cherchent à « creuser la banalité du quotidien ». Il insiste sur son rapport avec ses personnages. Sur le fait qu’il ne les connaît pas jusqu’au bout, ne les comprend jamais tout à fait complètement. »
Femmes vues par un homme, fils peut-être ou petit-fils de l’une de ces femmes, on sent la blessure encore à vif. Je ne sais pas si ce livre veut culpabiliser les femmes modernes, si le souhait de l’auteur est un retour en arrière. Il analyse finement les caractères mais on sent qu’il prend plus parti qu’il ne pose véritablement des questions. A mon sens en tous cas, mais j’aimerais bien avoir d’autres avis.
Chez Anne (Des mots et des notes)