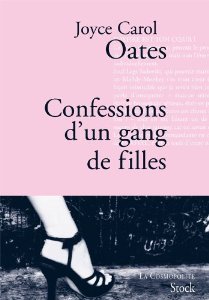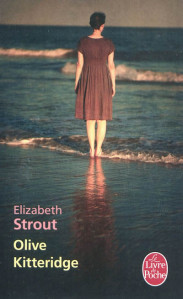Qui est Hannah Musgrave, ce personnage qu’endosse Russel Banks ? Et quels risques peut-elle faire courir à son auteur ? Celui de sombrer sur le versant féminin de sa bisexualité psychique ? Ou cette manière de brouiller les genres, de parler au féminin, n’est-il qu’une tentative vouée à l’échec ? Hannah Musgrave n’est-elle qu’une femme fantasmée par un auteur dont la place d’homme dans la société ne lui permet pas de savoir ce qu’une femme peut vivre avec les contraintes de son sexe ? Mais à ce moment-là, me diriez-vous, aucun auteur ne pourrait se mettre à la place de l’Autre, quel qu’il soit. La littérature n’est-elle pas justement le lieu d’une liberté et d’une expérimentation possible que ne permet pas toujours la réalité ?
Hannah Musgrave dit-elle quelque chose qu’elle n’aurait pu dire sans Russel Banks ?
Ma réponse serait oui. La façon qu’a cet auteur d’explorer la féminité, si tant est que ce mot ait encore un sens, est tout à fait originale et nous allons voir pourquoi.
Lorsque nous rencontrons Hannah, elle a presque 60 ans, elle est « vieille et desséchée, une coquille vide en tant que femme ». C’est-à-dire qu’en tant que femme, elle n’existe plus, ce qui ne l’empêche pas d’exister autrement : elle dirige une ferme, a des employées et un certain esprit d’organisation et d’initiative. Elle serait donc une femme plus une autre personne qui ne serait pas femme. Qui donc ?
Mais si nous continuons d’explorer le féminin de cette femme, que trouvons-nous en elle ?
Une femme qui se conduit « comme le font les femmes depuis des temps immémoriaux […], une de ces épouses et mères qui , endeuillées, marchent dans les décombres et dans la désolation laissés par des hommes et de jeunes garçons qui n’ont cessé de s’entretuer ».
Hannah a un père et une mère grâce auxquels elle est devenue qui elle est : une mère qui « divisait les gens entre les chanceux et les malchanceux » et un père pour qui existent « les sur-privilégiés et les déshérités » et qui se bat pour l’égalité des droits. Mais aucun d’eux ne met en cause la société blanche et capitaliste dans laquelle il est né. Ce sont des gens de la bourgeoisie aisée américaine, le père est un intellectuel qui a réussi, médecin, il écrit des livres qui lui assurent une renommée internationale. Il incite Hannah à réfléchir et a des discussions avec elle qu’il n’a pas avec sa propre femme. Il est plus proche de sa fille que de sa femme. Hannah se révoltera, embrassera la cause révolutionnaire jusqu’à entrer dans la clandestinité. Activiste et poseuse de bombe, elle évolue dans un univers presque uniquement masculin. Elle renonce à la vie confortable de la bourgeoisie américaine. Elle a appris à convertir son ennui et son désespoir en motif de lutte. D’autres voies s’offrent à elle car elle naît à une époque où s’engagent les premières grandes luttes féministes. Si sa mère n’en a pas vraiment bénéficié, Hannah, elle, a pu faire des études.
Elle devient mère pourtant, à son tour, mais dit-elle, « je n’avais pas une nature de mère. Contrairement à la plupart des femmes, je ne suis pas née programmée avec des instincts et des compétences de mère ». Il semblerait toutefois que les compétences soient plus de l’ordre de la culture que de la nature car elles supposent un savoir-faire. La maternité n’est pas une expérience heureuse, Hannah se sent « Dépersonnalisée. Chosifiée ».
Elle a bien des compétences mais « il est des choses pour lesquelles j’ai une aptitude naturelle, des talents qui me semblent m’avoir été conférés par mon ADN –pour les maths, la mécanique, la pensée linéaire, les classifications, etc.- des trucs du cerveau droit qu’on attribue d’habitude au sexe masculin[…].
Elle a plusieurs identités entre lesquelles elle se perd, et il y a fort à parier que son auteur s’y perd un peu aussi. Qu’est-ce qui relève de la nature et de la culture ? Qu’est-ce qui relève de l’inné et de l’acquis ? On connaît aujourd’hui la plasticité du cerveau, il y a parfois plus de différences entre deux hommes qu’entre un homme et une femme. On sait également qu’un comportement acquis peut modifier le cerveau et qu’il est aussi le témoin de la culture d’un individu. Et qu’une nouvelle éducation, d’autres habitudes modifieront le cerveau dans l’autre sens.
Alors Hannah Musgrave bien sûr, ne serait pas la même sans son auteur, elle dit autant de lui qu’il dit d’elle. Il crée une femme au masculin qui revendique cette part d’elle-même mais la sent comme étrangère . Son éducation lui a assené qu’une femme est faite pour être mère, qu’elle a un instinct et des aptitudes pour cela , et non pour les mathématiques ou la mécanique. Elle se sent coupable de ne pas être comme on lui dit qu’elle doit être et se sent écartelée, déchirée entre de multiples identités, dans une sorte de schizophrénie. Comment mieux animer la part masculine d’une femme quand on est soi-même un homme ? Et d’ailleurs pourquoi dans la pensée, la féminité serait-elle toujours associée à la nature et à la passivité et la masculinité à la culture et à l’activité ? Toute une façon de concevoir la pensée, la psychanalyse, enfin bref une façon de penser le monde à revoir.