
 Autant le dire tout de suite, le livre d’Elizabeth Gilbert m’a passionnée parce qu’il retrace la vie et le parcours d’une intellectuelle au XIXe siècle, et qui plus est d’une scientifique, une botaniste, qui n’a pas existé mais qui est le portrait tissé des vies de dizaines de femmes passionnées par les sciences au XIXe siècle en Europe. Il pose une question importante : si les femmes avaient eu accès à une éducation digne de ce nom, si elle avaient reçu l’instruction et pu accéder à l’Université auraient-elles inventé ou contribué à la découverte des grandes théories scientifiques ou des concepts qui ont bouleversé le siècle ?
Autant le dire tout de suite, le livre d’Elizabeth Gilbert m’a passionnée parce qu’il retrace la vie et le parcours d’une intellectuelle au XIXe siècle, et qui plus est d’une scientifique, une botaniste, qui n’a pas existé mais qui est le portrait tissé des vies de dizaines de femmes passionnées par les sciences au XIXe siècle en Europe. Il pose une question importante : si les femmes avaient eu accès à une éducation digne de ce nom, si elle avaient reçu l’instruction et pu accéder à l’Université auraient-elles inventé ou contribué à la découverte des grandes théories scientifiques ou des concepts qui ont bouleversé le siècle ?
Alma Whittaker est bryologiste, spécialiste de l’étude des mousses. Comment a-t-elle pu devenir une femme de science, d’où tient-elle son savoir puisque les cercles scientifiques sont interdits aux femmes? Par son père, un anglais qui a émigré aux Etats-unis en faisant fortune dans le commerce du quinquina, mais qui est aussi un botaniste autodidacte, voleur de plantes, personnage haut en couleurs et éducateur très original pour l’époque, puisqu’il permet à sa fille d’assister à toutes les soirées auxquelles il invite des scientifiques de renom et de débattre avec eux.
La petite Alma se nourrit intellectuellement de ces contacts avec d’éminents chercheurs et devient une jeune femme d’une intelligence particulièrement éclectique. Elle ne peut pas voyager en tant que femme, alors elle se décide à observer le monde qui l’entoure.
Elle est intelligente mais dotée d’un physique ingrat. Comment accèdera-t-elle au monde qui est celui des femmes dont la vocation obligée est le mariage et les enfants ? Comment conciliera-t-elle sa soif de connaître aux exigences de l’époque en matière de rôle et de statut des femmes ?
« Dans le monde scientifique de l’époque, il y avait encore une division stricte entre « botanique », l’étude des plantes par les hommes et « botanique d’agrément, l’étude des plantes par les femmes. Certes les deux étaient difficiles à distinguer l’une de l’autre hormis que l’une était respectée et l’autre pas. »
Alma Whittaker est le portrait type d’une intellectuelle de l’époque et Elizabeth Gilbert s’est abondamment documenté et a construit un roman intelligent et prenant.
Une nouvelle théorie va bouleverser le XIXe siècle et les représentations scientifiques, c’est la théorie de l’évolution de Darwin, qui sera acceptée de son vivant mais sera l’objet de nombreuses polémiques car en butte aux conceptions religieuses de l’époque. Le roman de Tracy Chevalier, Prodigieuses créatures évoque lui aussi avec talent la vie d’une chasseuse de fossile au XIXe siècle, à la même époque, au milieu des mêmes débats intellectuels et cela m’avait passionnée.
Mais ce qui, véritablement, fait l’originalité du livre d’Elizabeth Gilbert, c’est la question habilement posée des découvertes parallèles. On sait que Charles Darwin et Alfred Russell Wallace ont élaboré tous deux la théorie de la sélection naturelle, ce qui a incité Charles Darwin à publier sa propre théorie plus tôt que prévu. Le postulat d’Elizabeth Gilbert est donc celui-là : si deux hommes ont pu parallèlement aboutir aux mêmes conclusions à l’issue de leurs recherches sans jamais avoir communiqué à leurs propos, est-ce qu’une femme, dotée de la même intelligence et des mêmes connaissances aurait pu le faire ? C’est diablement futé ! Tout le roman est construit là-dessus et si vous vous prêtez au jeu, cela tient véritablement en haleine…
Plusieurs femmes ont été des botanistes au XIXe siècle , Anna Atkins (1799-1871), Mary Katharine née Layne, épouse Curran puis Brandegee (1844-1920), Alice Eastwood (1859-1953), Eliza Standerwick Gregory (1840-1932), Josephine Kablick (en), (1787-1863), botaniste et paléontologue originaire de Bohème Sarah Plumber Lemmon (1836-1923), Jane Webb Loudon (1807-1858), Il est bon de rappeler leur existence.




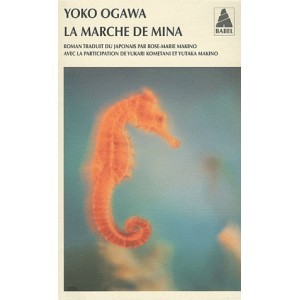




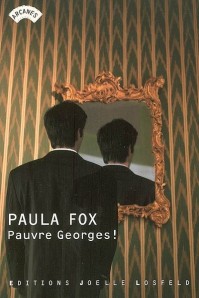





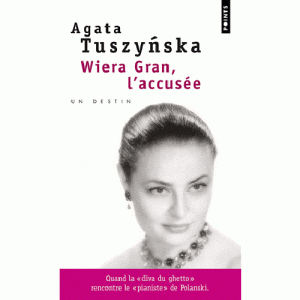




 Anna Gréki, emprisonnée pour avoir participé activement au combat pour l’indépendance de l’Algérie,
Anna Gréki, emprisonnée pour avoir participé activement au combat pour l’indépendance de l’Algérie, novembre 2005,
novembre 2005,




