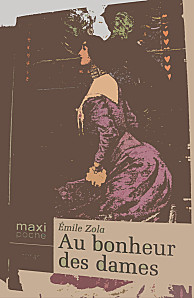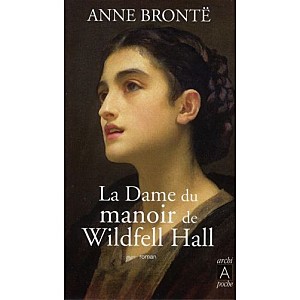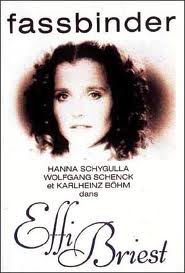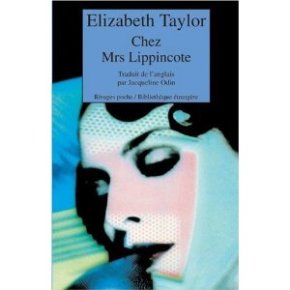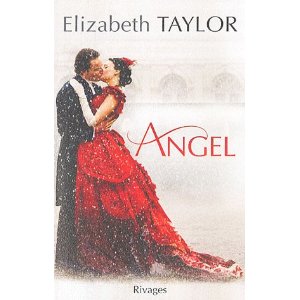Le bonheur des dames s’inscrit dans la grande fresque naturaliste des Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d’une famille sous le second empire. Il étudie scientifiquement une famille sur laquelle pèse l’hérédité et la folie. Et les milieux sociaux dans lesquels évolue ses membres.
Denise vient à Paris avec ses deux frères dont elle s’occupe comme une mère pour trouver du travail car ses parents sont morts et c’est à elle que revient la charge de s’occuper d’eux. Elle a « un visage long à bouche trop grande, son teint fatigué déjà, sous sa chevelure pâle »[1]. Zola rompt ainsi avec les description des héroïnes des romans populaires, qui ne sont que « magnifiques chevelures, regards superbes », visant à éblouir le lecteur par « une beauté superlative à l’aide de poncifs »[2]
Elle se rend chez son oncle drapier à Paris qui ne peut lui procurer du travail car ses affaires vont mal, malmenées par la concurrence d’un grand magasin « Le bonheur des dames » dirigées par Octave Mouret qui rêve de conquérir le peuple des femmes. Il invente de nouvelles techniques d’intéressement de ses employés au chiffre des ventes en leur octroyant des commission sur le montant total des ventes, révolutionne l’art de l’étalage par de magnifiques mises en scène et ne cesse de vouloir agrandir son magasin, vendant beaucoup et à bon marché, l’intérêt étant de faire travailler le capital investi le plus de fois possible quitte à vendre à perte. Cette rotation rapide des stocks, les prix bas signent la mort du petit commerce qui succombe sous la marche du progrès. Des personnages hauts en couleur tiennent tête à l’ogre du « Bonheur des dames » et à son désir de puissance et de femmes.
Car il s’agit d’attirer les femmes et de les dominer, de les « allumer ». Ces femmes de la bourgeoisie du XIXe siècle, que l’on tient encore largement prisonnières de la sphère domestique, rompues à l’art de plaire, tout entières tournées vers les robes et les colifichets, armes suprêmes de la conquête et de la réussite sociale, vont devenir des victimes de la mode et les pionnières de la société de consommation. Car le prêt-à-porter naissant met à la portée de toutes les bourses ce qui auparavant était inaccessible. La consommation effrénée devient alors le moyen d’assouvir toutes les frustrations des femmes vouées à une vie morne et sans intérêt une fois leurs enfants élevés.
« Mouret avait l’unique passion de vaincre la femme. Il la voulait reine dans sa maison, il lui avait bâti ce temple pour l’y tenir à sa merci. C’était toute sa tactique, la griser d’attentions galantes et trafiquer de ses désirs, exploiter sa fièvre. »[3]
Il n’en va pas de même pour celles qui sont obligées de gagner leur vie comme Denise, dans des conditions difficiles, treize heures par jour, sans aucune protection sociale. Les femmes de la classe ouvrière sont des proies faciles, obligées parfois de se vendre pour échapper à la misère en prenant un amant ou en se prostituant.
Octave Mouret, malgré son cynisme, est le type même de l’entrepreneur moderne pour qui l’essentiel est de « vouloir et d’agir, de créer enfin »[4]
A la guerre commerciale, fait écho la guerre des sexes et la misogynie. Ainsi Mouret se targue-t-il d’élever un temple aux femmes, cherchant sans relâche « à imaginer des séductions plus grandes ; et derrière elle, quand il lui avait vidé les poches et détraqué les nerfs, il était plein du secret mépris de l’homme auquel une maîtresse vient de se donner. »[5]
La femme est reine dans son foyer, tous les achats domestiques lui reviennent, les étoffes couvrent son corps et le rendent plus désirable encore et Mouret à travers son commerce échauffe ces désirs et les manipulent.
Mais cette rivalité homme/femme se double d’une rivalité entre les femmes elles-mêmes, rivalités de classe ou rivalités dans la conquête d’un homme. Zola raconte ainsi qu’ « on se dévorait devant les comptoirs, la femme y mangeait la femme, dans une rivalité aiguë d’argent et de beauté. »[6]
Cette guerre perpétuelle préside aussi aux relations entre les vendeuses, chacune cherchant à prendre la place de l’autre afin d’acquérir plus d’argent et de pouvoir. Cette loi de la nature qui est la loi du plus fort est aussi la loi qui régit les rapports humains et les rapports sociaux.
Mais Denise va contribuer à renverser cet ordre négatif et transformer Mouret. Car il y a tout au long de ce livre une très belle histoire d’amour.
Courageuse, intelligente, clairvoyante et fière, elle possède toutes les qualités, et refuse les avances de Mouret. Il va apprendre à nouer des relations avec les femmes basées sur la confiance et le respect alors qu’auparavant elles étaient pour lui des objet ou des proies. C’est à une conversion que l’on assiste alors et les autres femmes sont vengées ! Peu à peu, elle le conduit à améliorer les conditions de travail dans une perspective de plus grande justice sociale et met en place des innovations en matière de protection .
C’est donc par la femme que se produit l’ultime conversion, par la grâce de l’amour aussi que le personnage masculin se transforme. Denise n’est pas d’une grande beauté mais ses qualités de cœur et sa vive intelligence en font une femme moderne et équilibrée. C’est la fin du XIXe siècle… Toutefois elle reste la mère avant tout, et il est assez significatif que son ascension professionnelle la conduira au rayon … pour enfants. On ne tord pas si facilement le cou aux préjugés, même si on s ‘appelle Zola.
Ce roman magnifique est à lire absolument ou à relire !
[1] Au bonheur des dames, p 13, éditions de la Seine 2005.
[2] Destins de femmes dans le roman populaire en France et en Angleterre au XIXe siècle.
[3] Au bonheur des dames, p 246, éditions de la Seine 2005
[4] Au bonheur des dames, p 75, éditions de la Seine 2005
[5] Au bonheur des dames, p 85, éditions de la Seine 2005
[6] Au bonheur des dames, p 325, éditions de la Seine 2005