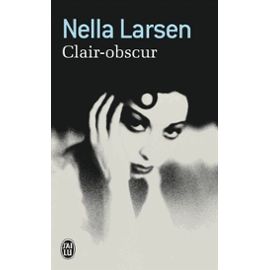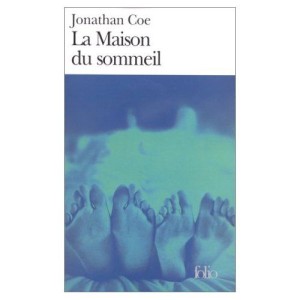King Kong Théorie Grasset 2006

 Disons-le tout de suite, Virginie Despentes n’est pas consensuelle, sa langue est crue et sans détours, elle n’a pas peur de jeter des pavés dans la mare et sa pensée, souvent, est radicale. Moi, j’aime sa sincérité, sa virulence et sa force qui n’excluent pas la fragilité fondatrice de tout être humain.
Disons-le tout de suite, Virginie Despentes n’est pas consensuelle, sa langue est crue et sans détours, elle n’a pas peur de jeter des pavés dans la mare et sa pensée, souvent, est radicale. Moi, j’aime sa sincérité, sa virulence et sa force qui n’excluent pas la fragilité fondatrice de tout être humain.
King Kong théorie est une réflexion nourrie des expériences personnelles de l’auteure, celle du viol qu’elle a subi à 17 ans, de la prostitution qu’elle a exercée occasionnellement et de la pornographie, milieu dans lequel elle a travaillé et chroniqué des films.
Son texte est riche, porté par une grande énergie, et agit comme de la dynamite. Il est souvent drôle, très pertinent et polémique. Il est écrit pour toutes celles ou ceux qui ne se sentent en adéquation ni avec le discours dominant, ni avec la place qui leur est assignée qu’il soit homme ou femme.
Ainsi dit-elle d’où elle écrit, « prolotte de la féminité », et pour qui elle écrit : « J’écris de chez les moches, pour les moches, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, toutes les exclues du grand marché de la meuf, aussi bien que pour les hommes qui n’ont pas envie d’être protecteurs, ceux qui voudraient l’être mais ne savent pas s’y prendre, ceux qui ne sont pas ambitieux, ni compétitifs, ni bien membrés. Parce que l’idéal de la femme blanche séduisante qu’on nous brandit sous le nez, je crois bien qu’il n’existe pas. »
En effet, hors de l’apparence, la femme n’a point de salut, dotée d’un physique ingrat, ou passée un certain âge, elle devient invisible aux yeux de la plupart des hommes.
Pourtant la révolution féministe a bien eu lieu, et les femmes aujourd’hui jouissent d’une liberté sans égale dans leur histoire. Pourquoi alors les inégalités subsistent-elles ? Pourquoi les femmes ne se servent-elles pas de cette puissance retrouvée d’exercer leurs talents et d’assouvir leur désirs ? Pourquoi sont-elles minoritaires en politique ?
Parce que tout un ensemble de discours pernicieux tenus « surtout par les autres femmes, via la famille, les journaux féminins, et le discours courant. » sur ce que doit être la féminité les entrave, comme si celle-ci n’était pas le produit de la culture et de l’histoire. Beauvoir est passée par là, et plus récemment Judith Butler.
Virginie Despentes essaie de montrer comment les hommes, comme les femmes en sont victimes, car si une place est assignée à la femme, une autre est assignée à l’homme. Les hommes oublient trop souvent que leur force enracinée dans l’oppression féminine a un coût : « Les corps des femmes n’appartiennent aux hommes qu’en contrepartie de ce que les corps des hommes appartiennent à la production, en temps de paix, à l’État, en temps de guerre. » Et tout ce qui leur est interdit depuis toujours , les larmes, la sensibilité et tutti quanti.
Comprendre ce qui nous aliène dans la distinction des rôles et des places , « c’est comprendre les mécanismes de contrôle de toute une population ». « Le capitalisme est une religion égalitariste, en ce sens qu’elle nous soumet tous, et amène chacun à se sentir piégé comme le sont toutes les femmes. »
Ainsi dans l’expérience traumatisante du viol qu’elle a subi, Virginie Despentes affirme encore : « J’aurais préféré, cette nuit-là, être capable de sortir de ce que l’on a inculqué à mon sexe […] plutôt que vivre en étant cette personne qui n’ose pas se défendre parce qu’elle est une femme, que la violence n’est pas son territoire, et que l’intégrité physique du corps d’un homme est plus importante que celle d’une femme. »
Toutes ces normes, ces codes assimilés tout au long de l’Histoire, font de la femme une proie et une victime et Virginie Despentes refuse tout cela. Même d’un viol, on peut se relever, car c’est nier le pouvoir absolu que s’arroge le violeur, même si elle admet de cet événement qu’ : « Il est fondateur. De ce que je suis en tant qu’écrivain, en tant que femme qui n’en est plus tout à fait une. C’est en même temps ce qui me défigure, ce qui me constitue. »
Quant à la prostitution, hypocritement vilipendée par les bonnes âmes de la société, elle est un mode des relations hétérosexuelles dans la société patriarcale. Le sexe est souvent tarifé, les femmes n’ayant souvent pas eu d’autre choix que s’assurer un bon mariage pour échapper à leur condition ou monter les barreaux de l’échelle sociale. Mais si la prostitution fait peur, selon elle, c’est que « le contrat marital apparaît plus clairement comme ce qu’il est : un marché où la femme s’engage à effectuer un certain nombre de corvées assurant le confort de l’homme à des tarifs défiant toute concurrence. Notamment les tâches sexuelles ».
Même chose pour la pornographie et le sort qui est fait aux hardeuses, qui parce qu’elles ont gagné leur vie en retirant un « avantage concret de leur position de femelles, doivent être publiquement punies. » Elles ont transgressé la place assignée à la femme, celui de la bonne épouse, de la bonne mère, de la femme respectueuse. Dans ces films faits par des hommes le plus souvent, elles ont une sexualité d’hommes, veulent du sexe et assument à cet égard une totale liberté. D’autre part, elles jouissent à tous les coups. La pornographie elle aussi est une atteinte à l’ordre moral qui est fondé sur l’exploitation de tous et des femmes en particulier : « La famille, la virilité guerrière, la pudeur, toutes les valeurs traditionnelles visent à assigner chaque sexe à son rôle. »
Pour finir, Virginie Despentes raconte sa « montée » à Paris, la réception de son œuvre par les critiques, leur violence, le mépris et le rejet qu’elle ressent plus violemment en tant que fille. Elle est trop « masculine », trop indisciplinée, trop violente. On ne lui pardonne pas la moitié de ce qu’on permet aux auteurs hommes. En gros, elle fait tache. (On tolère Bukowski un ivrogne obsédé sexuel, instable et chaotique parce que c’est un homme). Pas assez féminine, docile, servile. Mais qu’est-ce que la féminité ?
C’est l’art de la servilité : « C’est juste prendre l’habitude de se comporter en inférieure. Entrer dans la pièce, regarder s’il y a des hommes, vouloir leur plaire. Ne pas parler trop fort. Ne pas s’exprimer sur un ton catégorique. Ne pas s’asseoir en écartant les jambes pour être bien assise. Ne pas s’exprimer sur un ton autoritaire. Ne pas parler d’argent. Ne pas vouloir prendre le pouvoir. Ne pas vouloir occuper un poste d’autorité. Ne pas chercher le prestige. Ne pas rire trop fort … »
Heureusement mon expérience n’est pas tout à fait celle de Virginie Despentes, et les hommes, la plupart du temps, ont été des amis (mais pas toujours non plus). Pourtant je comprends parfaitement ce qu’elle raconte quand elle explique comment chacun de nous est assignée à « son genre », comme s’il était assigné à résidence. Et combien il est difficile parfois d’oser, quand on est une femme. Simplement parce qu’on vous a dit ce que devait être une femme. Néanmoins la douceur est, à mon avis, une conquête féminine, et il est heureux qu’elle sache la donner, la communiquer. De la même façon, la douceur des hommes est signe de leur force, parce qu’elle suppose une maîtrise et un équilibre parfaits de toutes leurs pulsions; en ce sens elle est l’exact contraire de la faiblesse. Un homme violent est faible, mais un homme qui accepte en lui sa douceur, montre sa force, inégalée.
Parfois les hommes et les femmes se rencontrent au lieu même de cette douceur en eux, qui est leur force. Et c’est heureux.