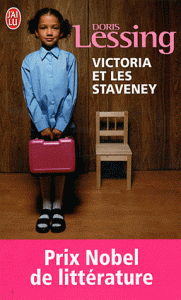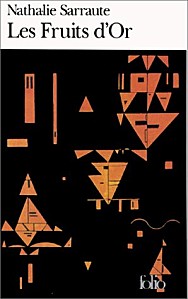Adeline Virginia Stephen est née le 25 janvier au Hyde Park Gate à Londres, troisième enfant de Julia et de Leslie Stephen après Vanessa née en 1879, Thoby né en 1880, et avant Adrian né en 1883. Sa mère avait deux fils d’un premier mariage, Gerald et George Duckworth, et son père une fille, Laura.
L’intérêt de la biographie d’Alexandra Masson est de relier de manière étroite la vie de Virginia Woolf à ses œuvres. En effet, son œuvre est largement autobiographique même si l’auteur prend garde à brouiller les pistes dans ses romans. Alexandra Masson montre comment le thème de l’enfance revient comme un paradis perdu. Des lieux deviennent mythiques comme St Ives, petit village où la famille Stephen se rendait chaque été jusqu’à la mort de la mère.
« La promenade au phare », « Les vagues », ou « La chambre de Jacob » reprennent des images ou des souvenirs de cet endroit.
Mais les membres de sa famille tiennent également une place importante. Son frère aîné, Thoby, est un personnage central dans son œuvre et inspire celui de « La chambre de Jacob », comme celui de « La promenade au phare ».
Des thèmes reviendront très souvent également, comme celui de l’eau, par qui tout commence et tout finit. Dans « Les vagues », on entend le bruit de la mer, « La promenade au phare » indique assez bien sa présence.
Sa mère, très tôt disparue à l’âge de 49 ans, lui manquera cruellement – d’ailleurs les troubles nerveux de Virginia Woolf commenceront peu après. Elle représentait le modèle de la femme victorienne, dévouée à son mari et à ses enfants, victime de la société patriarcale incarnée par son mari. En réaction peut-être à ce modèle, Virginia et sa sœur, chercheront à réaliser leurs aspirations personnelles, l’une par la peinture, l’autre par l’écriture. Sa sœur Vanessa, avec laquelle elle entretiendra toute sa vie des liens fusionnels empreints de rivalité, et à laquelle elle se comparera toujours, apparaît également dans son œuvre.
Se réaliser passe d’abord par avoir « une pièce à soi » et donc jouir d’une certaine indépendance financière. Ses premiers revenus lui viendront du journalisme. Non seulement l’écriture est une thérapie mais elle lui permet de gagner de l’argent.
Virginia Woolf a commencé comme critique littéraire dans « The Guardian » puis écrit un premier roman, « La traversée des apparences » auquel elle consacrera huit années de sa vie. Elle écrira ce livre dans la souffrance , « écrire est un enfer » dira-t-elle dans son journal. D’ailleurs presque chaque livre sera suivi de périodes de dépression. Elle passe par des états qui alternent la plus grande exaltation avec le plus profond désespoir. Elle considèrera chaque livre comme une thérapie.
Virginia Woolf est en fait méconnue ou mal connue. Il est assez significatif d’ailleurs qu’un film ait associé son nom à la folie et à la peur : « Qui a peur de Virginia Woolf ? ».
On a peu souligné le courage de cette femme qui se battit contre la maladie mentale sans l’aide de la médecine, à l’époque assez démunie dans le traitement des maladies mentales. Les œuvres de Freud ne sont pas encore assez connues et même si la Hogarth Press, maison d’édition fondée par Virginia Woolf et son mari, Léonard Woolf, publiera les œuvres du maître de la psychanalyse, Virginia refusera toujours d’entamer une thérapie, consciente que c’est aussi dans ce déséquilibre émotionnel qu’elle trouve une partie de sa créativité.
Vanessa et Virginia Woolf, même si elles ne vont pas à l’école, seuls les garçons ont ce droit, c’est le choix du père, bénéficient d’une instruction donnée par des précepteurs. Elles sont filles d’intellectuels cultivés et acquièrent une culture que peu de femmes ont à leur époque. Jusqu’à l’âge de douze ans son père dirige le choix de ses lectures : Euripide, Sophocle, Platon, Jane Austen, Dickens, George Eliot entre autres. Toute sa vie, la lecture sera une de ses occupations privilégiées car elle l’apaise. Même quand elle écrira ses propres livres, elle suivra toujours un programme important de lectures. Proust est pour elle le modèle absolu, mais elle lit aussi Ibsen, Shakespeare, Tchekhov.
L’écriture selon elle, naît d’un choc affectif qui est à l’origine de sa vocation .L’écriture de son journal, qu’elle tiendra pendant près de trente ans lui permettra de noter tous ses sentiments au fur et à mesure de l’écriture de ses romans.
On a souvent l’image d’une femme dépressive et suicidaire alors qu’on trouve dans ses romans une sensualité, une jouissance devant la beauté de la nature ou l’intensité du moment qui la contredit totalement. Elle devait tout ressentir avec beaucoup d’intensité, la douleur comme le bonheur, en tout cas c’est ce qui ressort de la biographie d’Alexandra Masson. D’ailleurs, Mrs Dalloway , récit de la journée d’une femmes à Londres, représente bien cette dualité, « le monde vu par la raison et par la folie » comme elle le note dans son journal.
Les traumatismes subis, la mort de sa mère lorsqu’elle avait 13 ans , puis de sa demi-sœur Stella deux ans après, suivi par celle de son frère Thoby en 1906 aggravent son sentiment d’insécurité. Les viols dont elle fut victime de la part de ses demi-frères renforcèrent le traumatisme originel. Elle se réfugie dans l’écriture qui lui permet de survivre.
Pour mener son métier d’écrivain à bien malgré sa santé fragile, elle trouvera en Leonard Woolf un allié précieux, au moins jusqu’à un certain point. Ils se marieront et Leonard se consacrera totalement aux soins de son épouse jusqu’à régler son emploi du temps de manière draconienne. Un dévouement si total qu’il devient aussi une forme de tyrannie ! Mais chacun certainement y trouve son compte. Virginia apprécie certainement au début d’être ainsi totalement prise en charge car cela lui permet de se consacrer à l’écriture. Mais en contrepartie, son mari l’enfermera dans son rôle de malade.
En quelques années, à partir de 1919, elle publie plusieurs romans : « Nuit et jour », « La chambre de Jacob » et Mrs Dalloway en 1925. En parallèle, Virginia Woolf assume son amour pour les femmes avec la liaison passionnée qu’elle entretiendra avec Vita Sackville-West. Cette dernière lui inspirera le personnage d’Orlando qui paraît en 1928, précédé par « La promenade au phare » en 1927. Orlando pose la question du masculin et du féminin et de leur catégorisation. Virginia Woolf ne se considère pas comme une lesbienne, terme qu’elle abhorre, mais sent qu’elle est « mélangée ». Les amitiés féminines auront une grande importance dans sa vie, Katherine Mansfield, avec laquelle elle aura une relation plutôt mouvementée, ou Violet Dickinson qui la prit sous son aile après la mort de sa mère et lui permit « d’exprimer ses premières émotions littéraires ».
Virginia Woolf s’est construite en s’opposant au modèle de la femme victorienne, pour autant elle n’est pas une pionnière héroïque du mouvement féministe. Ethel Smith, autre grande amie, beaucoup plus âgée qu’elle, est très engagée dans ces mouvements. Virginia Woolf publie en1929, « Une chambre à soi », plaidoyer pour la liberté des femmes, suite à un séminaire auquel elle a participé à Cambridge sur les femmes et le roman. Elle y dénonce avec force l’injustice faire aux femmes sur le plan économique, social et politique. Très jeune, elle a apporté son aide aux suffragettes, elle a aussi donné des cours de littérature à des ouvrières
En 1931, elle publie « Les Vagues », son roman le plus expérimental. Il qui consiste en six monologues portés par Bernard, Susan, Rhoda, Neville, Jinny, et Louis. Percival, le septième personnage, ne parle jamais lui-même.
En 1937, « Les Années », suivi de « Trois Guinées » en 1938, prennent un tour plus politique et polémique, en traitant dans un style très différent de la place de l’écrivain dans la société. Virginia pousse toujours dans des directions différentes ses recherches formelles. Auparavant, Flush, en 1933, ne déroge pas à la règle, car le style en est très différent, l’auteur s’amuse et esquisse une biographie fictive de la poétesse Elizabeth Barrett Browning vue par son cocker.
En 1939, elle entreprend une biographie « Une esquisse du passé » qui réveille des souvenirs douloureux et la fait sombrer à nouveau dans la dépression.
En 1940, elle publie une biographie de Roger Fry, biographie de son ami peintre, ancien amant de sa sœur. Mais la guerre gronde et fait ses premiers ravages et Virginia Woolf ne se sent plus le cœur à écrire. Comment l’art pourrait-il gagner face à la guerre, quelle pourrait être la force de l’écriture face à la barbarie ? L’auteur perd pied et de laisse envahir par le désespoir, en 1941, le 20 janvier, elle envoie « Entre les actes » à son éditeur et le 28, elle se suicide en se jetant dans la rivière de l’Ouse, les poches de son manteau lestées de pierres. L’eau est par ce quoi tout commence et tout finit. Une grande romancière disparaît, laissant une œuvre considérable et d’une grande diversité.
La biographie d’Alexandra Masson est passionnante à tous les points, et tente de faire comprendre avec beaucoup de finesse et d’intelligence qui fut Virginia Woolf. A lire absolument pour comprendre la grande romancière.