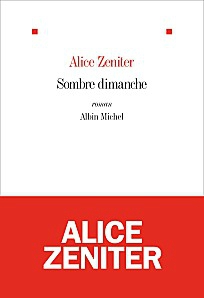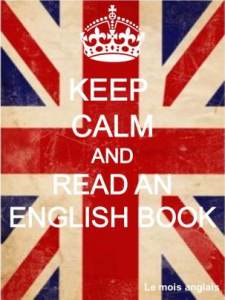Christine de Suède David-neel Isabella Bird Isabelle Eberhardt,
 Penser à la manière dont la philosophie nous y engage est toujours un voyage sur deux plans qui se complètent : philosopher c’est opérer une conversion du regard et de la pensée, partir de ces certitudes pour les confronter à l’altérité, à l’ailleurs de soi : il y a toujours un commencement qui est comme un départ. Celui qui philosophe est un migrateur. Tous les philosophes ont conceptualisé ce changement que ce soit le doute que Descartes avait dû expliquer à Christine de Suède qui, élevée à la dure, comme un garçon, féministe avant l’heure, cherchait à gommer toute féminité dans la façon de s’habiller et dans son comportement (on peut dire qu’elle doutait de beaucoup de choses), ou la transmigration des âmes, expliquée ainsi dans la Bhagavad-Gîtâ (II, 22) : « A la façon d’un homme qui a rejeté des vêtements usagés et en prend d’autres, neufs, l’âme incarnée, rejetant son corps, usé, voyage dans d’autres qui sont neufs, le cheminement de l’histoire, » ou l’immobilité de celle qui voyage par la pensée, accompagnée de sa duègne, entravée par des robes longues et inconfortables.
Penser à la manière dont la philosophie nous y engage est toujours un voyage sur deux plans qui se complètent : philosopher c’est opérer une conversion du regard et de la pensée, partir de ces certitudes pour les confronter à l’altérité, à l’ailleurs de soi : il y a toujours un commencement qui est comme un départ. Celui qui philosophe est un migrateur. Tous les philosophes ont conceptualisé ce changement que ce soit le doute que Descartes avait dû expliquer à Christine de Suède qui, élevée à la dure, comme un garçon, féministe avant l’heure, cherchait à gommer toute féminité dans la façon de s’habiller et dans son comportement (on peut dire qu’elle doutait de beaucoup de choses), ou la transmigration des âmes, expliquée ainsi dans la Bhagavad-Gîtâ (II, 22) : « A la façon d’un homme qui a rejeté des vêtements usagés et en prend d’autres, neufs, l’âme incarnée, rejetant son corps, usé, voyage dans d’autres qui sont neufs, le cheminement de l’histoire, » ou l’immobilité de celle qui voyage par la pensée, accompagnée de sa duègne, entravée par des robes longues et inconfortables.
Homère est nouveau ce matin », s’émerveille Péguy, entreprenant le voyage de la lecture du voyage d’Ulysse. Qu’en est-il alors des femmes ? Quel sens a pris ce voyage pour elles ? On sait bien que Pénélope attend Ulysse et qu’elle tisse inlassablement. Elle attend…Pourtant la philosophie pose l’universalité de sa réflexion et n’en a pas écarté les femmes.
Prise dans de multiples obligations, elles ont peu voyagé ; un enfant attaché sur le dos, elles parcourent pourtant de grands espaces en Afrique : elles vont chercher l’eau à la rivière à plusieurs kilomètres, elles se rendent au marché, et leurs regards embrassent les espaces quotidiens. Elles connaissent le temps du voyage et sa fatigue. Comme l’écrivait l’auteur de Tristes Tropiques Claude Lévi-Strauss, tout déplacement dans l’espace est aussi, simultanément, un voyage dans le temps.
Nomades du désert, elles font vivre le foyer sous la tente, accompagnent leurs maris. Quelques siècles plus tard, Isabelle Eberhardt, née à Genève en 1877, découvre le désert à 20 ans , se convertit à l’islam, pour trouver la mort, à 27 ans, dans la crue d’un oued.

Et c’est par le voyage que se diffusa la culture, la science, et les découvertes de tout genre. C’est dans ces échanges, dans ces voyages innombrables surtout au XVIIIe siècle, en rupture avec la barbarie des sanglantes découvertes de l’Amérique, que les savants voyageurs, laissant femme et enfants pour de longs mois, ont fécondé, entre autres, la science et la philosophie tout autant qu’ils ont créé le mythe du « bon sauvage ».On le trouve plus développé chez Montaigne, dans « Les cannibales ». Et la bonne sauvage ? Cet outrage à la pudeur, cachez ce sein que je ne saurais voir.
Mais aussi les sociétés matriarcales et bien plus tard les ouvrages de Margaret Mead. En résumé, son œuvre Mœurs et sexualité en Océanie vise à montrer que les traits de caractère de l’homme et de la femme sont le résultat d’un conditionnement social. « Elle pose une hypothèse qui serait celle de dégager les principes selon lesquels des types de personnalités si différentes ont pu être assignés aux hommes et aux femmes pendant l’histoire : les garçons devront dominer leurs émotions et les femmes pourront les manifester. Puis elle pose la question de savoir si une société est capable de choisir dans la vaste étendue des virtualités humaines un certain nombre de traits, et d’en faire la marque distinctive, soit de l’un des deux sexes, soit de toute la communauté. »source Wikipedia

Margaret Mead au travail.
Dès 1717, Lady Mary Wortley Montagu visite la Turquie (J’ai son livre sur ma table de nuit « Je ne mens pas autant que les autres voyageurs »), suivie par quelques autres, qui se rendent en Palestine, en Syrie, en Egypte et jusqu’en Perse. Ces dames se déplacent avec de nombreux bagages et une importante domesticité en bonnes bourgeoises qu’elles sont. Elles observent les Orientales, visitent même un harem. Peut-être ont-elles goûté pour la première fois leur liberté de femmes occidentales.

Il y a des voyages qu’on n’accomplit qu’à son corps défendant (des femmes sont enlevées comme esclaves et sont séquestrées dans ces fameux harems): le voyage pour suivre le mari qu’on n’a pas choisi, l’exil ; la déportation.
L’exil dans des terres étrangères pour sauver ses enfants de la folie meurtrières des hommes ou de la famine. Nous devenons étrangers aux autres et à nous-mêmes comme Fadhma Aït Mansour Amrouche qui toujours fut en exil et le premier fut d’être femme.
La sexualité non conforme pouvait mettre en exil une femme dans sa propre culture.
Cette culture prise en otage par des colons français qui avaient voyagé jusque là pour prendre ce qui n’était pas à eux. C’est ainsi toutefois que Fadhma apprit à écrire.
Cet exil intérieur, Mary Barnes l’a raconté dans son Voyage à travers la folie . Elle était infirmière lorsque à 42 ans elle commença à éprouver les premiers symptômes de la » schizophrénie « . Accompagnée par Joseph Berke (le psychiatre qui l’accompagna tout au long de ce » voyage » de cinq années), partisan du mouvement de l’antipsychiatrie ; elle put régresser jusqu’à des stades très primitifs de la vie affective, et à travers cette mort symbolique, renaître à elle-même et guérir. Son cas représente la réussite la plus exemplaire des méthodes préconisées par l’antipsychiatrie, opposée aux techniques médicales chimiques de la psychiatrie traditionnelle.
De ces voyages plus oniriques et plus sages de l’enfance ; c’est bien Alice, une petite fille qui va au pays des merveilles. Elle connaît d’Eve le goût pour les fruits défendus. Comme elle aussi, la chute.
Tout voyage peut présenter des dangers et engendrer des souffrances. Il existe certains voyages dont on ne revient pas. La mort est le plus ultime.
Mais le voyage est celui de l’exploratrice qui brise les tabous, abandonne mari et enfants quand elle choisit tout simplement de ne pas en avoir. L’Anglaise Isabella Bird, malade part, en 1873, serrée dans son corset et entravée par ses robes jusqu’aux chevilles. d’abord en Australie aux Iles Sandwich, qu’elle adora et sur laquelle elle a écrit son deuxième livre . Elle part ensuite aux Etats-Unis car elle a entendu dire que l’air était excellent pour les infirmes. Les femmes perdues peuvent voyager. La maladie elle aussi est un exil. Elle repartira à la fin de sa vie comme missionnaire. Christel Mouchard, dans Aventurières en crinoline (Points/Seuil) raconte les nombreuses aventures de ces femmes qui avaient parfois bien du mal à abandonner leurs préjugés.
A la question: « Pourquoi voyager? », Ella Maillart, née en 1903 répondait: « Pour trouver ceux qui savent encore vivre en paix. »
Mais celle qui sut le mieux allier l’expérience du voyage à la philosophie et qui me permettra de clore cet article sur les femmes et le voyage est sans aucun doute la magnifique Alexandra David-Néel, née à Paris en 1868, dont j’avais lu avec passion les aventures lorsque j’étais adolescente. En 1923, elle part à pied, et marche300 kilomètres ? Elle pénètre dans Lhassa, la ville interdite, (Voyage d’une Parisienne à Lhassa (Plon)). Elle se convertit au bouddhisme.
On peut dire que pour une femme , le premier voyage, fut de se risquer seule sans mari, sans père, sans personne à ses côtés. Le deuxième moment du voyage fut la conquête des idées et de la philosophie et le dernier voyage est sans conteste la conquête de l’égalité. Au fond, femme et voyage sont exactement synonyme.











 (Source : printemps des poètes)
(Source : printemps des poètes)