Leïla Sebbar: Travail de ménagère, travail d’écrivaine (1986)
Texte de Leïla Sebbar
L’ordre de la maison est aussi tyrannique, jubilatoire ou meurtrier, que l’ordre de l’écriture.
Une femme est capable de souffrir, soudain, d’insomnie réelle, si la vaisselle a été oubliée dans l’évier, si le fond de la cocotte, brûlée par accident n’a pas été récuré énergiquement à temps, ou si elle n’a pas retrouvé, à la place où elle devait être rangée, au moment du grand nettoyage de printemps, la couverture d’enfant dont elle a absolument besoin, là tout de suite…
Tout objet domestique déplacé, contrevenant à l’ordre établi par celle qui fait le travail, au jour le jour, devient un objet de torture mentale. Et comme les objets ne manquent pas dans une maison…
Pour une femme qui écrit, les obsessions ménagères se trouvent transposées dans sa pratique d’écrivain. L’emploi du temps, de l’espace, du corps domestique, les gestes pour corriger, décrasser, ranger, mettre et remettre en place, harmoniser, les manières qui accompagnent ces gestes, on les retrouve exactement chez la ménagère et chez l’écrivain. La production finale sera différente dans la forme et la fonction de l’objet, mais la similitude dans l’ordonnancement du matériel graphique pour le livre, ou du matériel ménager pour la maison est frappante lorsqu’on y regarde de près. Par ailleurs, les effets du travail d’écriture, pour celle qui a accompli les gestes appropriés suivant le rituel imposé à elle-même, la ménagère ou l’écrivain, qui a travaillé et organisé le travail, rituel dépendant des humeurs et des principes de la maîtresse d’oeuvre.
La ménagère comme l’écrivain, travaille pour un résultat quel qu’il soit, qui lui donnera la certitude ou l’illusion, comme on voudra, qu’elle a accompli une oeuvre aussi vitale qu’une oeuvre d’art. Par sa maîtrise sur les objets de ménage ou d’écriture, elle a réussi à faire une maison, à faire un livre; grâce à une conduite disciplinaire de maintien de l’ordre suivant ses propres critères esthétiques, elle a observé avec obstination son idée de l’harmonie, de la grâce, du charme d’une chambre ou d’une page écrite, d’une maison ou d’un livre.
Ainsi, elle a créé, elle a donné forme et force à un espace qu’on lit des yeux et du corps, livre ou maison.
Comme une maison, un livre est un lieu de vie, un lieu à vivre; même si on sait que la ritualité du ménage, de l’écriture protège contre la folie et la mort, contre l’angoisse de ce qui est à refaire chaque jour, on voudrait croire à l’éternité. Une maison, comme un livre, est un lieu de vie mouvant à créer et recréer sans fin, dans la joie ou le malheur.
Je ne peux écrire que si j’ai un matériel de travail accumulé depuis des mois, engrangé et rangé dans des sous chemises, chemises, cartons étiquetés, comme un fonds de maison complet et ordonné qui servira à alimenter les repas quotidiens. Fonds de maison disponible, à portée de la main, où on peut puiser sans perte de temps, au moment voulu. Fonds de maison conforme aux principes de l’Économie domestique, aux manies culinaires de la maîtresse de maison.
Les chemises volumineuses sont tout près, sur une table chinoise à deux étages, à gauche, prêtes à déverser, dans l’ordre, les notes nourricières pour les textes de longue durée. C’est dans la maison, dans une pièce de la maison, dans un coin de cette pièce, à une table ronde posée contre la fenêtre, que j’écris le mieux. Ailleurs, dehors, dans des lieux de passage, cafés, brasseries, gares, j’écris des textes brefs, je prends des notes, comme on mange dans un Mac-Do. Dans la maison, j’ai besoin d’être seule, sans enfant, ni personne qui me sollicite pour me détourner de mon attention obsessionnelle… Il me faut absolument, à droite de la table, le fouillis ordonné dans le temps, des panneaux où sont affichés, par étapes successives, les images, les objets disparates, indispensables à tel ou tel moment du travail: photographies de presse, cartes postales coloniales, étiquettes, timbres , écussons régionaux, cartes de géographie, paquets de cigarettes Camel, boutons de mercerie, plumes sergent-major, photographies d’enfance, paysages algériens… Je regarde ces panneaux surchargés, surpiqués d’épingles, comme on regarde une armoire ou un vaste placard qu’on ouvre largement pour le plaisir de voir, dans un certain ordre, la vaisselle ou le linge, disposés suivant l’emploi, la taille, la forme ou la couleur et par nécessité. Ces panneaux mythologiques ou réels changent avec le livre, comme varie l’agencement d’une pièce à vivre, d’une cuisine, d’une chambre, selon la saison, l’humeur, l’occasion, mais là aussi par nécessité.
Pour un travail de longue durée, il faut de longues journées, de
longues heures, un temps souple, étale qui s’organise d’après le désir et le besoin, comme lorsqu’on décide de préparer un plat, un dessert sophistiqués ou que la journée entière sera consacrée à la couture. Alors on se lève tôt, c’est un jour faste, on n’a pas envie de rester couchée. Seule dans la maison et dans le silence, la table de travail offerte, je vais écrire plusieurs heures de suite, longtemps, interrompue par un café italien au comptoir du Rond-Point, jusqu’à deux heures de l’après-midi. Je déjeunerai sans la radio, un peu vite et j’écrirai jusqu’au soir où je saurai qu’il est tard, parce qu’il fait presque nuit.
Le bloc de papier pelure blanc et lisse est posé en travers de la table, le stylo Parker noir à côté du bloc. J’aime écrire à la main et que la plume glisse, très vite, très longtemps sur la surface pleine de la page, presque sans marge. Je ne tape pas à la machine. Je ne veux pas apprendre. Je tiens à cet archaïsme, comme une ménagère qui se sert encore d’un moulin à légumes manuel alors qu’on lui a offert un robot-Marie efficace et rapide. Comme si j’étais plus près des mots, plus près de la matière avec ce vieux stylo ordinaire dont la plume s’est usée du côté gauche parce que je n’arrive pas à le tenir droit.
Je ne relis pas le jour-même ce que j’ai écrit; je réserve ce plaisir au lendemain matin où, à nouveau seule, je viendrai m’asseoir à la table, devant les feuilles écrites la veille. De la même manière, une femme en cuisine, en couture diffère le plaisir jusqu’à la jubilation finale, secrète, solitaire. L’objet est terminé suivant ses rites à elle, comme un enfant qu’on sort de soi, achevé, prêt à vivre avec les autres.
Texte paru dans Présence de Femmes:
Gestes acquis, Gestes conquis. Alger: ENAG, Hiver 1986.
Les textes de Leïla Sebbar et les dessins de Sébastien Pignon peuvent être copiés et redistribués librement, avec les restrictions suivantes :
– Les textes et dessins ne doivent pas être publiés sous forme imprimée sans accord préalable écrit de Leïla Sebbar et Sébastien Pignon.
– Les textes de Leïla Sebbar, les dessins de Sébastien Pignon, les photographies et illustrations de Leïla Sebbar ne doivent pas être publiés sous forme électronique ou multimédia, ou inclus dans des compilations, ou mis à disposition sur des serveurs en ligne dont la consultation serait autre que gratuite, sans accord préalable écrit de Leïla Sebbar, de Sébastien Pignon, de Carole Netter et d’Anne-Marie Obajtek Kirkwood.
– Les textes de Leïla Sebbar et les dessins de Sébastien Pignon ne doivent pas être modifiés. Ils doivent être reproduits en entier, ou pas du tout. Aucune « correction » ou édition n’est admise.
– Les textes peuvent être traduits, mais la traduction ne doit pas être publiée sans accord préalable écrit de Leïla Sebbar.
– Lorsqu’ils sont distribués ou copiés, les textes et dessins doivent toujours être accompagnés de la présente notice.

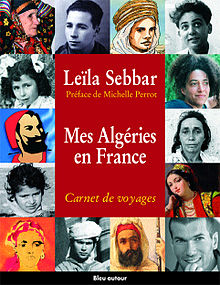























 son premier grand succès, adapté par la suite au cinéma par King Vidor en 1949 (voir Le Rebelle).
son premier grand succès, adapté par la suite au cinéma par King Vidor en 1949 (voir Le Rebelle).
