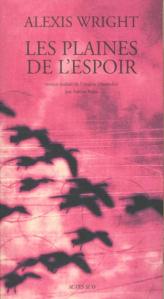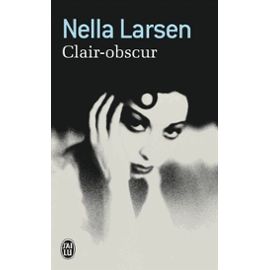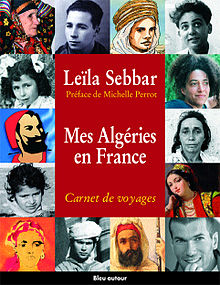Le pur et l’impur a été écrit par Colette à l’âge de 59 ans en 1932. Publié d’abord sous le titre « Ces plaisirs… ». Il possède une dimension autobiographique et la narratrice est bien Colette qui convoque les amis passés, de Marguerite Moreno à Francis Carco, en passant par Renée Vivien et Edouard de Max. Cette autobiographie est aussi une tentative de réflexion sur la jouissance féminine et masculine, sur l’homosexualité, à la manière d’un moraliste, puisqu’il s’agit ici de nommer le pur et l’impur, mais à la manière d’un moraliste qui déjouerait tous les pièges de la morale en vigueur à l’époque. D’ailleurs, le pur est moins ce qui est moralement adéquat que ce qui sonne à la manière d’un cristal, la poésie de la rencontre, des sensations et sentiments, une sorte d’au-delà de la morale, « un infini tellement pur », car les mots aussi acquièrent une résonance, un tremblement de glace…
Le pur et l’impur a été écrit par Colette à l’âge de 59 ans en 1932. Publié d’abord sous le titre « Ces plaisirs… ». Il possède une dimension autobiographique et la narratrice est bien Colette qui convoque les amis passés, de Marguerite Moreno à Francis Carco, en passant par Renée Vivien et Edouard de Max. Cette autobiographie est aussi une tentative de réflexion sur la jouissance féminine et masculine, sur l’homosexualité, à la manière d’un moraliste, puisqu’il s’agit ici de nommer le pur et l’impur, mais à la manière d’un moraliste qui déjouerait tous les pièges de la morale en vigueur à l’époque. D’ailleurs, le pur est moins ce qui est moralement adéquat que ce qui sonne à la manière d’un cristal, la poésie de la rencontre, des sensations et sentiments, une sorte d’au-delà de la morale, « un infini tellement pur », car les mots aussi acquièrent une résonance, un tremblement de glace…
Il est hors de propos d’analyser ce livre, les quelques minutes dont je dispose n’y suffiraient évidemment pas.
Ce livre se présente comme une série de rencontres de Colette avec des amis ou inconnus qu’elle interroge ou qu’elle incite à la confidence. La première partie est celle qui m’a le moins plu, elle raconte la rencontre d’une femme avec son jeune amant dans une fumerie d’opium, le plaisir qu’elle simule pour le conforter dans son assurance de jeune mâle et sa conversation avec un Don Juan qui ne connaît des femmes que la conquête. Il est le misogyne dans toute sa splendeur et sa stupidité. Il est un consommateur qui se plaint de ses conquêtes, de leur donner trop et de ne rien recevoir en échange.
Les deux mondes, ceux des hommes et des femmes sont d’une hétérogénéité qui ne permet pas vraiment la compréhension ; elle fonctionne à la manière d’une frontière qui ne peut être franchie que temporairement dans le feu de la passion. La femme peut offrir son « brave corps de femelle » en même temps que sa vocation de « servante ». Le masculin est ici supérieur au féminin. Peut-être Colette a-t-elle simplement intériorisé les relations entre les hommes et les femmes de son temps. D’ailleurs elle le répète, à la fin du livre, elle est femme de « combat » et non de raisonnement. Enfin, les femmes indépendantes, intelligentes sont « viriles » et représente un danger d’homosexualité pour les hommes, affirme Marguerite Moreno.
La supériorité des hommes tient à leur statut mais ce sont des êtres profondément faibles, « … entends-les crier sous l’effleurement d’une coccinelle et le passage d’une abeille… ». L’organisation sociale repose en fait sur un malentendu, ce sont les femmes les plus endurantes et les plus fortes. La seule bravoure des hommes est de type militaire, dit-elle. D’ailleurs « le lent mâle écarté », « tout message de femme »devient clair et foudroyant.
La seule manière d’échapper à ce monde d’hommes, à sa violence, est l’homosexualité féminine qui est presque maternelle, car les relations sont de « protectrice à protégée », enveloppante. Elle raconte une très belle histoire d’amour entre deux jeux jeunes femmes anglaises de la bonne société au XVIIe siècle qui fuirent et se réfugièrent dans un cottage à la campagne pour y vivre toute leur vie ensemble.
Pas besoin de singer les hommes, d’être leur égale car une femme « qui reste une femme, c’est un être complet ». Il ne lui manque rien.
L’homosexualité masculine montre selon elle « qu’un sexe peut supprimer , en l’oubliant, l’autre sexe. » alors que les femmes lesbiennes le seraient souvent par dépit seulement « préoccupées de l’homme, détractrices hargneuses et apocryphes de l’homme ». D’ailleurs, ces dames en veston ont parfois un mari qu’elle rejoignent, sont souvent bisexuelles et se passent difficilement des hommes. Peut-être le statut de la femme à l’époque la maintient-elle sous la dépendance des conjoints.
J’ai pris beaucoup d’intérêt à la lecture de ce livre qui , selon Colette, était son meilleur livre. Il est un témoignage important sur son époque et certains passages m’ont vraiment emportée.