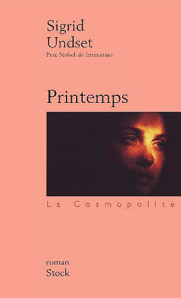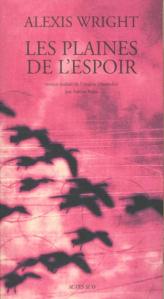Zeruya Shalev – Ce qui reste de nos vies du monde entier Gallimard – 2014 (2011 pour la version originale) Traduit de l’hébreu par Laurence Sendrowicz
Le livre de Zeruya Shalev, tout primé qu’il est, se mérite. J’ai failli l’abandonner plusieurs fois mais toujours quelque chose m’a retenu de renoncer tout à fait. Et la fin vaut vraiment la peine que l’on arrive jusqu’au bout, même suant, haletant et à bout de forces. Un pavé (416 pages) et un récit spiralaire qui avance tout en se répétant, parfois beaucoup. Pourtant ce livre est une œuvre, un bel objet littéraire, très bien écrit, donc très bien traduit et pétri d’intelligence autant que de sensibilité.
Que faire de « Ce qui reste de nos vies », quand il ne reste plus de temps, quand on est au seuil de la mort et que l’on a l’impression d’avoir tout raté, quand on est malheureux dans un couple à bout de souffle, ou quand on arrive à la cinquantaine avec pour (seul ?) horizon la ménopause ? Que faire, se résigner ou avancer quand même, trouver un nouveau souffle ?Un cheval, une bataille, pour ne pas mourir avant de mourir vraiment.
C’est toute la question posée par ce livre brillant à la narration parfois un peu relâchée mais qui traduit bien les hésitations et les atermoiements de ses personnages. Faut-il se résigner et se contenter de ce que l’on a, ou risquer le tout pour le tout, que la vie vaille encore la peine d’être vécue? Parfois on aimerait bien les pousser un peu ou agir à leur place tant on a l’impression de les voir faire du sur-place, mais ce serait trop tôt car chaque personnage a droit à son temps propre, qui est celui de la réflexion et la maturation nécessaire à la prise de décision.
Hemda est au seuil de la mort, et sa conscience part en lambeaux, elle vit à travers ses souvenirs que viennent interrompre un présent indistinct, et la visite de ses deux enfants Dina et Avner à L’hôpital de Jerusalem. Avner y rencontre une femme venue accompagner son amant mourant, et une fois disparue, se met à sa recherche, quant à Dina, quadragénaire insatisfaite, elle assiste à l’éloignement de sa fille adolescente et se met en tête d’adopter un enfant.
Zeruya Shalev analyse finement les relations qui existent entre parents et enfants, les non-dits, le ressentiment et la colère qui les animent parfois, autant que la tendresse et la douceur qui permettent d’avoir un foyer et de se construire. On comprend, on compatit, on s’élance, avec eux, vers une autre vie…
« Quel drôle d’âge, malaisé, soupire-t-elle, quarante-cinq ans, il fut un temps où les femmes mouraient à cet âge-là, elles terminaient d’élever les enfants et mouraient, délivraient le monde de la présence épineuse de celles qui étaient devenues stériles, enveloppe dont le charme s’était rompu. »