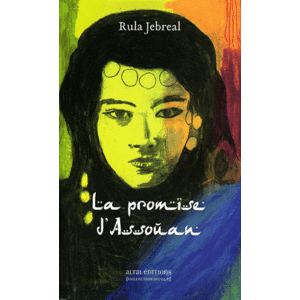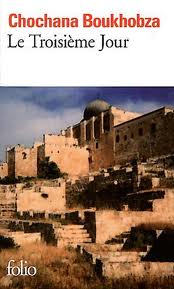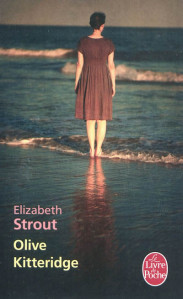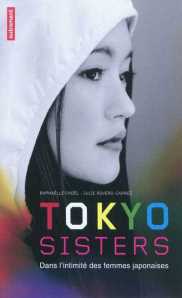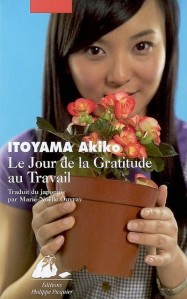Ce livre raconte l’épopée familiale de Mazen Qupti, chrétien copte qui devra fuir avec sa femme et sa fille une Egypte en pleine ébullition pour s’installer dans le Jerusalem des années 20 avant de poursuivre jusqu’à Nazareth pour marier sa fille dont les épousailles ont été arrangées de longue date . Arrivés dans cette ville qui les éblouit, Salua, la fille de Mazen, va être confrontée à une série de drames qui va bouleverser sa vie et l’obliger à prendre son destin en main. Elle assistera à la création de l’Etat d’Israël et à l’effondrement du monde qui était le sien.
Dans la mémoire du père, Jerusalem et la Palestine sont les symboles de la liberté, où chacun peut professer sa foi et vivre sa vie comme il l’entend sans être inquiété. Ville sainte de l’Islam, Terre promise des Juifs, Terre sainte pour les chrétiens, la ville apparaît comme le lieu de coexistence de toutes les différences et de toutes les cultures. L’auteure évoque la porte de Damas, par laquelle tous pénètrent avant de se séparer : « Les Chrétiens sont les premiers à tourner à droite vers la Basilique du Saint Sépulcre », puis les Musulman se dirigent plus loin pour monter vers l’Esplanade des Mosquées, pendant que les Juifs poursuivent en descendant vers le mur des lamentations. Jerusalem est « comme un grand livre blanc ouvert sur le monde, où chacun veut écrire quelque chose dans sa langue».
Mais ce rêve va se briser brusquement : des tensions sont palpables entre la communauté musulmane et les Anglais ; des conflits larvés éclatent à la moindre provocation ou suspicion de part et d’autre. Une violence souterraine agite la ville derrière une apparence de fausse quiétude et de concorde toute relative entre les communautés.
La famille de Salua va en faire l’amère et tragique expérience et sera contrainte de quitter Jerusalem pour Haifa.
Pourtant, ce qui paraissait impossible ailleurs se réalise ici dans cette ville au bord de la mer, à Wadi Nisnas quartier où vivent ensemble Juifs et Arabes. Et si les mariages entre les deux communautés sont rares, ils se produisent de temps à autre.
« Haïfa semblait pouvoir absorber tout ce qui était étranger, mélanger des gens différents… ». Le destin de Salua va se mêler étroitement à celui des deux autres communautés juives et arabes, des liens vont se tisser, des amours vont naître qui aideront à brouiller les frontières, des amitiés se faire et se défaire.
On trouve dans cette histoire encore une fois le thème de l’échange, du bébé palestinien et musulman qui va grandir dans une communauté juive. Mais je ne vous dévoilerai rien sur le nœud de l’intrigue.
La création de l’Etat d’Israël va bouleverser des vies jusqu’ici paisibles et l’histoire de la dépossession et de l’exil commence pour des milliers de Palestiniens. Les Arabes qui restent obtiendront la nationalité israélienne et c’est leur histoire que nous suivons ici, à travers les expropriations, les violences et les menaces dont ils vont faire l’objet.
Les bons sentiments ou les causes justes ne font pas forcément de la bonne littérature, peut-être l’engagement nuit-il même parfois parce qu’il apporte une gravité de commande ou parce qu’il alourdit le récit de démonstrations inefficaces. Encore une fois je n’ai pas été complètement convaincu par ce récit même si je l’ai lu sans déplaisir. Les descriptions y sont très belles et l’amour que porte l’auteure à cette terre est palpable à chaque page. Une narration classique nous fait vivre les péripéties de l’héroïne, on prend fait et cause pour elle, on compatit à ses malheurs mais l’émotion est étrangement absente. Reste le voyage sur cette terre de Palestine infiniment précieux.