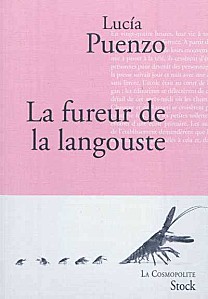Florence Naugrette dirige l’édition collective en cours de l’intégralité des lettres de Juliette Drouet à Victor Hugo sur le site http://www.juliettedrouet.org
Litterama : Bonjour Florence Naugrette et merci de répondre à mes questions ! Vous êtes spécialiste du théâtre de Victor Hugo qui a été l’objet d’une thèse, pourquoi vous être intéressée à sa correspondance avec Juliette Drouet ?
Florence Naugrette : En 2006, j’ai été sollicitée en tant que spécialiste de Hugo, dans le cadre de l’exposition de la Maison Victor Hugo de la place des Vosges consacrée à Juliette Drouet, dont c’était le bicentenaire de la naissance. On m’a demandé d’étudier une année de correspondance de mon choix, parmi les 50 ans de correspondance entre Juliette Drouet et Victor Hugo dont nous disposons, de 1833 (date de leur rencontre) à 1883 (date de la mort de JD). J’ai choisi de présenter les lettres qui précèdent la parution des Misérables, pensant y trouver des remarques intéressantes de la première lectrice de ce roman si célèbre.
A cette occasion, j’ai découvert l’ampleur de cette correspondance, dont je ne connaissais que les anthologies publiées, mais le corpus intégral représente 10 fois plus que ce qu’on connaissait déjà: il y a 22000 lettres environ, soit une lettre par jour!
En lisant l’intégralité des lettres conservées à la BnF uniquement pour la période 1861-1862 (qui précède la publication des Misérables), je me suis rendu compte que leur intérêt déborde largement la simple curiosité qui était la mienne au départ (voir ce que les lettres de Juliette Drouet nous disent de l’œuvre de Hugo, ou nous révèlent de la manière de travailler du grand homme). Elles sont aussi intéressantes en elles-mêmes, pour leur valeur documentaire sur la vie de Juliette Drouet, et sur toute l’histoire du XIXe siècle.
Litterama : A votre avis, l’écriture de Juliette Drouet, à travers ces lettres, représente-t-elle une écriture de soumission ou la tentative inconsciente de reconquérir une liberté perdue ? Pourquoi écrit-elle ces lettres à Hugo ?
Florence Naugrette : Votre question est très pertinente: la réponse est qu’il s’agit des deux à la fois, paradoxalement.
Très vite dans leur relation, Victor exige de Juliette Drouet, qu’il entretient, de lui rendre compte jour par jour de son emploi du temps. Il la surveille, et veut donc vérifier qu’elle ne le trompe pas (il est très jaloux), qu’elle reçoit uniquement les amis ou connaissances qu’il l’autorise à fréquenter, qu’elle ne dépense pas inconsidérément (il faut dire qu’il rachète une dette énorme qu’elle avait contractée avant de le connaître). Ces comptes rendus journalier portent le nom de « restitus »: c’est ainsi que Juliette Drouet les nomme elle-même, et cela signifie qu’elle lui « restitue » son emploi du temps et son état d’âme. Dans cette mesure, on peut dire que les lettres participent de sa soumission.
Souvent, d’ailleurs, Juliette Drouet n’en voit pas l’intérêt, et écrit que ces « restitus » ne servent à rien: elle se lasse d’avoir à les écrire lorsqu’elle considère qu’elle n’a rien d’intéressant à raconter, et à plusieurs reprises elle réclame le droit d’interrompre cette obligation qu’il lui fait de lui écrire chaque jour.
Mais finalement, elle reconquiert aussi une part de cette liberté perdue dont vous parlez, à l’intérieur de l’espace de la lettre. Certes, elle ne peut pas tout dire, puisqu’il ne s’agit pas d’un journal intime, mais néanmoins, dans le cadre de ce qu’elle peut s’autoriser à lui dire, elle développe au fil du temps une grande liberté de parole: elle ne fait pas que déclarer son amour et sa soumission, elle se plaint aussi, souvent, revendique des droits, réclame (des voyages, notamment, car ce sont les moments privilégiés où elle vit avec lui, loin de la société parisienne qui les empêche de vivre ensemble, à une époque où, rappelons-le, le divorce est interdit), donne son avis sur la politique (pendant la Révolution de 1848, par exemple, ou bien en exil, où elle le met en garde contre les mouchards de Napoléon III qui se font passer pour des proscrits). Elle acquiert une authentique conscience politique au contact de Hugo, et l’exprime dans ses lettres. Enfin, la qualité de son écriture d’épistolière s’améliore au fil des ans, et lui fait gagner une véritable liberté d’expression, de style: ses lettres sont une œuvre, à leur manière, même si elles n’étaient pas écrites pour une publication.
Litterama : N’est-elle qu’un épiphénomène ou dit-elle quelque chose de l’écriture féminine au XIXe siècle ? N’est-elle pas le négatif d’une écriture féminine conquérante comme celle de George Sand ? Vous dites d’ailleurs que «sur la condition de la femme entretenue, Juliette Drouet est un archétype mais aussi une fine analyste. » Quel rôle joue l’écriture dans son existence ?(Elle évoque souvent la postérité de ses lettres ainsi que vous le soulignez).
Florence Naugrette : L’écriture personnelle des femmes, sous la forme du journal, était encouragée. Au départ, il s’agit d’une pratique proche de la confession, à destination d’un confesseur, ou de la mère supérieure du couvent pour les jeunes filles qui y étaient éduquées. Philippe Lejeune explique très bien cela dans son livre Le Moi des demoiselles. Le lien des l’écriture féminine avec la sphère de l’intime est donc encouragé sous cette forme, au XIXe siècle. Si cette forme encourage l’introspection, elle n’est en revanche pas destinée à la publication.
L’écriture des lettres à Hugo occupe une place centrale dans son existence: ce rituel journalier structure sa journée, comme l’indique l’heure des lettres, soigneusement notée. Elle lui permet, je crois, de ne pas sombrer dans une dépression qui la guette parfois, tant sa vie est solitaire, et de meubler l’absence de Hugo, qui, surtout dans les années 1840 où elle est particulièrement malheureuse, ne vient pas la voir tous les jours, et la délaisse quelque peu, tout en continuant de la maintenir sous sa coupe.
Pendant l’exil, paradoxalement, elle est plus heureuse, car Hugo ayant une vie sociale moins trépidante qu’à Paris, est plus disponible pour elle, et vient lui rendre visite très régulièrement. L’écriture épistolaire de Juliette Drouet évolue, d’ailleurs, à cette époque: elle philosophe davantage, utilisant la lettre toujours pour prendre des nouvelles et exprimer son amour, mais aussi, avec de plus en plus de liberté, pour donner son opinion sur la politique, la vie des autres, la marche du monde.
Quant à la postérité de ses lettres, elle l’évoque de manière récurrente: elle savait que Hugo gardait ses lettres, et qu’un jour, peut-être, d’autres que lui les liraient. Tomber sur une de ces remarques est particulièrement émouvant pour le transcripteur, car elle s’adresse alors, indirectement, à nous.
Litterama : Les femmes du XIXe siècle ne peuvent-elles écrire sans détours ? Georges Sand utilise un pseudonyme masculin, Juliette écrit des lettres à son amant…
Florence Naugrette : Il est vrai que les exemples de femmes auteurs sont rares au XIXe siècle, ou alors il leur faut le plus souvent, comme George Sand, prendre un pseudonyme, afin de se faire une place dans un champ éditorial fondamentalement masculin. C’est ce que font aussi à la même époque Marie d’Agoult (qui signe Daniel Stern), ou Delphine de Girardin (qui prend divers pseudonymes, dont le Vicomte de Launay). A la fin du siècle, la comtesse de Ségur n’a plus besoin de ce subterfuge, mais elle écrit principalement pour la jeunesse, dans une perspective l’édification morale où le rôle des femmes est mieux admis.
A la différence de ces femmes de lettres reconnues et admises dans la bonne société, Juliette Drouet, elle, n’envisage à aucun moment de devenir une femme-auteur, de publier. Son origine sociale très modeste, et son passé d’actrice entretenue la condamnent d’ailleurs à rester dans l’ombre. Elle a pourtant écrit des souvenirs, non destinés à la publication, mais voués à être réutilisés par Hugo dans Les Misérables: ce sont ses souvenirs de couvent. Elle a aussi tenu pour lui des journaux de certains de leurs voyages, parfois réutilisés par lui dans son œuvre. Elle se conçoit auprès de lui comme une collaboratrice, un soutien moral, mais à aucun moment l’idée qu’elle puisse être auteur elle-même ne lui traverse l’esprit. Quand il lui arrive, dans ses lettres, de commenter son propre style, elle le fait toujours au second degré, pour s’en moquer, ou mettre ses effets rhétoriques à distance.
Litterama : A votre avis, comment faut-il lire ces lettres ? Quel est selon vous leur intérêt pour le grand public ?
Florence Naugrette : Il y a, me semble-t-il, quatre manières de lire ces lettres: la manière anthologique, la manière suivie, la manière savante et la manière aléatoire.
La manière anthologique: plusieurs anthologies de ces lettres sont disponibles dans le commerce (elles sont recommandées sur le site). Le choix opéré par les éditeurs est le plus souvent celui des lettres les plus spectaculaires, qui correspondent à l’expression de sentiments forts, ou font écho à de grands bouleversements dans la vie de Juliette Drouet et Victor Hugo.
La manière suivie est celle que permet l’édition en ligne en cours, où nous proposons, au fil des mises en ligne, des séquences d’un mois entier de correspondance. Elle permet de mesurer la dimension « diaristique », comme on dit, de ces lettres: le fait qu’il s’agit aussi d’un journal personnel, adressé (c’est pourquoi ce n’est pas un journal « intime » inviolable), certes, mais qui rend compte de préoccupations quotidiennes, des « travaux et des jours ». C’est celle que je préfère, pour ma part, et qui motive l’entreprise dont j’ai pris l’initiative: publier intégralement les 22000 lettres de ces lettres-journal, et y donner accès gratuitement à tous.
La manière savante est aussi permise par notre édition en ligne: un moteur de recherches permet de retrouver dans les lettres toutes ses allusions à la vie théâtrale de son temps, aux événements et personnalités politiques, littéraires, artistiques. Des notices des noms de toutes les personnes citées constituent une sorte de Who’s who du XIXe siècle. Ce site peut être une mine pour les historiens.
La manière aléatoire, déjà pratiquée par des internautes qui m’ont témoigné leur intérêt pour le site, consiste à se laisser guider par le hasard, et surprendre par la plongée surprise dans telle ou telle journée de la vie de Juliette Drouet. Un frisson historique est alors ressenti par ce contact comme en direct avec une journée ordinaire d’une femme éloignée de nous par un siècle et demi, mais rendue proche de nous à la fois par son humanité simple, et ce témoignage conservé.
Litterama : Quel écho peuvent avoir ces lettres chez les femmes d’aujourd’hui ?
Florence Naugrette : Il y a à la fois un effet de proximité, et de distance. La proximité est dans l’humanité profonde de ces lettres, où tout un chacun peut se retrouver, et pas seulement les femmes. La distance est dans l’étonnement, voire le scandale, que l’on peut ressentir, en constatant dans quel état de dépendance extrême (matérielle, morale, sociale et sentimentale) se trouvait cette femme par rapport à l’homme qui l’entretenait.
Ce qui est typique, non pas d’un hypothétique (et sans doute illusoire) « éternel féminin », mais d’une posture féminine historiquement et socialement déterminée (Juliette Drouet est la maîtresse entretenue de Hugo au début de leur relation), c’est la relation de soumission et de dévouement absolu. Elle s’exprime par des déclarations d’amour et d’obéissance qui peuvent surprendre par leur régularité systématique et leur caractère hyperbolique.
Ce à quoi, néanmoins, les femmes d’aujourd’hui peuvent être particulièrement sensibles, à une époque où l’on repense le « soin » dispensé à autrui comme une relation morale qui ne leur incombe pas exclusivement, c’est le dévouement de Juliette Drouet par rapport à Hugo, tel qu’elle l’exprime et le théorise: elle considère qu’elle est là pour le servir, non pas comme une esclave, mais pour prendre soin de lui, au sens où les philosophes du « care » l’entendent aujourd’hui.
Litterama : Pourriez-vous citer le passage d’une lettre qui vous a touchée, que vous aimeriez lire à une amie ?
Florence Naugrette : Je choisis délibérément une lettre exceptionnelle, d’une qualité littéraire et d’une élévation d’âme remarquables, écrite en exil. Elle témoigne des doutes de Juliette Drouet sur l’utilité même de ces lettres. Y transparaît le rapport complexe entre le principe même de l’écriture des lettres et la nature de leur relation.
Jersey, 1er février 1853, mardi après-midi, 1 h.
On comprend l’utilité des cailloux entassés sur les bords des routes, des moellons apportés sur un terrain vague, des chiffons, des tessons et des débris de toutes sortes ramassés au coin des bornes par un chiffonnier philosophe, parce que les cailloux comblent les ornières du chemin, les moellons font des maisons et les tas d’ordures font de tout quand on sait s’en servir. Mais il m’est impossible de deviner, avec la meilleure volonté du monde, à quoi servent mes stupides gribouillis à moins que ce ne soit comme critérium de l’ineptie humaine. Mais encore, à ce compte-là, il y a longtemps que vous avez dû savoir ce que jaugeait la mienne pour n’avoir plus besoin d’être édifié à ce sujet. Quant à servir à autre chose, je n’en vois vraiment pas la possibilité depuis bien longtemps. Autrefois, cela servait de trait d’union entre nos deux âmes quand ton cher petit corps s’échappait à regret de mes bras. Mais maintenant je le demande, la main sur la conscience, à quoi peuvent servir ces maussades élucubrations, sans air, sans baisers, sans soleil, sans amour, sans esprit, sans bonheur ? Evidemment à rien ou à pire que rien. Tu es trop sincère au fond pour ne pas reconnaître la justesse de ces tristes observations et trop juste pour insister sur une vieille habitude que rien ne motive plus. Voilà bien longtemps et bien des fois que je t’ai fait faire cette remarque mais jusqu’à présent tu n’en as pas tenu compte par un sentiment d’exquise politesse que j’apprécie mais dont j’aurais honte d’abuser indéfiniment. Aussi je te supplie, renonçons-y simplement et honnêtement une fois pour toutes, et n’en soyons que meilleurs amis pour cela.
Juliette
© BnF, Mss, NAF 16373, f. 123-124, transcription de Bénédicte Duthion assistée de Florence Naugrette
Litterama : Vous écrivez beaucoup sur le théâtre, et vous avez dirigé de nombreuses publications également sur le sujet, d’où est né cet intérêt ? A votre avis quelle est la spécificité de cette écriture ?
Florence Naugrette : Ma spécialité première est l’histoire du théâtre, notamment celui du XIXe siècle. L’auteur sur lequel portent une grande partie de mes publications est Victor Hugo (j’ai aussi écrit sur sa poésie, sur sa biographie écrite par sa femme). C’est par ce biais que j’ai découvert la correspondance que Juliette Drouet lui adresse.
Ce qui aiguise aussi ma curiosité avec ce corpus, c’est le caractère particulier du genre épistolaire, pratiqué par cette femme qui n’est pas un écrivain. Ce n’est pas exactement le même rapport à l’écriture que celui que peuvent avoir les épistoliers Mme de Sévigné, Voltaire, ou Flaubert, qui soit élaborent sciemment leur correspondance comme un genre littéraire, en sachant que leurs lettres circuleront, soit sont par ailleurs déjà des écrivains. On a affaire avec Juliette Drouet à ce que les linguistes appellent un « scripteur ordinaire ».
L’autre spécificité de cette écriture, c’est la proximité entre lettre et journal, que Françoise Simonet-Tenant a bien étudiée, en s’appuyant sur d’autres auteurs, dans son ouvrage sur ce qu’elle appelle les « affinités électives » entre ces deux modes d’écriture personnelle qu’on aurait tort d’opposer de manière binaire, en considérant que la lettre est adressée tandis que le journal est privé. Il y a des points de rencontre entre les deux genres, et les lettres de Juliette Drouet à Victor Hugo en sont un exemple frappant.
Litterama : Pensez-vous, pour finir, qu’il y ait une écriture féminine ?
Florence Naugrette : Je n’en sais rien, honnêtement, et ne suis pas assez férue en « études de genre » pour vous répondre. Instinctivement, en tout cas, je ne le pense pas.
Litterama : Quelles sont les auteurs féminins qui vous ont marquée ? Quels sont les deux derniers romans de femme que vous avez lus ?
Florence Naugrette : J’aime beaucoup George Sand, qui a écrit beaucoup plus qu’on ne le croit, et notamment du théâtre. Je recommande la lecture de sa correspondance, très impertinente, pleine d’imprévus. Et aussi son roman Nanon, accessible en livre de poche. C’est une très belle histoire d’amour et d’ascension sociale pendant la Révolution.
J’ai découvert aussi récemment une femme poète américaine, Eleanor Wilner, dont l’œuvre me touche beaucoup, notamment pour sa manière de relier les émotions personnelles à la mémoire culturelle.
Pour vos lectrices et lecteurs qui lisent l’anglais, je recommande aussi les « Dreamscapes » de Mary Shaw, accessibles en ligne sur le site du Mouvement Transitions (http://www.mouvement-transitions.fr); ce sont des textes à la première personne, qui disent, de manière émouvante, mais sans aucun pathétique, la perception éphémère du monde qui entoure une femme d’aujourd’hui, ses souvenirs d’enfance, ses désirs fugitifs, la manière dont elle perçoit sa place mouvante parmi les autres.
Les deux derniers romans de femme que j’ai lus sont ceux de Florence Noiville, La Donation et L’Attachement, parus chez Stock. Ce sont des autofictions qui traitent de la violence de certaines relations familiales, de la difficulté à hériter du passé parental, de l’angoisse de transmettre les fêlures familiales à ses propres enfants, mais aussi des facultés de résilience et de l’appétit de vivre qui permet d’y échapper. Ce sont des romans pleins d’esprit et d’inventivité narrative.
Litterama : Dans un article de Télérama , SB G souligne le peu de femmes auteures ou metteuses en scène représentées dans un grand nombre de théâtres parisiens, qu’en pensez-vous ?
Florence Naugrette : On ne peut qu’être d’accord avec cet article. Le constat serait le même, d’ailleurs, au Festival d’Avignon, et ce, malgré la présence d’une femme dans l’actuel binôme de direction. Pourtant, des metteurs en scène comme Ariane Mnouchkine ou Brigitte Jaques-Wajeman font un travail extraordinaire. A Rouen, où j’habite et où j’enseigne, je ne manque aucun spectacle de la Compagnie Catherine Delattres, qui fait un travail d’une finesse et d’une intelligence remarquables, et je m’étonne qu’on ne lui confie pas la direction d’une structure importante. De là à imaginer une politique de quotas, comme le fait l’auteur de l’article de Télérama que vous citez, il y a un pas que je ne franchirai certes pas: on ne peut pas légiférer comme en politique en matière de création artistique.
Merci à Florence Naugrette pour ces réponses passionnantes et cet éclairage précieux.
Née en 1963, ancienne élève de l’ENS-Sèvres, agrégée de Lettres Modernes, Professeur de Littérature française des XIXe et XXe siècles à l’Université de Rouen. Directrice-adjointe du CÉRÉdI. Elle a déjà accompli un travail considérable dans la direction de plus d’une dizaine d’ouvrages collectifs dont « La poésie dans le théâtre contemporain », textes réunis avec Marianne Bouchardon, la publication de nombreux articles, des traductions de l’oeuvre de Robert Harrison, et de nombreuses préfaces, notes à des éditions de Victor Hugo et Alfred de Musset.