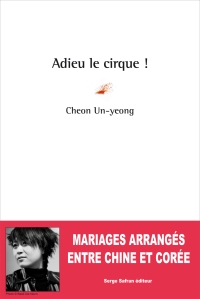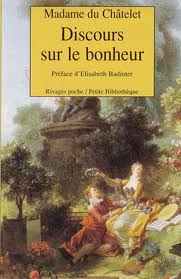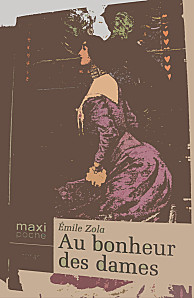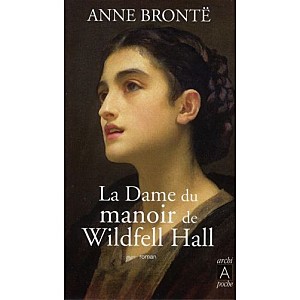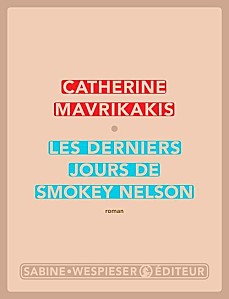Adieu le cirque Cheon Un-yeong, traduit du coréen par Seon Yeong-a et Carine Devillon, Serge Safran 2013
Inho, jeune coréen qu’un accident a privé de sa voix, cherche une femme pour échapper à sa solitude. Une curieuse agence matrimoniale le met en relation avec la troublante Haehwa, jeune chinoise qui veut oublier un amour perdu. Sont-elles plus douces, plus patientes, plus dociles ces jeunes femmes que l’on va chercher si loin ?
Et ces jeunes coréens sont-ils plus prospères, plus à même de subvenir aux besoins d’un foyer ?
Tout semble s’annoncer sous les meilleurs auspices : la jeune femme semble s’épanouir et établit avec sa belle-mère des liens faits de confiance et de tendresse, le jeune homme est attentionné et disponible. On entend bien de fâcheuses histoires sur ces unions arrangées mais cela semble ne pas concerner nos deux tourtereaux !
Mais Yunho, le frère de Inho, est troublé lui aussi par la douce Haewa.
Le feu couve sous la cendre, un geste qui semblait tendre recèle sa part de violence, même la misère qu’on croyait vaincue se révèle plus têtue qu’on ne croyait, et finalement sous une parole douce gronde une imperceptible colère. Le drame, terrible, se tisse de fils de soie. …
« Peut-être la vie n’est-elle qu’un spectacle de cirque, au dur et doux parfum de nostalgie… »
Dans le roman alternent les voix de Haewa et Yunho, qui s’appellent, se cherchent, sans jamais vraiment se répondre. Ce roman est d’une poignante beauté et d’une terrible mélancolie. Il m’ a fallu quelques semaines pour me défaire de cette émotion qu’il a suscitée en moi. La violence entre les êtres est d’une certaine façon la conséquence d’une violence plus souterraine et profonde, une violence sociale et politique. Les personnages sont pris dans des rets dont ils ne peuvent se défaire. La langue est belle, et l’on peut saluer la co-traduction de Seon Yeon-a et Carine Devillon. On se laisser bercer par la beauté de ces images. Une syntaxe parfaitement maîtrisée et de très belles métaphores filées de mains d’écrivaine douée, très douée…
La nature a la beauté des estampes japonaises sous le pinceau-crayon de Cheon Un-Yeong. « Au moindre coup de vent, les fleurs épanouies des pêchers déployaient leurs ailes comme des papillons frappés d’étonnement. »
Un vrai coup de cœur pour moi.
Aux éditions Serge Safran, il y une fée nommée Clarisse, que je remercie. Si vous ne me croyez pas …