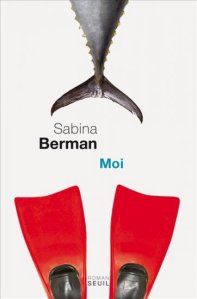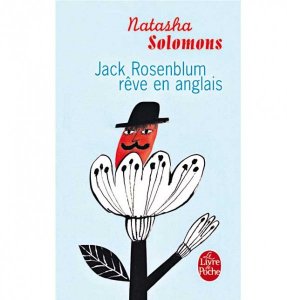En ce mois de novembre enfiévré par les prix littéraires et notamment le Prix Fémina, une occasion de lire ou de relire celles qui furent parmi les premières primées.
Prix Fémina 1910 – Marguerite Audoux.
Née en 1863 à Sancoins dans le Berry, Marguerite Audoux est couturière. Elle écrit pour tromper l’ennui et la misère et aussi certainement pour la distraire de sa solitude. Ce n’est que tardivement, la quarantaine passée, que Marguerite Audoux, pauvre et malade, connaîtra le succès. Elle écoulera pourtant 75 000 exemplaires de Marie-Claire qui obtiendra le prix Femina en 1910. Octave Mirbeau en écrivit un vibrant éloge en guise de préface :
« Marie-Claire est une œuvre d’un grand goût. Sa simplicité, sa vérité, son élégance d’esprit, sa profondeur, sa nouveauté sont impressionnantes. Tout y est à sa place, les choses, les paysages, les gens. Ils sont marqués, dessinés d’un trait, du trait qu’il faut pour les rendre vivants et inoubliables. On n’en souhaite jamais un autre, tant celui-ci est juste, pittoresque, coloré, à son plan. Ce qui nous étonne surtout, ce qui nous subjugue, c’est la force de l’action intérieure, et c’est toute la lumière douce et chantante qui se lève sur ce livre, comme le soleil sur un beau matin d’été. Et l’on sent bien souvent passer la phrase des grands écrivains : un son que nous n’entendons plus, presque jamais plus, et où notre esprit s’émerveille ».
Le roman de Marguerite Audoux est en grande partie autobiographique : elle y raconte la mort de sa mère, son enfance passé à l’orphelinat, et son adolescence dans une ferme solognote où elle est placée comme bergère. La grâce de ce roman tient aux non-dits qui le tissent, lui donnant une sorte de mystère et de profondeur. La petite fille raconte toute une série d’événements qui semblent incompréhensibles à ses yeux d’enfant ; on comprend pourtant ce qui est tu, les souffrances, et les regrets d’adultes qui ont manqué leur vie. Ce regard d’enfant est d’une grande fraîcheur et restitue un milieu et une époque qui nous sont assez méconnus, loin de la grande Histoire, au plus près du quotidien des petites gens où le destin est marqué en grande partie par la condition et le milieu social et où la fortune, parce qu’elle est l’apanage de privilégiés dans une société souvent injuste, est aux mains d’une bourgeoisie soucieuse de ne pas se mésallier.
La langue de Marguerite Audoux est belle, équilibrée, simple sans être pauvre. Son grand sens de l’observation lui permet de croquer presque sur le vif des situations cocasses : ainsi lorsqu’elle raconte l’épisode de sa communion : « Je tombais sur les genoux dans le confessionnal, et tout aussitôt, la voix marmottante et comme lointaine de Mr le curé me rendait un peu confiance. Mais il fallait toujours qu’il m’aidât à me rappeler mes péchés : sans cela j’en aurais oublié la moitié.
A la fin de la confession, il me demandait toujours mon nom. J’aurais bien voulu en dire un autre, mais en même temps que j’y pensais, le mien sortait précipitamment de ma bouche. »
Un livre qui restera dans l’histoire littéraire et marqua d’une pierre l’entrée des femmes dans un milieu littéraire qui leur était encore assez fermé, pour ne pas dire hostile.
Une bonne raison de continuer mon entreprise d’exhumation des textes féminins et de poursuivre mes tentatives d’archéologie littéraire…
Challenge La Belle Epoque (1879-1914)