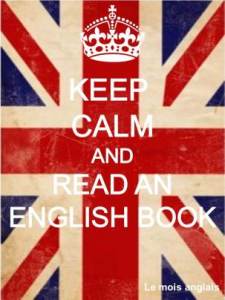Voyager , dans son propre pays ou ailleurs, c’est aller à la rencontre des autres, provoquer le destin ou laisser celui des autres croiser le nôtre et le modifier.
C’est en allant à Curemonte, qui est un très beau village corrézien perché sur une colline, dont toutes les maisons sont soigneusement conservées, ses vielles pierres luisant sous le soleil, que j’ai fait la connaissance de Colette de Jouvenel par le biais d’une exposition sous la halle aux grains retraçant une fois encore la vie de la « Grande » Colette, sa mère, mais évoquant également la sienne, et notamment les quelques années qu’elle passa dans ce village pendant l’Occupation et l’intense atcivité de résistante qu’elle y déploya. Son visage, étrangement émouvant sur les photographies, la solitude qu’on peut lire sur ses traits et une espèce de mélancolie a attisé ma curiosité et j’ai cherché à en savoir un peu plus. 2013 étant le centenaire de sa naissance, une exposition lui avait été consacrée jusqu’au 15 juillet.
Mais il a fallu que j’aille visiter les « jardins » de Colette, l’écrivain, à Varetz, pour trouver plus d’informations sur sa fille, grâce au livre notamment de François Soustre, « Colette de Jouvenel en Corrèze ». Ce parc est situé à côté de Castel-Novel, propriété qui domine la commune de Varetz et fut la demeure paternelle où Colette de Jouvenel passa son enfance confiée aux bons soins d’une nourrice anglaise. Je me suis également procuré « Lettres à sa fille » publiées sous la direction de Anne de Jouvenel, nièce de Colette de Jouvenel, afin d’éclairer ces relations mère-fille si compliquées. Les différencier déjà est difficile puisque l’écrivain Colette a prénommé sa fille Colette. Seule la fille issue de l’union de l’écrivain Colette et de Henri de Jouvenel s’appelle en droit Colette de Jouvenel. L’écrivain se nomme Gabrielle Sidonie Colette et Colette n’est pas un prénom mais un nom de famille qu’elle utilisera comme nom de plume. Même de manière posthume, la fille de l’écrivain aura beaucoup de mal à avoir une place d’autant plus que sa mère utilisait aussi le même patronyme ! Afin de les différencier j’utiliserai toujours Colette de Jouvenel pour parler de la fille de l’écrivain puisque c’est son véritable patronyme.
A vrai dire, le visage de l’écrivain s’est progressivement effacé, pour laisser place à celui de Colette de Jouvenel dont le destin tourmenté, m’a en quelque sorte happée grâce au talent de François Soustre.
Elle est fille unique de Colette et de l’homme politique Henry de Jouvenel, tout deux fort occupés à leur carrière sinon à leurs amours. « Quelle fichue situation d’être la fille de deux quelqu’un, elle a un sacré besoin de s’appeler Durand, ma fille. » écrivait Colette, l’écrivain, à une amie.
Colette de Jouvenel tint peut-être de sa mère son goût pour l’écriture car elle publia quelques articles dans la presse parisienne au lendemain de la Seconde guerre mondiale, composa des contes, des chansons, et tint un journal dont François Soustre donne quelques extraits avec l’autorisation de Anne de Jouvenel. Peut-être un jour sera-t-il publié et pourrons-nous le lire.
Née en 1913, Colette de Jouvenel a un an lorsque la première guerre éclate et ses parents n’ont guère le temps de s’occuper d’elle : son père va rejoindre le front et sa mère contribue à la rédaction du « Matin », elle est confiée alors à la garde d’une nurse anglaise, Miss Draper jusqu’en 1922.
« Miss Draper, pudeur,hygiène et châtiment, aima loyalement et profondément « le petit fille », matant un peu trop son penchant latin à la tendresse fougueuse. », écrit-elle.
Elle va à l’école de Varetz avec les autres enfants de la commune avant de devenir pensionnaire à l’internat de Saint-Germain en Laye. Elle y fait l’apprentissage d’une terrible solitude : « C’est au lycée de Saint-Germain que je commençai à voir que je n’appartenais pas aux miens. Au bout de quelques mois, je commençai à rêver de pouvoir être à d’autres. A des parents comme ceux dont mes compagnes étaient dotés. S’ils devaient venir le jeudi ou le samedi, ils venaient, ceux des autres ». Elle retrouve les siens pour de brefs séjours à Castel-Novel ou à Rozven en Bretagne.
Puis elle va étudier Outre-Manche dans la petite ville de Clifton, près de Bristol avant d’être inscrite dans un établissement du VIe arrondissement à Paris où elle prendra des cours de sténographie et de secrétariat.
« On ne sut jamais que la peinture m’eut rendue heureuse, sinon géniale. Je n’en savais rien non plus, je n’indiquais aucune préférence, bien que je me sois honorablement tirée de quelques essais au Lycée de Versailles où je profitai, pendant les deux mois qui précédèrent mon expulsion de l’établissement, des leçons d’un charmant avec lavallière à pois et chapeau à larges bords. »
Les résultats de Colette de Jouvenel sont désastreux et elle est expulsée de deux établissements privés, avant d’être orientée, en désespoir de cause, vers l’apprentissage de la couture. Son père se remarie avec Germaine Louis-Dreyfus et si Colette de Jouvenel ne sympathise pas avec sa belle-mère, elle s’entendra très bien en revanche avec sa fille Arlette qui épousera plus tard son demi-frère Renaud. Et sa mère convole également en justes noces quant à elle avec Maurice Goudeket.
Pour ne pas être en reste peut-être, en 1935, Colette de Jouvenel épouse Denis Dausse, docteur en médecine, pour divorcer peu de temps après. Ses parents la soutiennent mais son père meurt quelques mois plus tard, ce qui l’affecte profondément.
Elle devient assistante de réalisation et travaille auprès de Solange Bussi pour le tournage de La Vagabonde en 1931, puis avec Marc Allégret pour Le Lac aux dames en 1934 et avec Max Ophuls pour Divine en 1936.
Elle abandonne la réalisation pour exécuter des travaux de traduction avant finalement de bifurquer vers la décoration. Mais la guerre éclate et Colette de Jouvenel se réfugie en Corrèze à Curemonte, qu’elle appellera sa « Toscane limousine » dans le château familial acheté en 1912.
Elle se rapproche des antifascistes du coin, les Videau, couple d’instituteurs, et Berthe Vayssié qui tient le café-bar-épicerie du village. Colette de Jouvenel commence par mettre en place un circuit de ravitaillement efficace puis participe de plus en plus à des activités de résistance. Elle accueille sa mère qui a fui sa Seine-et-Oise et se révèle une invitée irritable, qui tourne sur elle-même et accable ses proches de récriminations. Pour finir elle tombe malade et Colette de Jouvenel s’occupe d’elle avec dévouement. Mais après quelques mois elle décide de revenir en région parisienne tant elle s’ennuie dans ce petit coin de province.
Les retrouvailles, encore une fois, n’ont pas eu lieu. Colette de Jouvenel pense à fonder une revue mais son projet sera refusé par Vichy, les valeurs issues de la « Révolution nationale » n’entrant dans son plan éditorial. Elle se met au service de l’OSE (Organisation de secours aux Enfants) par l’intermédiaire de sa belle-sœur ; il s’agit de mettre à l’abri des enfants dont les parents ont été arrêtés ou déportés. En 1943, elle fréquente André Malraux, et Josette Clotis, sa compagne, Emmanuel Berl et sa femme Mireille, chanteuse qui ne peut plus travailler étant juive. Si elle n’appartient officiellement à aucun mouvement de résistance, elle est en charge de missions précises dans les rangs de l’opposition active au STO.
Colette de Jouvenel vit deux histoires amoureuses d’abord avec Simy Wertheim, puis Jocelyne Alatini un peu plus tard qui lui permettent de trouver un peu de joie dans cette période sombre et agitée. Mais la guerre se termine et Colette de Jouvenel aimerait écrire. Depuis quelque temps elle tient un journal où elle note ses impressions.
Elle lui confie: « Si je me relis, je m’attendris presque : pauvre de moi qui tente à trente et un ans d’apprendre à penser, à la manière d’un devoir de philosophie d’adolescent, parce que personne ne t’a appris à penser. Mais aussi, c’est que je ne peux exprimer librement ma pensée, pour n’avoir pas accepté les contraintes qui m’eussent été nécessaires pour y parvenir – écrire chaque jour, dompter style et pensée. »
A la fin de la guerre, elle est nommée présidente du Comité social et sanitaire, il s’agit de remettre de l’ordre dans les différents établissement publics qui composent l’administration. Mais écrire ?
En novembre 1944, elle publie son premier article dans « Femmes françaises » sous le titre « Travail urgent : travail social ». Louis Aragon lui-même souhaite avoir un de ses articles… Elle est pressentie par Juliette Jonvaux qui dirige Fraternité, journal d’extrême-gauche pour rejoindre le comité de rédaction du journal. Elle couvre le retour des déportés et des prisonniers de guerre, s’insurge, se révolte contre le manque d’organisation des secours aux déportés, qui doivent en plus de leurs souffrances attendre et attendre encore… Elle se rend en Allemagne et publie un article « Eté allemand » qui aura un certain écho.
Très sensible aux problématiques liées au rôle des femmes dans le monde du travail, elle utilise sa plume pour défendre l’égalité des sexes et « la promotion des femmes aux postes à haute responsabilité » car ni « le ravaudage des chaussettes, ni les collections de couturiers, ni même le soin des enfants ne suffiront à remplir leur vie tout à fait. » C’est son article « L’Abeille citoyen » publié dans Vogue qui va reprendre ces idées et provoquer bien des remous . Elle rendra compte par la suite des débats du tout premier Congrès international des femmes qui se réunit à Paris, à la Mutualité, du 25 novembre au 1er décembre 1945.
Mais ses prises de position radicales agacent passablement sa mère qui lui fait quelques remontrances : « Maurice me dit que Fraternité est un journal impossible. Je ne le saurai donc que par ouï-dire si tu n’y rentres pas ». Elle abandonne donc le journalisme et à la mort de sa mère en 1954, découvre que le testament de cette dernière la désavantage considérablement.
« En ce jour de 1954, il y eut en moi beaucoup de la femme trompée depuis toujours. Sans doute n’avais-je que trop rarement eu le sentiment avec ma mère de vivre le grand amour. Lorsque d’elle à moi, il y eut grand amour, ce fut de loin. L’éprouva-t-elle ? de loin, avec l’écart d’âge qui nous séparait ? Elle m’aima de loin, au temps où je ne savais pas répondre à cet amour. »
Elle parvint à recouvrer son droit moral sur l’œuvre de sa mère et à compter de 1977, elle se consacra à la réédition de ses œuvres et se réfugia Impasse de l’Ecritoire, à Beaumont-du-Gâtinais en Seine-et-Marne quand elle n’était pas à Paris.
Elle meurt en 1981 des suites d’un cancer et confie sa correspondance à sa nièce Anne de Jouvenel en lui demandant de la publier le plus tard possible.
Colette de Jouvenel eut un lien très fort à l’écriture et c’est à cet égard qu’elle m’a intéressée, lien tissé de mots en creux, des mots tus, des mots manqués, des mots d’une mère écrivain et des mots secrets de son journal qui ne sera peut-être jamais publié.
Le récit de François Soustre est passionnant et il faut le lire si, par hasard, vous avez croisé ce visage d’une grave beauté et ce regard empreint de mélancolie. Vous découvrirez l’histoire d’une vie …J’espère vous avoir donné envie d’aller plus avant dans cette aventure. Dans quelque temps peut-être ouvrirez-vous ce livre d’un doigt impatient et retrouverez-vous un peu des émotions qui m’ont agitée à sa lecture.








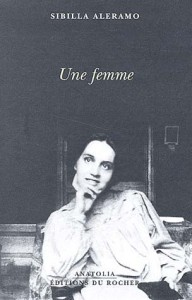
 Dario Fo (Prix Nobel de littérature 1997), Franca Rame, Médée in Récits de femmes et autres histoires
Dario Fo (Prix Nobel de littérature 1997), Franca Rame, Médée in Récits de femmes et autres histoires







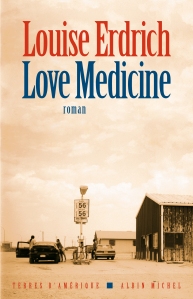
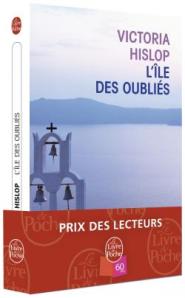






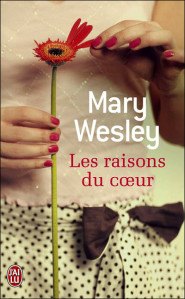

 jouissant de privilèges de classe qu’ils ne remettaient jamais en question . Si souvent, les premières victimes en étaient les femmes, les hommes n’étaient pas moins prisonniers de leur éducation.
jouissant de privilèges de classe qu’ils ne remettaient jamais en question . Si souvent, les premières victimes en étaient les femmes, les hommes n’étaient pas moins prisonniers de leur éducation.