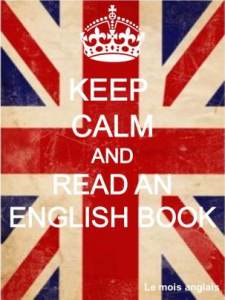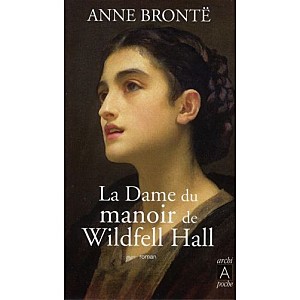La cousine Phillis est une assez longue novella publiée pour la première fois en feuilleton dans the Comhill Magazine de novembre 1863 à février 1864, entre deux longs romans, Sylvia’s lovers (1863) , histoire d’amour et de guerre, et un de ses chef-d’œuvre Femmes et Filles (1865) que la mort de l’auteure laissera inachevé.
J’ai eu davantage de plaisir à lire cette nouvelle que le précédent livre que j’ai lu d’elle « Cranford ». Le récit est plus dynamique, et le narrateur décrivant ses pensées et sentiments apporte un point de vue personnel qui en dit aussi long sur lui que sur la fameuse cousine.
Ce récit est l’histoire de plusieurs amours, fraternel, filial, conjugal dont chacun éprouve sa nécessité à la défaillance de l’un des deux autres. Ce tissage affectif permet à chacun d’évoluer et de mûrir malgré les souffrances et les épreuves. C’est pour moi un récit sur l’importance de la relation en tant qu’elle n’en exclut aucune autre parce qu’elle est elle-même relative et non-absolue. Enfin, c’est de cette manière que je l’ai lu.
Le narrateur, Paul Manning a dix-neuf ans, et s’installe dans la ville d’Eltham pour devenir employé aux écritures sous les ordres d’un ingénieur ambitieux et cultivé, Holdsworth, chargé de superviser la construction d’une petite ligne de chemin de fer. Une vive amitié naît entre les deux hommes malgré la différence de position. Non loin de là, à Hope Farm (on se dit que ce nom n’est pas choisi au hasard !) vivent des cousins éloignés, les Holman. Ceux-ci ont une fille qu’ils chérissent par-dessus tout, Phyllis de deux ans plus jeune que Paul. La famille va vite adopter Paul et celui-ci décide un jour de leur présenter son ami et mentor.
La cousine Phillis est bien sûr dans la veine du roman sentimental, largement réservé aux femmes qui écrivent mais dont elles renouvellent le genre en y introduisant des critiques et des observations sur la société de l’époque et notamment sur la place des femmes.
L’éducation des jeunes filles malgré des avancées importantes n’est pas toujours très bien vue.
« Vois-tu, continuai-je, elle est si instruite – elle raisonne plutôt comme un homme que comme une femme. » Or la beauté et l’apparence restent les qualités féminines par excellence. Une femme qui raisonne prétend ressembler aux hommes et cela amoindrit leurs capacités de séduction. Symbolique, le déplacement se fait de l’esprit au corps.
« Une fille instruite, c’est vrai –mais on ne peut plus rien y faire maintenant, et elle est plus à plaindre qu’à blâmer là-dessus, vu qu’elle est la seule enfant d’un homme aussi instruit. »
Malgré la création de Bedford College à Londres en 1849 par Elizabeth Jesser Reid, il faudra attendre 1870 et 1879 , pour que Cambridge et Oxford s’ouvrent enfin aux femmes ! Pour la grande majorité des femmes l’instruction supérieure n’est possible que si elle est permise par le père qui lui-même est seul détenteur des connaissances. Mais pourtant dès le début du XIXe siècle , les écoles primaires pour filles sont créées de manière systématique en Angleterre. Phillis est la représentante de cette femme nouvelle qui aime apprendre et désire ardemment s’instruire.
La mère est une personne « purement maternelle, dont l’intellect n’avait jamais été cultivé et dont le cœur aimant ne s’intéressait qu’à son mari. ». Elle jalouse les conversations de la fille et du père auxquelles elle ne comprend rien.
Dans ces propos que tient le père de Paul, on voit que l’éducation des femmes, leur instruction ne peut être qu’un « mal », et que s’il se produit dans cette famille, c’est qu’il est le résultat d’un autre déplacement tout aussi symbolique, du garçon absent « mort en bas-âge », à la fille qui a survécu. La société patriarcale ne peut faire mieux que de déplacer l’axe, l’incliner sans bouleverser pour autant l’ordre social.
Paul, lui même, alors qu’il ressent de l’attirance pour sa cousine, ose à peine lui parler de peur qu’elle ne s’aperçoive de son ignorance. Il se demande alors si elle est faite pour lui. De même qu’elle est plus grande que lui, et que cela renforce encore le sentiment d’infériorité qu’il éprouve.
Mais des changements s’annoncent, le chemin de fer parvient dans des endroits de plus en plus reculés, la loi postale permet l’envoi de nombreux courriers et permet donc l’échange des idées. L’industrialisation menace les campagne et produit de grands bouleversements en même temps qu’elle ouvre aux idées nouvelles, à l’économie et à la science.
On voit ici comment ‘Elizabeth Gaskell renouvelle le genre et lui donne des résonances bien plus importantes que celles d’un simple roman sentimental.
Une nouvelle passionnante donc sur ce XIXe siècle fut le siècle du féminisme avec deux mary : Mary Astell et Mary Wollstonecraft.
Billet dans le cadre du mois anglais chez Lou ou Titine. Une occasion de parler pendant un mois de livres, films, voyages ou cuisine anglaise. Et en lecture commune avec Virgule.