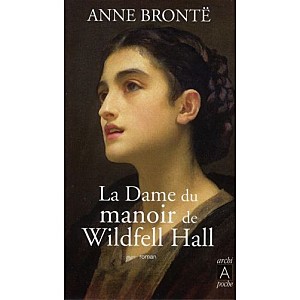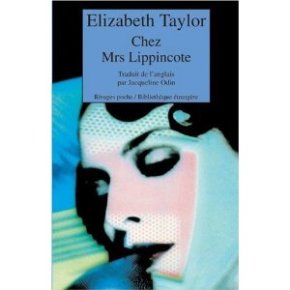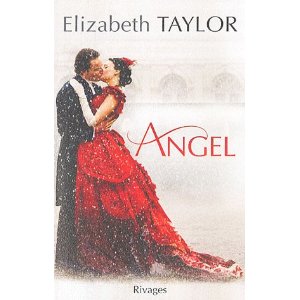Anne Brontë La Dame du manoir de Wildfell Hall archi poche 2012 ( première publication en 1848)
Anne Brontë est la moins connue des sœurs Brontë et « La Dame du manoir de Wildfell Hall » aussi traduit « La recluse de Wildfell Hall » eut à souffrir de critiques particulièrement acerbes lors de sa publication en Angleterre en 1848 ; on reprocha à Anne Brontë de faire l’apologie du vice tant ses personnages étaient réalistes, de camper une héroïne aux vertus bien peu féminines et d’étaler « son goût morbide pour la brutalité vulgaire ». Un an après la mort de sa sœur, Charlotte empêchera la republication de l’ouvrage, le jugeant peut-être trop scandaleux pour l’époque.
On le considère aujourd’hui à juste titre comme l’un des premiers romans féministes.
Helen Graham est une veuve bien mystérieuse. Elle vit en compagnie de son fils dans un manoir délabré et particulièrement retiré et semble rechercher la solitude. Que cache son attitude ? Que fuit-elle ? Qu’a-t-elle donc à se reprocher pour s’entourer de tant de mystère. Les langues vont bon train jusqu’à ce que le scandale éclate … Le récit est d’abord raconté par Gilbert Markam, un hobereau du coin, puis par Helen qui lui confie son journal.
Anne Brontë se place ici dans la tradition des grands moralistes. Il s’agit de peindre les malheurs du vice pour inciter à la vertu et dissuader les jeunes gens de se livrer à la débauche, les jeunes hommes surtout, à qui une société hypocrite et injuste passe tous les caprices censés montrer leur puissance et leur virilité. Anne Brontë s’inspira pour cela de la déchéance de son frère qui mourut alcoolique et tuberluceux.
Le trait est incisif, Anne Brontë démonte les mécanismes d’une toute-puissance masculine à laquelle des lois injustes et une éducation permissive ne mettent aucun frein. Les femmes séparées de leur mari ne peuvent intenter une action en divorce, ni disposer de leur fortune, ni conserver la garde de leurs enfants. Elles doivent être soumises et résignées. Seuls de mauvais traitements physiques peuvent justifier un éloignement salutaire. Or Hélene Graham/Huntington quitte le foyer conjugal, vend des tableaux pour gagner sa vie et fait fi du qu’en dira-t-on. Elle ose critiquer la différence d’éducation entre les garçons et les filles et la mauvaise influence des mères qui à force de gâter leurs fils ainés en font des monstres de vanité et d’égoïsme. « Je ne compte pour rien ici », se plaint Rose, la sœur de Gilbert Markam. Les garçons passent avant tout, les meilleurs morceaux leur sont réservés et les femmes sont à leur service.
Lorsqu’on lit aujourd’hui les romans écrits par des femmes, on retrouve, dans certains milieux ou dans certaines parties du monde les mêmes constats. Cette litanie en agace beaucoup, hommes ou femmes, qui ont l’impression parfois qu’il y a une forme d’exagération et de répétition un peu vaine. Mais voilà, la littérature est aussi une arme de combat, le lieu d’une prise de parole pour ceux ou celles qui en sont privés. D’ailleurs, le sort réservé aux femmes est un excellent indicateur pour la démocracie, les endroits où elles ne sont pas respectées sont aussi ceux où les Hommes, plus généralement, ne sont pas vraiment libres. Et les voix qui sélèvent ne sont pas seulement féminines. J’avais été frappée lors d’une émission animée par Frédéric Taddeï , de la remarque d’une juriste qui disait ne pas s’intéresser plus à la cause des femmes qu’à n’importe quelle autre cause. L’antiféminisme n’est pas le seul fait de certains hommes mais aussi de nombreuses femmes. Peut-être est-ce une façon de se rassurer, de s’exclure de la « masse » indistincte de celles qui par leur genre pourraient être vulnérables ou assignées à certains rôles. L’illusion peut-être qu’il n’y a plus vraiment de combat à mener.
Ann Brontë est morte à 29 ans de la tuberculose. J’ai une très grande admiration pour cette jeune femme, pour sa lucidité et son courage. Elle est pour moi un modèle. Certes, elle n’était pas « romantique », même si elle sacrifiait comme tant d’autres écrivains à l’inévitable « histoire d’amour », mais elle savait analyser finement les rapports sociaux de genre. Elle écrivait pour avoir un autre destin… Mais peut-il vraiment y avoir d’autres raisons pour écrire ?