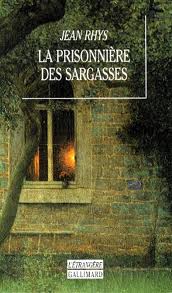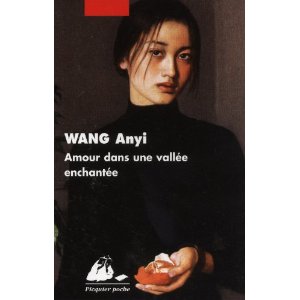Marianne Renoir, rencontre à quinze ans Pierre Pansart descendant du pape Sixte Quint et de la grande famille des Peretti, dont Stendhal a raconté quelque part les aventures. Flattée peut-être par les attentions de ce jeune érudit , il connaît le grec et le latin, l’italien aussi, car il passe tous ses étés dans la villa de ses aïeux, près de Ferrare, Marianne succombe …
Six ans plus tard, Marianne et Pierre se retrouvent dans la villa de Camporiano. Les soubresauts d’un amour finissant nous sont contés ici par la plume alerte de Lise Charles qui possède un talent certain à décrire les mouvements intérieurs de son héroïne, partagée entre un reste d’amour, la haine, et le dégoût.
Marianne s’ennuie avec Pierre mais elle n’ose pas le quitter, les atermoiements du cœur sont la matière de ce récit. Elle aurait voulu « qu’il fût tout bon ou tout mauvais », pense parfois qu’elle « s’effondrerait » s’il n’était pas là mais au fond, ne le supporte plus. Pourquoi aime-t-on, pourquoi n’aime-t-on plus ? Que voit-on de celui que l’on croit aimer ? L’amour est-il la prescience de la valeur d’un être, comme le dit Ortega y Gasset, ou au mieux, un aveuglement salutaire ?
Elle éprouve pour lui désormais « un mépris calme, un dégoût intérieur » et se plaît à imaginer cent fois les détails d’une possible rupture. L’instant d’après une « félicité tournoyante » s’empare d’elle et la ferait presque pleurer de bonheur.
Méchante, elle ne l’aime plus et se plaît à l’humilier, captive, elle ne peut se défaire de cette relation. Elle voudrait aimer pourtant et se heurte à sa propre impuissance, « de quels dévouements, de quels élancements n’aurait-elle pas été capable » ? Car c’est terrible, n’est-ce pas, de n’avoir personne à aimer, de se sentir prisonnière ou morte, prise au piège d’une relation qu’on ne souhaite plus, d’une liberté dont on ne sait pas user, avec ce choix à portée de main comme un vertige.
« Elle en était venue à envier les femmes des siècles passés. »
Pierre lui, n’est pas un personnage qu’on se plaît à aimer, et on se demande ce qu’est cet amour qu’il dit ressentir alors que c’est « quand elle dort, (qu’)elle a l’air d’une petite morte », que son amour est le plus fort. On sent le cuistre, mais parfois aussi un maladroit un peu rustre malgré toute sa culture, et plus rarement un homme touchant .
Au terme de cet été peut-être, le dénouement aura-t-il lieu?
« Je voulais montrer une situation où l’on s’ennuie un peu, avec la déliquescence. L’amour comme une bonace, tel que l’écrit La Rochefoucauld, mais aussi l’amour comme Stendhal. À la fois l’ennui, l’exaltation, le dégoût, et, en même temps, que ça aille vite. » confie-t-elle au journaliste Pierre Lançon de Libération, qui a fait une très belle critique de ce roman.
Le problème c’est que nous lecteurs, nous ennuyons avec elle. C’est brillant, c’est vrai, magnifiquement écrit, truffé de références, ( d’ailleurs Lise Charles est brillante, En 2004, élève du lycée Henri-IV, elle a obtenu les premiers prix aux concours généraux de français, d’allemand, de grec ; l’année suivante, un second prix de philosophie. Et est aussi douée en mathématiques, prépare un doctorat ), mais peut-être est-ce trop, trop réussi, trop bien écrit, au détriment de l’émotion. Je suis restée en dehors de ce récit bien maîtrisé, de cette langue trop bien soignée. Je n’ai rien ressenti pour ces personnages, j’ai admiré le style, l’écriture, la construction ; mes élans sont restés purement intellectuels. Vous me direz, c’est déjà ça.
C’est vrai, mais pourquoi lit-on, si ce n’est pour être emporté au-delà de soi ?
Ce livre est le dernier de la sélection que je lis pour les ouvrages qui ont passé le second tour. Les résultats auront lieu certainement la semaine prochaine et c’est celui que j’ai le moins aimé.