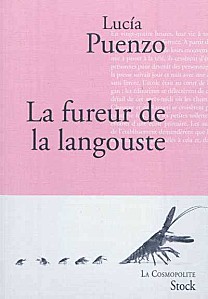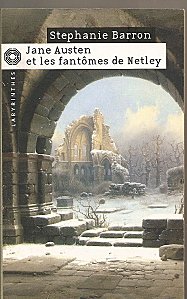Il faut lire ce roman comme un conte qui commencerait par la fin. Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants. A défaut de prince et de princesse, vous prenez deux bourgeois trentenaires, à la situation matérielle confortable, dans une grande et belle maison située à la lisière d’une forêt.
Le prince moderne, est pilote de ligne et ressemble à Paul Newman, la princesse est une femme moderne, mère au foyer (Cendrillon ?) avec Bac +5 ou presque. Elle est longue, belle et mince.
Ajoutez à cela qu’elle n’a pas une marraine mais plusieurs… Et qu’elle s’aperçoit dans un murmure qu’elle ne s’éclate pas franchement dans la maternité. Il faut dire que quatre enfants en à peine dix ans ce n’est pas une sinécure !
« Oui, enfin non, je veux dire, je veux être : « juste quelqu’un ». Pas toujours et seulement cette créature qu’est la mère, qui donne la vie, apprend le langage et la mort, qui tisse des liens qu’elle doit apprendre à défaire. »
Et puis bien sûr elle attend le prince qui rentre tous les trois jours.
Jusqu’au jour où un cri de désespoir lui fait perdre sa voix. Heureusement, j’allais dire, parce qu’au bout de tant de perfections, la tension de la lectrice monte dangereusement !
Et commence alors ce qui est le plus intéressant dans le roman, l’héroïne devenue muette perd sa queue de sirène pour retrouver ses deux jambes et une certaine indépendance.
Elle y gagnera autre chose de bien plus précieux grâce à la musique et au chant.
Si vous croisez « la Petite Sirène » et « Le vilain petit canard », vous comprendrez la réaction de son entourage qui, au lieu de l’épauler, lui fait subir sarcasmes, bouderies et vexations. Et elle, au lieu de banalement se mettre en colère, tente de les comprendre. Là, une petite touche de « Sœur Thérèse d’Avila » ne ferait pas de mal.
La fugue s’entendra ici dans ses trois sens, la fugue de la fille de Clothilde, l’art de la fugue, figure musicale et la propre fuite de l’héroïne hors de modèles qui ne lui conviennent pas vraiment.
J’ai aimé dans ce roman-conte, la rencontre avec le chant, la musique et la scène, espace sacré où s’opère toute transformation et don total de soi. Une rencontre amoureuse qui illumine sa vie et lui fait prendre un autre sens.
« De l’ombre à la lumière, du corps embarras au corps oublié, Clothilde vocalisait et emplissait la salle d’énergie et de joie. »
Au final, j’ai passé un bon moment de lecture, avec quelques beaux passages qui m’auront véritablement transportée au cœur de cette musique faite toute entière du silence bruissant de l’écriture. Et c’est là le tour de force de l’écriture de se faire murmure, cri pour se transformer en un superbe chant à la condition expresse de prendre ce roman pour ce qu’il n’est pas : un joli conte.